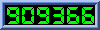CHAPITRE XI
De l'Empire
à l'Union Française
La guerre 1940.1945 génère des situations diverses dans
l'Empire
L'Afrique du Nord, point de départ de la reprise maçonnique
Réouverture progressive des loges à partir de 1944-1945
Le F\ Félix Eboué, la Conférence de Brazzaville et l'Union Française de 1946

La guerre
1940 - 1945 génère des situations
diverses dans l'Empire

Juin 1940, la défaite est entérinée
par le gouvernement de Vichy et le maréchal Pétain.
La loi du 13 août, portant
interdiction des associations secrètes, est précisée et aggravée, à l'encontre
de la FM\,
par le décret du 19 août. Cette loi et ce décret sont applicables « en France,
en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et territoires de mandat ».
L'Empire colonial connaît alors
deux cas de figures : les territoires qui restent dans le giron de Vichy et ceux
qui vont opter pour la France Libre.
-
Restent sous le contrôle de Vichy : L'Indochine, Madagascar, les Antilles-Guyane,
l'AOF et l'Afrique du Nord. Dans ces pays, la loi discriminatoire du 13 août est
appliquée sans réserve. Les loges sont fermées, les temples récupérés par les
autorités, les archives saisies. Les « listes de proscription » paraissent non
seulement au Journal Officiel mais sont publiées à longueur de pages dans les
quotidiens locaux. Les fonctionnaires sont limogés et les FF\
qui ont pris des responsabilités dans les partis politiques et les syndicats
sont inquiétés. Des FF\,
à titre personnel, vont s'impliquer dans des réseaux de renseignements en
relation avec les Américains ou les Anglais. Leur action sera reconnue à la
Libération.
- Passent à « La France Libre » : -
juin 1940 les territoires de l'Océanie avec la Nouvelle-Calédonie - entre août
et novembre 1940 les territoires d'AEF, sous l'impulsion du F\
Félix Auboué** – juin 1941 la Syrie - décembre 1941 St Pierre et Miquelon – mai
1942 Madagascar - novembre 1942 la Réunion - décembre 1942 Djibouti. Les
Francs-Maçons de ces Orients ont aussitôt la possibilité de s'extérioriser sans
contrainte. Mais les conditions de guerre ne favorisent pas la poursuite des
activités maçonniques régulières sur place. Tout se passe au niveau des
relations inter individuelles et des engagements personnels.
L'Afrique du Nord, point de départ
de la reprise maçonnique
En mars 1942, la Nouvelle-Calédonie
accueille les Américains qui s'installent dans le temple de Nouméa
(@) pour raisons
militaires. En novembre 1942, le Maroc et l'Algérie sont, à leur tour, libérés
par les Américains, qui entrent à Tunis en mai 1943. Une période nouvelle
s'ouvre sur le plan militaire : l'Empire Français va prendre progressivement
place dans la lutte - contre l'Allemagne, le Japon - et sur le plan maçonnique
les FF\
vont réaffirmer leur existence.
En octobre 1943, les FF\
du GODF et de la GLDF contactent le Général de Gaulle. Ce même mois d'octobre,
le TIF\
Dumesnil de Gramont arrive à Alger, où il est informé des tractations engagées.
Le 15 novembre, les FF\
du GODF votent la résolution : « Considérant que l'Ordre est empêché d'assurer
ses fonctions en France et dans son Empire prennent l'initiative de se grouper
en un Comité d'Administration du Grand Orient de France chargé de gérer les
intérêts de l'Ordre jusqu'à la libération de la Patrie. Ce Comité aura
provisoirement son siège à Alger ».
Finalement les contacts, coordonnés
ou parallèles, des FF\
de la GLDF et du GODF aboutissent. L'ordonnance est signée le 15 décembre 1943 :
« Portant annulation de la loi du 13 août 1940 et des dispositions relatives aux
Associations dites secrètes». Les circonstances historiques ont donc voulu qu'en
cet instant les loges coloniales de « périphériques » deviennent «.centrales
» en passant au cœur du dispositif de leurs obédiences respectives.
A peine constitué, le Conseil
d'administration du GODF à Alger prend des dispositions d'encadrement favorables
à une reprise des activités maçonniques :
Dans chaque Orient où il existait
une activité maç\
du GODF et où il lui paraîtra nécessaire de la faire revivre, sera désigné un F\
ayant pour mission de préparer cet éveil…. Les ateliers pourront se réunir en
Congrès dans chacune des régions maç\
qui subsistent encore : - La France libérée - Maroc - Départements d'Alger et
d'Oran - Département de Constantine et Tunisie - Les Colonies (toutes sauf
l'Indochine) - L'Etranger (Angleterre, Argentine, Egypte, Etats-Unis, Liban,
Syrie, Palestine, Ile Maurice, Suisse)… « Des dispositions ultérieures pourront
prévoir la réunion d'un Congrès Général.»…
Ce rôle provisoirement central des
loges coloniales - de façon structurelle pour le GODF - se termine le 13 janvier
1945, quand le Conseil d'administration instauré à Alger remet au Conseil de
l'Ordre les pouvoirs qui lui avaient permis de gérer l'ensemble des loges des
colonies et de l'étranger.
Réouverture progressive des loges à
partir de 1944-1945
Les responsables décident que tout
FM\
régulier au moment de la dissolution aura le droit de demander son admission au
dit atelier. Il fournira à cet effet, joints à sa lettre au Président, tous
renseignements profanes et maçonniques.
Cette méthode va permettre
d'éliminer, sans hésitations, un nombre certain d'anciens FF\
dont le comportement n'a pas été édifiant. Plus délicat a été de juger des FF\
qui avaient adopté une démarche simplement timorée, parfois liée à un isolement
de fait. Enfin quelques cas sont douloureux car des FF\
estiment, souvent à juste titre, que leur vécu est une preuve suffisante de leur
engagement pendant la guerre et que dès lors ils n'ont pas à passer devant une
commission de sélection ; ils s'en vont en claquant les portes.
Le non-retour de nombreux éléments
à la Maçonnerie est numériquement sensible. A cela, s'ajoutent les rigueurs des
critères de recrutement : ce qui condamne certaines loges à se mettre en sommeil
ou à différer leur retour à l'activité, sinon à absorber une autre loge. De
plus, les locaux tardent parfois à leur être restitués.
Les premiers ateliers coloniaux des
obédiences françaises réouvrent donc dès 1944-1945, avec de faibles effectifs -
à l'âge moyen accru - et dans des conditions matérielles préoccupantes. La
représentation des loges aux premiers convents respectifs d'après guerre, donne
une idée surestimée de l'activité maçonnique réelle dans les Orients concernés.
Mais ce qui importe, pour les responsables de l'époque, c'est que les structures
de leurs obédiences respectives soient en état de fonctionnement et que la FM\
retrouve son élan avec Paris pour centre.
Cette préoccupation s'accompagne
d'un réel élan vers l'unité maçonnique. Les FF\
coloniaux aspirent à un rapprochement inter-obédientiel. A tel point qu'il est
admis, par le Conseil d'administration d'Alger au nom du GODF, que les délégués
des loges s'efforceront d'élire un Directoire unique chargé d'assurer la fusion
du Grand Orient et de la Grande Loge. Rêve fortement ébranlé, en septembre
1945, par la GLDF qui rejettera à l'unanimité tout projet d'union avec le GODF,
afin de préserver ses chances d'être elle-même reconnue par les obédiences «.régulières
».
Sur le plan colonial,
Conférence de Brazzaville,
- organisée fin janvier début février par la France Libre
- a marqué
durablement de son empreinte les esprits. Conférence où les nuances de la
politique coloniale française s'expriment ouvertement. : la volonté du Général
de Gaulle de maintenir l'Empire Français et, par ailleurs, les idées du F\
Eboué qui préconise la décentralisation, l'arrêt de l'administration directe, la
création d'une Assemblée fédérale, une représentation élue à l'Assemblée
Constituante, la suppression de l'indigénat et du travail forcé. Ces idées vont
cheminer lors des discussions à propos de la rédaction de la Constitution
Française, votée par référendum en octobre 1946.
Les deux grandes obédiences,
sensibilisées par le rôle récent joué par leurs loges coloniales, mettent le
sujet « l'Union Française » à l'étude de toutes les loges, le GODF pour son
convent de septembre 1946, et la GLDF l'année suivante. Le Conseil de l'Ordre
fait en sorte que les FF\
parlementaires de l'Assemblée Constituante soient associés à ces travaux.
Le convent du Grand Orient de
France conforte la proposition des loges coloniales qu'il convient d'accorder
aux indigènes les libertés les plus substantielles - liberté de presse, de
réunion et d'association, liberté individuelle - par l'extension de la
législation métropolitaine. Une citoyenneté uniforme risque d'être factice,
aussi faut-il créer à l'intérieur du monde français, le citoyen d'Afrique, le
citoyen de Madagascar, le citoyen d'Indochine, « tous imprégnés de notre culture
et de nos aspirations »…
L'inspiration fédéraliste de ce
texte est identique à celle qui sous-tend, quelques mois plus tard, le texte
constitutionnel donnant à la France mission de coordonner « l'Union Française ».
En fait, dans l'un et l'autre texte, il y a recherche d'un équilibre entre
l'assimilation et l'association, dilemme toujours non résolu.
Quoiqu'il en soit, le mot « Empire
» disparaît au profit de celui de « Union Française » et la nouvelle géographie
coloniale, dans laquelle s'inscrit la FM\,
se présente de la façon suivante :
- Syrie et Liban ont leur
indépendance depuis1941
- Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Réunion, sont départements français et sortent donc du statut proprement
colonial
- Tout comme les établissements de l'Océanie qui ont l'assimilation
juridique totale.
- L'Algérie garde un statut ambigu
car le double collège est laissé en place dans ce département.
- Les autres pays, sous
divers statuts - « Territoires associés » ou « Etats associés » - restent
attachés à la France.
On assiste dès lors à une tentative d'adaptation des obédiences à la situation nouvelle
L'environnement de la Maçonnerie
coloniale se transforme, mais plus ou moins rapidement selon le pays. La
question est dorénavant de savoir comment se glisser dans la structure mise en
place. Que ce soient les loges d'Indochine, de Madagascar, du Congo, de la Côte
d'ivoire, du Sénégal, du Mali, de la Tunisie et d'Algérie, pour toutes ces loges
se pose le problème de l'évolution en cours.
Les évènements de 1945 en
Indochine
et en
Algérie, de 1947 à
Madagascar prouvent qu'il est urgent de donner réponse
non seulement aux masses mais aussi aux élites autochtones. Et l'un des aspects
majeurs, sur le plan maçonnique, est d'avoir ou non des Annamites, des
Africains, des Arabes parmi les FF\
fréquentant les ateliers. Problème non réglé depuis les débuts de la
colonisation.
- En Indochine, les conditions
explosives ne vont pas faciliter l'opération qui reste sans résultats notables
puisque la poignée de FF\
initiés avant guerre se font prudents.
- A Madagascar et en Afrique non
plus, la réussite n'est pas au rendez-vous : les « indigènes » sont les grands
absents dans les Ateliers.
- En Afrique du Nord, les FF\,
conscients de l'évolution en cours, vont chercher à incorporer des « indigènes
», en réglant le problème de la religion et celui de la langue -
..Au Maroc,
l'initiative de créer une loge avec des Marocains reçoit l'aval du Résident Labonne, confirmé par son successeur le Général Juin. En 1947, la loge GODF «
Union et Progrès », à l'Orient de Rabat puis de Settat, allume donc ses feux
: « l'At\
travaillera sous les auspices du Grand Architecte, au Rite Ecossais Ancien [et]
Accepté. Voilà donc évité un écueil religieux ». Le REAA, cher aux anglo-saxons,
est utilisé pour consolider le Grand Orient de France en terre d'Islam ! En
1949, dans le but de mieux faire correspondre l'intitulé de l'atelier avec ses
objectifs, les FF\
lui donnent le nom de « Fraternité Franco-Marocaine ». Cette loge, quel
que soit son nom dans le temps, reste éminemment confidentielle, avant de se
mettre en sommeil par crainte des réactions des Nationalistes.
..En Tunisie,
pour répondre au même problème d'admission de musulmans en loge, un autre choix
est fait avec la création de la loge « Emir Abd el Kader ». Il
s'agit, ici, de favoriser l'usage de la langue arabe. Le bilan d'échec sera
rapide.
..En Algérie, les FF\
des deux obédiences se montrent réticents à l'égard de ces essais de la langue
arabe ; quant au REAA, les FF\
du GODF appuient leur refus sur le fait que les quelques Algériens qui
fréquentent les Ateliers de la GLDF - où depuis
1953 les loges acceptent de mettre le Coran sur le plateau du Vénérable -
n'acceptent pas de changer le statut de la femme et ne sont pas favorables à la
séparation de la Religion et de l'Etat. La seule voie
préconisée par les FF\
européens est celle de l'intégration à une société laïque et de langue
française.
Au total, la Franc-Maçonnerie subit
un échec patent dans sa volonté de faire des émules dans les milieux
autochtones. Echec préoccupant pour les FF\
qui mettaient un espoir sincère dans la réalisation de l'Union Française.
Le F\
Félix Eboué, la Conférence de Brazzaville et l'Union Française de 1946
.
 Né
en 1884 à Cayenne, après des
études de Droit à Bordeaux,
Félix Eboue** s'inscrit à l'école coloniale. Initié, avant
1914, par la loge « La France Equinoxiale » de Cayenne, il s'affilie à la
loge « Les Disciples de Pythagore » à Paris, toutes deux du GODF, et
enfin à la loge « Maria Deraisme » du DH.
Né
en 1884 à Cayenne, après des
études de Droit à Bordeaux,
Félix Eboue** s'inscrit à l'école coloniale. Initié, avant
1914, par la loge « La France Equinoxiale » de Cayenne, il s'affilie à la
loge « Les Disciples de Pythagore » à Paris, toutes deux du GODF, et
enfin à la loge « Maria Deraisme » du DH.
Envoyé au Congo, c'est dans les
savanes de l'Oubangui qu'il s'imprègne de la réalité africaine. Il rejoint la
Martinique en 1932, puis le Soudan en 1934 et, en tant que gouverneur, la
Guadeloupe en 1936 avant de rejoindre le Tchad en 1939.
Le 26 août 1940, dans une
déclaration solennelle, il proclame que le Tchad reste dans la guerre de
libération. Vont suivre de plus ou moins bon gré : le Cameroun immédiatement,
puis le Moyen Congo et l'Oubangui-Chari, le Gabon tardant à le faire en
novembre. Nommé, au nom de la France Libre, Gouverneur de l'AEF, Eboué est cité
par De Gaulle à l'Ordre de l'Empire « pour avoir donné le signal du redressement
de l'Empire ».
Il publie, le 8 novembre 1941, une
circulaire par laquelle il pose les fondements de la nouvelle politique indigène
en AEF. Pendant deux ans, Eboué met en pratique ses principes faits de
reconnaissance de « l'autre » et de pouvoirs réellement partagés. Mieux, il
essaie de faire accepter ces principes lors de la
Conférence de Brazzaville,
du 30 janvier au 8 février. Cette conférence
(@) regroupe les représentants
administratifs des territoires français d'Afrique autour de M.
René Pléven**,
commissaire aux Colonies ainsi que les représentants de l'Assemblée
Consultative. Réunie sur l'initiative du
gouvernement provisoire d'Alger,
présidé par le général de Gaulle, elle jeta les bases de
l'Union
française : décentralisation, arrêt de l'administration directe, création
d'une Assemblée fédérale, représentation élue à l'Assemblée Constituante,
suppression de l'indigénat et du travail forcé. Ce texte restera la somme des
principes sur lesquels va se construire, deux ans plus tard, l'Union Française.
Epuisé à la tâche, le compagnon de
la Libération, Félix Eboué meurt, en 1944, au Caire où il représentait la
France. A la fin de la seconde Guerre Mondiale, un consensus se dégage pour le
transfert du corps de F. Eboué au Panthéon, en même temps que celui de
Schœlcher, pour commémorer le Centenaire de l'abolition de l'esclavage.
Le 20 mai 1949, Schœlcher et Eboué
sont réunis, par delà la mort, dans le même haut lieu de mémoire de la
République : le Panthéon.
@
Série de videos sur l'histoire des pays africains
Retour Haut fe
page