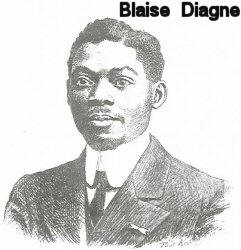CHAPITRE IX
Assimilation
ou Association ?
Un intérêt plus marqué pour les questions coloniales
Un esprit de «missionnaire» au service de la
civilisation occidentale humaniste
La théorie de l'assimilation au contact des
réalités
La théorie de l'association de Sarraut, source de
réflexion dans les milieux maçonniques
Les hésitations et
l'attachement au principe de l'assimilation, malgré tout
Blaise Diagne, le chantre de
l'assimilation et de l'intégration

Un intérêt plus marqué pour les
questions coloniales
La Grande Guerre a fait découvrir,
aux Français de la métropole, l'importance des colonies. La question coloniale
est alors abordée avec plus d'intérêt qu'elle ne l'avait été avant guerre. Les
progrès des loges dans les structures obédientielles et la reconnaissance par la
Nation du rôle des colonies entraînent une augmentation des sujets traités
concernant les colonies. Les FF\
des colonies ont le sentiment d'être mieux écoutés.
Au GODF, la Commission des Affaires
Politiques et Sociales voit la masse de ses dossiers s'étoffer à partir de 1920
pour aller croissant au cours des années suivantes.
Sujets abordés régulièrement :
Enseignement aux colonies - Agissements de l'Eglise catholique - Défense laïque
- Politique coloniale - Mise en valeur - Justice indigène - Assistance médicale
et hygiène - Assistance aux déshérités - Fonctionnaires et militaires coloniaux
- Islam et FM\
- L'Algérie et les deux protectorats voisins Tunisie et Maroc.
Sujets plus événementiels : 1920
Syrie - 1921 Syrie, Tanger et Nouvelles Hébrides - 1922 Egypte et AOF - 1923
Antilles, Indochine, Turquie, Liban, Madagascar - 1924 Syrie, Nouvelle
Calédonie, Liban, guerre du Rif - 1925 Sarrail, Lyautey, Indochine, « vieilles
colonies », Martinique - 1926 Syrie, Indochine, Tahiti et Tanger - 1927
Cambodge, Syrie, Tchad - 1928 Syrie et Tahiti - 1929 Syrie, Congo, Liban,
Indochine - 1930 et 1931 - 1932 AEF - 1933 AOF, Indochine, Guyane, Antilles,
Madagascar - 1934 et 1935 - 1936 Cochinchine, Nouvelle Calédonie, Madagascar -
1937 Madagascar, Guadeloupe, AOF, Sahara - 1938 Indochine, Guyane.
Le convent du GODF, de 1923,
consacre une grande partie de son temps au problème colonial mis à l'étude des
loges. Le convent de la GLDF, en 1927, créée une commission des colonies et
recense en matière coloniale treize points majeurs au cours d'une étude mise
également à l'étude des loges. Le convent du DH 1928 approfondit à son tour le
sujet des colonies.
Un esprit de « missionnaire » au
service de la civilisation occidentale, européocentriste et humaniste
Les noms de loges sont révélateurs
de cette vision coloniale à la fois «.Humaniste
» et « Européocentriste ». Les thèmes sont assez largement repris par les divers intitulés pour être
répertoriés et révéler une philosophie sous jacente. Il s'agit, dans l'esprit
des Francs-Maçons, dans le cadre d'une histoire linéaire et orientée vers le
Progrès, d'apporter les bienfaits de la civilisation occidentale dans des pays
en stagnation ou en retard dans l'évolution en cours.
- Le premier thème est celui d'un
retour à la civilisation : «.Bélisaire
» à Alger, « Phénicia » à Rayak, « Nouvelle Volubilis.»
à Tanger, « Nouvelle Carthage » à Tunis, « La Renaissance » à
Ténés, Casablanca et Tunis. Perspective de l'histoire - des relations entre les
deux rives de la Méditerranée - avantageuse pour le monde phénicien, grec et
romain donc français par héritage. Une variante de ce thème existe, en Afrique
du Nord, avec indication d'une autre source d'où peut venir la Renaissance
espérée, à savoir le monde berbère : « l'Avenir Berbère » à Taza, «
l'Eveil Berbère » à Fez.
- Le thème le plus fréquent,
cependant, est celui de la Lumière sous ses différentes formes : « Luz
de Africa » à Oran, « la Vraie Lumière Africaine » à Philippeville, «
Anfa-Lumière » à Casablanca, « Lumière et Paix » à Safi, « La
Lumière du Cameroun » à Douala. La lumière céleste n'est pas absente avec
l'aurore, liée d'ailleurs à la perspective d'un renouveau, d'une renaissance :
« l'Aurore du Congo » à Brazzaville, « la Nouvelle Aurore » à
Dakar, « l'Aurore fraternelle » à Oujda. Toujours dans la catégorie des
lumières célestes offrant une direction souhaitable : « l'Etoile Occidentale
» à Dakar, « l'Etoile Bienfaisante » à Alger, « L'Etoile de
Carthage » à Tunis, «.l'Etoile
du Zerhoun » à Meknès, «
L'Etoile du Tonkin » à Haiphong. Enfin, lumière plus humaine : « le
Phare Africain » à Oran, « le Phare de la Chaouia » à Casablanca.
- Autre thème, aussi lié à la
Franc-Maçonnerie que la lumière, celui de l'Union, qui réunit ce qui est
épars, et de la Fraternité : «.Union
Africaine » à Oran, «
l'Union » à Tunis, « L'Union Guyanaise » à St-Laurent de Maroni, «
L'Union Calédonienne » à Nouméa ; « La Fraternité Tonkinoise » à
Hanoï, « La Fraternité Marocaine » à Rabat.
- Dans l'esprit des FF\
concernés, cette Lumière et cette Union, associée à la Fraternité, mènent
essentiellement à la Vérité, à la Raison, au Progrès,
valeurs de référence nécessaires pour donner un sens à l'Histoire et à la
colonisation. En effet, les colonies ne sauraient être sans un justificatif
humaniste : «.Véritas
» à Tunis, « Vérité et Persévérance » à Yaoundé ; « la Raison » à
Oran, « Travail, Liberté, Progrès » à Tunis, « Le Réveil de l'Orient
et les Fervents du Progrès Réunis » à Saïgon. L'européocentrisme des
Francs-Maçons s'affirme.
La théorie de l'assimilation au
contact des réalités
L'européocentrisme - sentiment très
largement partagé par les Européens de la supériorité de leur civilisation -
fonde le désir de faire profiter du Progrès les autres peuples, de les amener au
même stade de civilisation que le colonisateur. A cela, s'ajoute certainement un
reliquat de jacobinisme qui ne laisse pas de place au droit à la différence ;
c'est d'ailleurs le moment où la dénomination « Outre-Mer » se développe. Dans
cette démarche vers « l'autre », ainsi justifiée, la formule que préfèrent les
Francs-Maçons, est
l'assimilation des colonisés.
Ce principe de l'assimilation va
animer le combat mené
dans les vieilles colonies, avec l'appui des populations
concernées, pour obtenir en quelque sorte la pleine citoyenneté française. Il
s'agit, après avoir obtenu la fin de l'esclavage, de conquérir l'application des
lois françaises en matière d'Egalité, de Liberté et de Fraternité. Les FF\
retrouvent là une pleine cohérence entre les attentes des populations et leurs
valeurs humanistes qui placent l'Homme au centre de leurs préoccupations. Il est
clair que derrière l'assimilation se profile l'intégration et la reconnaissance
des vieilles colonies comme partie prenante de la France.
Par contre, le principe de
l'assimilation est soumis à une rude épreuve
en Algérie. La question de la
relation entre la République laïque et les musulmans, désireux de conserver un
statut spécial, se pose de façon cruciale.
L'Indochine est également un terrain
délicat dans la mesure où les populations sont attachées à leur propre
civilisation, que les Européens reconnaissent en tant que telle.
La résistance des colonisés à
l'assimilation et la dette que la métropole estime avoir à leur égard, pour leur
contribution à la guerre, poussent les Francs-Maçons à prendre en considération
leurs mœurs et leur culture. La FM\
participe à un mouvement largement répandu en France de reconnaissance des
réalités ethniques et culturelles des autres continents. Les FF\,
qui dénoncent les excès de la colonisation, n'en continuent pas moins à la
légitimer dans la mesure où elle permet de faire bénéficier les « indigènes »
des bienfaits de la Raison et de les faire avancer dans le sens linéaire de
l'Histoire qui mène vers le Progrès. Position incommode car riche de
contradictions non résolues.
La théorie de l'association de
Sarraut, source de réflexion dans les milieux maçonniques
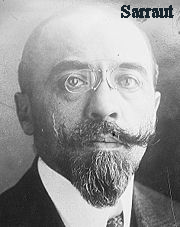 En 1923,
Albert Sarraut**, dans son
ouvrage
La mise en valeur des colonies françaises, avance une
théorie
coloniale qui tente de résoudre ces contradictions. Sa théorie sur «
l'association » conforte le bon droit des colonisateurs et donne un espoir de
rénovation des structures.
En 1923,
Albert Sarraut**, dans son
ouvrage
La mise en valeur des colonies françaises, avance une
théorie
coloniale qui tente de résoudre ces contradictions. Sa théorie sur «
l'association » conforte le bon droit des colonisateurs et donne un espoir de
rénovation des structures.
Véritable programme d’autarcie, de
la France et de son Empire, dont l’influence se sent dans les conclusions du
Convent GODF de la même année 1923 : « les colonies sont des créations
d’humanité, des conquêtes morales dont l’économie serait complémentaire de celle
de la métropole. Les droits politiques seront développés avec une certaine
autonomie administrative. La sagesse des colonisés les écartera d’une
indépendance qui ne serait qu’impuissance. La colonisation, c’est le droit du
plus fort à aider le plus faible : c’est la politique d’association ».
Il s'agit pour les FF\,
en accord avec la pensée de Sarraut, de pratiquer une politique de défense et
d'éducation des races, de constituer des élites indigènes pouvant accéder à la
qualité de citoyen. Sont également préconisés : la représentation indigène dans
les assemblées locales, une politique de décentralisation administrative, la
création d'industries, le droit de commercer avec l'étranger en échappant au
protectionnisme métropolitain. Ce programme, même en cas d'indépendance,
permettrait de nouer les liens durables de la gratitude et de l'intérêt des
rapports économiques.
La solution convient aux FF\
parce qu'elle apporte une réponse efficace à la crise économique d'après-guerre
et, semble-t-il, qu'elle est constructive sur le plan humain. Elle rend justice
à la contribution des colonisés pendant la guerre et tient compte de
l'émergence, dans l'horizon intellectuel français, des « cultures indigènes ».
Surtout, en donnant une signification morale à l'action et à l'œuvre en cours
outre-mer, elle lève les scrupules des Francs-Maçons qui auraient pu douter de
la légitimité de la colonisation.
Les hésitations et l'attachement
au principe de l'assimilation, malgré tout
Nombre de FF\
se montrent cependant hésitants. Les réactions à une circulaire, envoyée par la
loge d’Hanoï «.Fraternité
Tonkinoise », résument
ces hésitations. Les FF\,
à qui elle est adressée, en font l'analyse suivante : « Sa théorie de
l’émancipation a peu de conviction ; elle évolue de l’assimilation à
l’association... En résumé toutes les questions ont été examinées, mais aucune
de façon approfondie. C’est une question de longue haleine ». Cette notion, du «
temps nécessaire avant décision », sera souvent utilisée dans le dossier
colonial au point de laisser passer le moment propice.
Au convent GODF de 1923, la
commission conventuelle affirmait : « On ne peut s'arrêter ni à une rigide
politique d'association, ni à une politique simpliste de brusque et complète
assimilation ». Cette commission préconisait donc, en pleine ambiguïté, «.qu'une
politique souple de large association soit appliquée aux indigènes en vue de
leur assimilation progressive et complète, posée en principe de base ».
Le convent GLDF de 1927, précise
une série de réalisations souhaitables. Mesures qui confortent le travail de
structuration des sociétés colonisées, c'est-à-dire le travail d'assimilation en
cours. En attendant de décider entre l'intégration à la citoyenneté française et
l'association, car le convent pense qu'il faudra trancher différemment selon
les pays concernés.
Les propositions sont identiques, sous une forme
plus ramassée, à celles avancées par le convent de 1923 du GODF. Les FF\
des deux obédiences et les FF\
et SS\
du DH - convent de 1928 - sont dans la même logique :
1..Aucune conquête coloniale nouvelle ne doit
être entreprise – 2..Les travaux d’organisation et des améliorations urgentes
doivent être entrepris dans chaque colonie. – 3..Les concessions accordées
doivent être contrôlées ou révisées. – 4..L’organisation de la vie communale
avec participation des indigènes doit remplacer les territoires militaires. –
5..En France, les programmes scolaires doivent donner une plus large place à
l’étude des colonies. – 6..L’instruction des indigènes doit être intensifiée de
façon gratuite, obligatoire, laïque dans l’Ecole Unique. – 7..La coopération
entre colonisateurs et colonisés doit être développée par la création d’écoles
professionnelles. – 8..Que soit étendue aux colonies l’application des lois
sociales métropolitaines. – 9..Que soit organisées ou étendues les institutions
de crédit mutuel agricole et artisanal. – 10..Que soit étendue aux colonies,
l’application des Principes des Droits de l’Homme. – 11..Que les gouvernements
coloniaux donnent tout spécialement leur appui aux œuvres laïques. – 12..Que
soit supprimé le code de l’Indigénat. – 13..Que le recrutement forcé ne puisse
pas être exercé.
Les FF\
ressentent rapidement que l'une des finalités majeures du projet Sarraut s'avère
être d'ordre économique. Ils mettent en garde le convent GODF, de 1928, contre
une vision essentiellement économiste du phénomène colonial : « la richesse ne
constitue, en aucun cas, la justification de la colonisation ». Surtout, par
attachement au Progrès et à la Raison, les FF\
en viennent à craindre que l'association aboutisse à « laisser l'indigène
évoluer dans sa civilisation », sans lui permettre «.d'évoluer
» pour accéder à La Civilisation. Vision conforme à l'européocentrisme du
moment.
Blaise Diagne, le chantre
de l'assimilation et de l'intégration
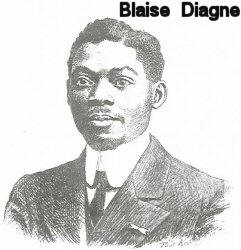 Né en 1872 à Gorée dans
une famille modeste, il
fait des études grâce à l'aide de la famille mulâtre
Crespin**
(famille dont le nom est attaché à la Franc Maçonnerie de Saint Louis du
Sénégal).
Diagne**
commence sa
carrière dans l'administration au Dahomey, avant
de passer au Congo où il lui est reproché de « se
poser en émancipateur de la race noire ».
Né en 1872 à Gorée dans
une famille modeste, il
fait des études grâce à l'aide de la famille mulâtre
Crespin**
(famille dont le nom est attaché à la Franc Maçonnerie de Saint Louis du
Sénégal).
Diagne**
commence sa
carrière dans l'administration au Dahomey, avant
de passer au Congo où il lui est reproché de « se
poser en émancipateur de la race noire ».
Il est affecté ensuite à la Réunion
où il est initié, en 1899, par la loge « L'Amitié » de St Denis. Passé à
Madagascar il devient Vénérable fondateur de « L'Indépendance Malgache »
à Tamatave en 1905, titre qui n'est pas sans signification.
Sa carrière l'amène à Cayenne en
1910, où le gouverneur affirme : « Diagne souffre d'une indigestion
d'assimilation ».
Elu député du Sénégal en 1914,
malgré l'opposition des Européens et des St Louisiens, il se veut fédérateur : «
Je suis noir, ma femme est blanche, mes enfants sont métis ». Pendant la guerre,
son ambition est de renforcer la nationalité française des Sénégalais des quatre
communes.
C'est pourquoi il dépose, en 1915
et 1916, des propositions de loi tendant à associer les «.originaires
» à l'effort de guerre et à les amener au rang de citoyen français à part
entière. Une fois ces troupes sur le front, Diagne n'oublie pas d'en prendre la
défense quand les circonstances l'exigent.
En 1918, Clemenceau le nomme
Commissaire de la République dans l'Ouest Africain pour faciliter le recrutement
de soldats. Ce que Diagne accepte en contre partie de conditions avantageuses
pour la promotion des Africains vers la citoyenneté française. Cet objectif
n'est plus évident, en 1930 à Genève, à propos du travail forcé dans les
colonies françaises. Sa disparition, en 1934, ouvre un champ plus large aux
idées nouvelles que défendent, au Sénégal, les syndicats et les partis de
gauche, dans lesquels militent à titre individuel des FF\
engagés dans la cité.
Sur le plan maçonnique, Diagne,
bien que député du Sénégal, s'est affilié à la loge « Pythagore » de
Paris. Mais il garde des liens suivis avec la FM\
au Sénégal, parfois tendus.
En 1924, le GODF le délègue
officiellement, en tant que membre du Conseil de l'Ordre (premier Conseiller de
l'Ordre originaire de l'Afrique sub-saharienne), pour inspecter les loges de
Dakar et St Louis. Pour le moins, il y a en Blaise Diagne un avocat éloquent de
l'assimilation dans les cercles les plus responsables de la politique française
et en retour un promoteur de cette « d'idée-force » débattue dans les colonies.
Son acceptation du fait colonial et
de l'assimilation est totale si le colonisateur et le colonisé tirent, chacun,
parti équitable de cette situation. C'est
un raisonnement que tiennent la plupart des FF\
dans les loges coloniales.
Retour
Haut de page
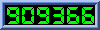



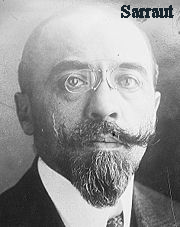 En 1923,
En 1923,