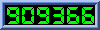CHAPITRE VIII
Plénitude coloniale
après la Première Grande Guerre
Les loges coloniales pendant la Première «Grande Guerre»
La Franc-Maçonnerie se maintient hors d'Afrique
Relance, après la guerre, des loges coloniales en
Afrique
Point d'orgue : Cameroun, Syrie-Liban, Maroc
Les loges coloniales dans les structures
obédientielles
Prolongement des options des loges sur le plan
profane
Les Francs-Maçons et le parti colonial
L'action des Francs-Maçons dans leurs Orients

Les loges coloniales pendant la
Première « Grande Guerre »
En 1914, l'empire colonial français
s'étend sur 14.416.000 km carrés et compte près de 48.000.000 d'habitants. Quand
la guerre éclate nombreux sont ceux qui pensent que la cohésion de cet empire,
en voie d'achèvement, ne résistera pas. La réalité est différente et il suffit
de moins de cent mille militaires, y compris les troupes au Maroc, pour
maintenir l'ordre. Non seulement les colonies ne sont pas une charge pour la
métropole mais elles fournissent une importante contribution à l'effort de
guerre.
Dans cet ensemble territorial
éloigné des combats, les loges des deux obédiences poursuivent, pour la plupart,
leurs activités ; même si certaines sont affectées par le départ de FF\
mobilisés. Elles se consacrent, essentiellement sinon uniquement, à l'effort de
guerre. De nombreuses loges envoient régulièrement des dons dans le cadre des
aides matérielles et des secours pour les victimes, maçons ou non, de la guerre.
L'effort est conséquent, l'Indochine et l'Algérie se distinguant
particulièrement, en rapport avec leur importance dans le dispositif maçonnique
colonial.
Ά la fin de la guerre, pour fêter
la victoire de 1918, les FF\
multiplient les câblogrammes, les discours, les tenues blanches auxquelles on
invite même le gouverneur et les hauts fonctionnaires profanes comme à
Fort-de-France et St-Denis. La joie exprimée est à la mesure de l'attachement et
des sentiments profonds des FF\
lointains envers la Nation et la Patrie.
Ά l'issue des hostilités, le temps
des bilans est venu : peu de loges coloniales se sont mises en sommeil. A titre
indicatif, il suffit de se pencher sur le nombre de loges que le GODF et la GLDF
administrent dans l'ensemble de l'empire, dont une très large partie en Afrique
:
|
GODF
GLDF
En 1911, 47 loges
coloniales 22
En 1925, 41 loges
coloniales 33
En 1939, 56 loges
coloniales 36 |
Ces chiffres attestent à la fois
l’ampleur de la présence maçonnique hors métropole et la prépondérance du GODF
dans les colonies, malgré la progression sensible de la GLDF entre les deux
guerres.
Sans oublier le DH, obédience mixte
récente en France, qui arrive à se glisser, de façon ultra minoritaire, à la
suite des deux obédiences masculines prépondérantes. Cependant, ces
chiffres ne doivent pas faire oublier la fragilité d'un certain nombre de loges,
à cause de la faiblesse de leurs effectifs. Enfin, ils ne sauraient masquer une
disparité géographique : le Liban et le Maroc sont les principaux bénéficiaires
de l'accroissement constaté.
La
Franc-Maçonnerie
se maintient hors d'Afrique
L'Indochine, dès avant la
Grande Guerre, avait cessé d'être une charge économique pour la métropole. La
conjoncture indochinoise est favorable, d'autant plus pour les Maçons que le F\
Varenne est Gouverneur. C'est dans ce contexte que s'opère la relance des loges,
GODF et GLDF, existant déjà avant guerre à : Hanoï, Saïgon, Hué et Phnom Penh.
Tandis que
Ho Chi Minh** lui-même
se fait initier
à Paris. Le DH fait son apparition dans la vie maçonnique locale avec, en 1923, sa loge
d'Hanoï «.Confucius
111 ».
En Nouvelle-Calédonie, où la
faiblesse de la composante démographique européenne est une constante,
l'économie locale traverse une période délicate : la richesse agricole se révèle
être un mythe et l'industrie du nickel subit les effets de la concurrence
canadienne. Dans ces conditions, les FF\
du GODF ont le mérite de maintenir en activité leur loge pendant toute la durée
des années vingt.
Efforts que font également, à
Tahiti, les FF\
du GODF et de la GLDF, eux aussi menacés d'un manque d'effectifs suffisants,
pour ouvrir leurs travaux, en raison des difficultés de recrutement.
Ά Madagascar, les FF\
s'évertuent à conserver leur potentiel de loges aux effectifs souvent réduits.
En 1925 à Tamatave, « La Côte Est » n'est jamais, chronologiquement, que
la troisième loge du GODF dans cet Orient ; ce qui est indicatif de la peine
qu'éprouve la Maçonnerie à s'ancrer en territoire malgache. Dans cette île
vaste, il n'y a, toutes obédiences confondues, que quatre Orients dotés de loges
: Tananarive, Tamatave, Diego Suarez et, de façon sporadique, Majunga.
Ά la Réunion, la loge « l'Amitié
», après avoir fêté la Victoire en 1918 dans une large extériorisation, reprend
ses activités. En particulier les FF\
se mobilisent pour le maintien de l'article 9 du Senatus Consulte du 3 mai 1854,
réglant la constitution organique des colonies des Antilles et de la Réunion.
Les FF\
prescrivent que le commandement général et la haute administration restent
confiés à un gouverneur sous l'autorité directe du ministre des Colonies. L'île
restant ainsi dans la perspective ouverte par les Antilles qui réclament
l'assimilation.
En Martinique, les FF\
du GODF participent à la mise en place par la GLDF, en 1921, de la loge « Les
Disciples de Pythagore 485 » pour assurer à Fort-de-France la représentation
du rite écossais. Cette entente locale se manifeste, en 1925, lors du Congrès
commun que ces loges provoquent pour défendre le principe de
départementalisation. Dans le même esprit d'entente, les FF\
du GODF aideront, en 1929, le DH à ouvrir la loge «.L'Emancipation
Féminine », toujours à
Fort-de-France où se concentrent les forces vives de la Franc-Maçonnerie.
En Guadeloupe, l'élan est
moindre ; une disparité s'instaure entre les deux îles antillaises. Ici, les FF\
de la GLDF, privés du volontarisme du F\
Légitimus décédé, traversent des moments préoccupants pour leur loge. Au GODF,
les deux loges se relèvent difficilement de la Grande Guerre et le rayonnement
politique du F\
Boisneuf - fils d'esclave affranchi il est devenu député - ne change rien à
l'affaire. Le cyclône de 1928 vient même aggraver la situation en mobilisant
les FF\
à la recherche d'un nouveau local.
En Guyane, la guerre a été
fatale à la loge que le DH avait installée quelques années avant ; l'obédience
mixte disparaît de la colonie. Par contre, la loge du GODF perdure tandis que, à
partir de 1926, celle de la GLDF se double, momentanément, de « La Ruche
Ecossaise 549 » à l'Orient de St Laurent du Maroni.
Le sentiment dominant, à l'analyse
de chacun de ces Orients, est que les FF\
doivent, pour maintenir leurs activités, compenser leur petit nombre par un
engagement individuel permanent.
Relance, après la guerre, des loges
coloniales en Afrique
Au Sénégal, les deux loges
du GODF, à Dakar et St-Louis, poursuivent leurs activités. Surtout celle de
Dakar grâce au rayonnement de la ville, capitale de l'AOF. La GLDF n'arrive pas
à s'implanter dans la colonie tandis que « La Nouvelle Aurore » - créée
par le DH à Dakar en 1922 - s'essouffle à peine installée.
En Côte d'Ivoire, la GLDF
est prise de vitesse par le GODF qui, en 1930 allume les feux de « La
Fraternité Africaine » à Abidjan. Les FF\,
dont le noyau est constitué de fonctionnaires, sont en effet à pied d'œuvre dans
cette ville promue au rang de chef-lieu.
En Guinée, au contraire, la
GLDF réussit son premier essai dans la région. En 1916, en pleine guerre, elle
trouve les ressources humaines suffisantes pour allumer les feux de la loge «
Etoile de Guinée 468 » à Conakry, ville où le GODF n'avait pu se
maintenir juste avant la guerre.
Au Congo-Brazzaville, la
loge du GODF reste exemplaire de cette problématique : seule en place, elle ne
laisse pas d'espace disponible pour la GLDF. Le nombre limité d'Européens et
les interventions de l'Eglise sont des freins réels au rayonnement maçonnique et
il n'est pas possible de multiplier les Ateliers. La première obédience arrivée
a toutes les chances d'exercer un monopole dans le territoire.
Dans toutes ces colonies, donc, il
se confirme que l'installation des loges ne peut se faire en nombre. Cela tient
essentiellement à la faiblesse du peuplement européen, donc à la difficulté
d'avoir une masse d'impétrants. D'autant plus que la pression de l'Eglise sur
la société européenne limite encore davantage les possibilités de recrutement
par les Francs-Maçons.
Ά contrario, en Afrique
Méditerranéenne, la GLDF et le GODF peuvent se côtoyer, se concurrencer, car il
y a là un peuplement suffisant pour garnir les colonnes de nombreuses loges. Le
DH lui-même participe au mouvement.
En Tunisie, les deux
obédiences veillent sur la pérennité de leur réseau dont le centre est Tunis,
avec : pour le GODF « Nouvelle Carthage et Salammbô Réunis » -
les deux loges ayant fusionné en 1919 - et pour la GLDF « Volonté »
doublée de «.Véritas
351 » venue de
l'obédience italienne mise à l'index par les fascistes de Rome. Ά ces loges
vient s'associer « Henri Périès 201 » du DH, première loge du Droit
Humain en Afrique.
L'Algérie
garde une position dominante dans cet ensemble colonial, avec Alger comme pièce
maîtresse. Le GODF, avec ses 21 loges, se taille la part du lion, sans pourtant
accroître son potentiel entre 1918 et 1939. Son réseau de loges couvre une
grande partie du territoire et sa loge doyenne «
Bélisaire
», à Alger,
continue d'être une référence, avec deux cents inscrits et des travaux de
qualité. La GLDF atteint les 11 loges : des ateliers, même modestes, voient le
jour à Oran, Tizi-Ouzou, Philippeville, Constantine, Batna. Sa loge « Le
Delta 225 » à Alger, comme sa rivale du GODF, possède deux cents
inscrits [la taille numérique des deux loges d'Alger est exceptionnelle] et
produit des travaux intéressants.. Le Droit Humain, enfin, ouvre 3 loges : «
la Lumière Africaine 203 », la plus ancienne, à Philippeville, la « 206
» à Alger et la « 209 » à Constantine. A cet ensemble maçonnique, déjà
étoffé, viennent s'adjoindre : 1 loge du rite de Memphis-Misraïm et 1 loge de
l'Ordre Martiniste.
Point d'orgue : Cameroun,
Syrie-Liban, Maroc
La paix revenue, il n'y a pas -
pour sauvegarder la déclaration du Président Wilson - d'annexions aux dépens de
la puissance vaincue mais on instaure le système des mandats qui permettent aux
« Nations Développées » d'exercer une « tutelle en qualité de mandataires et au
nom de la Société des Nations ». C'est dans ce cadre que les traités donnent à
la France des territoires nouveaux à gérer : Togo, Cameroun et Syrie-Liban.
Le Cameroun, colonie
allemande placée en 1919 sous mandat français, est l'objet, dès 1924, d'une
tentative précoce d'installation de loge par la GLDF. C'est un échec parce que
le recrutement n'est pas encore assuré. Dès lors, en 1933, la voie est libre
devant le GODF dont « La Lumière du Cameroun » réussit grâce à des
fonctionnaires arrivés progressivement pour assurer l'administration directe en
honneur dans l'Empire Français.
La zone Syrie-Liban passe, au
traité de San Remo en 1920, sous l'autorité de la France. La prise
en main de cette région est rendue délicate par l'attitude de l'Angleterre qui
veille à son pétrole du Moyen-Orient.
Au Liban, deux
dates matérialisent les débuts de la Franc-Maçonnerie : 1861 avec un
Atelier de la Grande Loge Ecossaise et 1869 avec « Le Liban » du GODF.
Les loges, constituées en majorité de Libanais, font ouvertement appel aux
obédiences étrangères et aux puissances tutélaires coloniales potentielles pour
déjouer la main mise de la Sublime porte et atténuer la violence ethnique qui
secoue périodiquement le pays. Les FF\
Libanais sont très attentifs, en outre, à deux éléments discordants de la vie
publique locale : la misère et la violence. Lorsque le mandat français est
institué, le GODF accroît sa présence par des loges, souvent précaires, à :
Harissa en 1922, « Le Cèdre du Liban » à Souk-el-Gharb en 1922, Tripoli
en 1923 et Beyrouth en 1925. La GLDF n'est pas moins active : « La Sagesse
493 » à Beyrouth en 1921, une loge à Baalbek en 1922, à Tripoli en 1924 et
une seconde à Beyrouth en 1927.
En
Syrie, le GODF a fait son
apparition en deux temps. Dès 1864, l'Emir Abd el Kader, en exil forcé à Damas,
est reçu Franc-Maçon, mais il reste un cas isolé. En 1866, par contre, c'est une
loge « Union des Peuples » qui prend place à Rayak. Cependant, ce n'est
qu'après la Grande Guerre que l'influence de l'obédience s'étend, grâce à trois
nouvelles loges : à Homs en 1921 « La Fleur de l'Oronte », à Damas
en 1927 et à Rayak en 1936. La GLDF, venue plus tardivement, se montre, à son
tour, très entreprenante : à Damas en 1922 « Kaynoun 506 », à Alep en
1922, à Margehyoun en 1924, à Hasbaya en 1924, à Hama en 1925, à Lattaquié en
1927 et à nouveau à Damas en 1931.
Toutes ces loges du Liban et de
Syrie, souvent éphémères, bénéficient de l'engouement des bourgeoisies locales.
Situation atypique en matière de loges coloniales car, partout ailleurs, elles
n'attirent pas les populations autochtones.
Au Maroc, le Protectorat à
peine signé, en 1912, les FF\
GODF de Tanger et Casablanca voient leur élan stoppé par la Grande Guerre. Il
faut attendre 1918 pour que la dynamique reprenne, d'abord en concurrence avec
les FF\
Espagnols puis en accord avec eux. Très vite cette concurrence est remplacée par
celle entre le GODF et la GLDF.
L'implantation s'opère, dans un
premier temps, le long de la côte Atlantique puisque l'intérieur n'est pas
encore « pacifié ». Ά Rabat dès 1918 le GODF allume les feux de sa troisième
loge au Maroc « Le Réveil du Maghreb » tandis que la GLDF fait la
première intrusion à Marrakech en 1919 avec « Léon Gambetta 474 ». Puis,
pour l'une et l'autre obédience, c'est à qui s'installe à Mogador, Mazagan,
Safi, Agadir, Kénitra et aussi à Meknès, Fez, Taza, Oujda c'est à dire sur l'axe
de pénétration coloniale qui mène vers l'Algérie : les créations se font au fur
et à mesure de la prise en main du territoire par les autorités françaises et de
l'arrivée de fonctionnaires et de commerçants européens. Une trentaine de loges
pour les deux obédiences - plus la loge « Minerve 207 » du DH
et les nombreux ateliers espagnols - donnent au Maroc un réseau maçonnique de
forte densité.
Le peuplement européen, après le
départ de Lyautey, a autorisé cet essor maçonnique au point de donner à la
Franc-Maçonnerie du Maroc, aux côtés de celle d'Algérie, un poids éminent dans
la représentativité coloniale. Car, maintenant, ce problème se pose de façon
cruciale.
Les loges coloniales dans les
structures obédientielles
Il est évident que le maintien des
loges dans toute une partie du dispositif colonial et la montée en puissance des
ateliers en pays méditerranéens renforcent le besoin d'une structure
particulière au sein des obédiences.
Le schéma général prend en compte
à la fois le législatif et l'exécutif des obédiences concernées. Des Congrès
Régionaux donnent la possibilité d'une concertation des loges coloniales et
renforcent l'impact de leurs vœux regroupés, au moment du convent. Par ailleurs
on procède à l'élection d'un représentant «.colonial
» au sein de l'Exécutif et une Commission du Convent - permanente ou non - qui a
pour objet de suivre les problèmes.
Dès l'avant guerre, les initiatives
prises allaient dans ce sens : la « réunion inter obédientielle » d'Algérie -
associée à l'Oranie et à la Tunisie - ou encore le « Congrès Régional des loges
Coloniales et Etrangères », réalisé à Port-Louis la première fois et poursuivi à
St-Denis de la Réunion.
Ά peine la guerre terminée, le GODF
institue en septembre 1919 un « Comité des Loges d’Outre-Mer » qui
deviendra « Comité permanent des loges des colonies et de l'Etranger
». La GLDF créera, quelques années plus tard, une « Commission Coloniale ». En
1922, un « Congrès des loges coloniales » est institué par le GODF dont les
loges syriennes organisent, en 1924, un Congrès maçonnique Syrien. En 1924, les
« Réunions inter-obédientielles » vont se renforcer, par l'adjonction
de « Congrès des Loges de l'Afrique Française du Nord » GODF et GLDF.
Le Maroc, qui tient son propre congrès pour la première fois en 1925, décide de
s'y associer. Schéma en harmonie avec l'esprit du moment puisque, dans le monde
politique, les Conférences Nord-Africaines réunissent dorénavant le Gouverneur
de l'Algérie et les Résidents du Maroc et de la Tunisie. Cette même année 1925,
les loges de la Martinique convoquent leur Congrès Régional. C'est dire si le
mouvement général porte à la volonté de structuration de la part des loges
coloniales. Les FF\
éloignés manifestent, de la sorte, leur souci de démontrer la spécificité des
situations locales auxquelles ils pensent pouvoir répondre de façon plus
qualifiée.
La mise en place d'une structure
représentative des loges coloniales est complétée, il faut le rappeler, par
l'élection de Conseillers de l'Ordre auprès du GODF et de Conseillers Fédéraux
auprès de la GLDF. Ainsi, les FF\
des colonies sont dorénavant assurés d'un suivi de leurs préoccupations par les
obédiences qui ont intégré la dimension coloniale dans leur mode de
fonctionnement. Face à d'autres courants d'idées - principalement celui que
représente la « Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi », véritable
ministère des missions apostoliques - la Franc-Maçonnerie s’est elle-même
organisée pour défendre une politique d’accompagnement en matière coloniale,
dans le sens qu'elle souhaitait. Action qui pourtant a ses limites si l'on en
juge, par exemple, à ce qui est advenu du projet Viollette, sans lendemain.
Prolongement des options des
loges sur le plan profane
La question se pose de savoir si
les propositions des loges coloniales, ainsi renforcées au sein des obédiences,
ont eu des chances d'être prises en considération sur la plan politique. Il est
difficile de préciser ce qui l'en est réellement. On peut simplement noter que
dans le monde profane de nombreux FF\
sont en charge du dossier des colonies, en précisant bien que « le Maçon est
libre dans une loge libre », donc libre de son action dans le cadre de ses
fonctions politiques ou administratives.
Au
Ministère des Colonies, la liste
des ministres successifs comprend les FF\
Hesse 1925, Perrier 1926, Dalimier 1933 ; à qui s'ajoutent Sarraut et Steeg très
proches des milieux maçonniques au point que les FF\
les considèrent souvent comme tels. En 1929, un Sous-Secrétariat d'Etat aux
colonies est institué. Vont s'y succéder les FF\
Delmont de la Martinique 1929, Archimbaud 1930, Diagne du Sénégal 1931, Candace
de la Guadeloupe 1932, Brunet de la Réunion 1933, Dalimier 1934, Monnerville de
Guyane 1937.
Dans la liste des
Gouverneurs
Généraux des colonies, pendant la période d'une vingtaine d'années de
l'entre-deux-guerres, les noms de FF\
ne manquent pas. En Algérie : Steeg 1921, Viollette 1925, Carde 1930, Le Beau
1935 qui assurent à eux quatre un total de seize ans. En AOF : Merlin 1919,
Carde 1923, de Coppet 1936 soit pendant seize ans également. En AEF : Angoulvant
1918, Augagneur 1920, Reste 1935, soit quinze ans. C'est-à-dire, pour toute
cette partie de l'Afrique, environ les deux tiers de la période concernée. En
Indochine, la présence de Gouverneurs maçons tombe à onze années avec : Sarraut
1916, Long 1919, Merlin 1923, Varenne 1925. A Madagascar, cinq ans pour les FF\
Merlin 1917, Schrameck 1918, Brunet 1923, de Coppet 1939. Dans les
Etablissements Français de l'Inde, le F\.Juvanon
en 1930. Il est à remarquer que certains noms se retrouvent d'une colonie à
l'autre, au gré d'une carrière coloniale.
D'autres FF\
occupent des postes de Gouverneurs d'un pays, en tant que représentants du
Gouverneur Général. Quelques exemples : Estèbe gouverneur de l'Oubangui, du
Congo puis de la Réunion, Eboué nommé au Gouvernement Général de la Guadeloupe
puis Gouverneur du Tchad.
Dans les Protectorats, il faut
noter la présence de FF\
parmi les
Résidents Généraux successifs. En Tunisie : Flandin 1918 et Peyrouton
1933. Au Maroc : Steeg 1925 et Peyrouton 1936.
Pour se faire une idée plus large,
il faudrait ajouter tous les FF\
responsables d'administrations locales - directement en contact avec les
Gouverneurs ou les Résidents Généraux - et prolongeant leur action sur le
terrain. Il faudrait également faire le relevé de tous les députés maçons
participant aux commissions parlementaires, ayant trait d'une façon ou l'autre
aux affaires coloniales, et susceptibles d'avoir pris connaissance des avis
énoncés par les loges hors métropole.
Les « vieilles colonies » ne sont
pas en reste avec leurs députés fréquemment maçons. La Martinique envoie d'abord
Lagrosillière et Sévère puis Delmonte et Frossard. La Guadeloupe, sur le premier
siège de député, réélit constamment Candace tandis que, sur le second siège,
Satineau remplacera Boisneuf après un bref intermède non maçonnique. La Guyane
fait confiance successivement à Grodet, Lautier et Monnerville. Le Sénégal
envoie à Paris Diagne. La Réunion renouvelle continuellement sa confiance à
Gasparin et sur le second siège Boussenot et Brunet se succèdent. Les Indes ont
également, pendant quelques années, leur député maçon : Coponat.
L'Algérie ne connaît pas la même
représentation maçonnique hégémonique. Seul Thomson de Constantine sera
constamment réélu tandis que, sur le reste du territoire, se suivront Cuttoli,
Etienne, Petit et Régis.
Les Francs-Maçons et le parti
colonial
L'action de chacun de ces députés
est sensible dans les commissions parlementaires mais certains sont plus actifs.
Ils se mobilisent pour développer, dans la société civile, la place accordée aux
colonies - Gratien Candace est certainement le plus actif, au
point d'être considéré comme le continuateur de l'action de Etienne. Il est le
fondateur du « Comité d'aide et d'assistance coloniale » et du « Foyer Colonial
» pour les anciens combattants des colonies. En 1918 il participe, avec l'aide
de Etienne, à la fondation de l'Institut Colonial Français devenu par la suite,
avec Delmont et Bérenger, l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer. Il anime
pendant de longues années la « Section des Colonies d'Amérique et du Pacifique »
et fonde, avec Bérenger, la revue Colonies et Marine - Alcide
Delmont, pour regrouper les Martiniquais présents en métropole, se lance
dans la création du « Dîner de la canne à sucre » qu'il réunit une fois par
mois. Il est en outre président de « La Solidarité coloniale ». Il ne cesse
d'intervenir à la Chambre des députés sur les problèmes économiques coloniaux -
Georges Barthélémy, syndic influent de la presse coloniale, est
directeur politique de La Gazette Coloniale et de L'Empire Français.
Il fonde « La Fédération Française des Anciens Coloniaux » puis « La Fédération
des Associations et Syndicats de Fonctionnaires Coloniaux »
Ainsi se perpétue et se consolide,
avec la participation de Francs-Maçons, le groupe colonial animé avant guerre
par Etienne, selon les mêmes méthodes qui allient les milieux économiques, les
hommes politiques et la presse.
L'action des Francs-Maçons dans
leurs Orients
Une fois assurée leur audience en
métropole, une autre des préoccupations constantes des ateliers des colonies
porte sur les rapports établis avec les Gouverneurs dont l'autorité est
incontournable. Les courriers adressés aux Obédiences à Paris sont révélateurs
de la diversité des situations. Pour certains d'entre eux - Lyautey au Maroc
pour ne citer que lui - leur remplacement est demandé.. Pour d'autres - Varenne
en Indochine par exemple - leurs initiatives sont fortement approuvées et
défendues si nécessaire. Mais quels qu'ils soient, leurs faits et gestes ne sont
jamais passés sous silence.
Partout, les FF\
- « Hommes dans la Cité » - deviennent des militants fortement engagés. Avec
beaucoup de constance, les FF\
coloniaux des trois obédiences vont relancer les thèmes qui leurs sont chers.
Ils font en sorte que leurs propositions soient prises en considération dans
leurs Orients respectifs. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à défendre ou mettre
en pratique leurs idées dans les associations qu'ils animent sur le plan profane
: la Ligue des Droits de l'Homme en particulier. Sans oublier toute association
- la Ligue de l'Enseignement, les Caisses des écoles, les Coopératives
scolaires, etc. - qui gravite autour de l'école. Car pour eux l'école est au
cœur de la « colonisation humaniste ».
Les FF\
sont également très vigilants quant au rôle joué par la presse et à l'influence
qu'ils peuvent y avoir. Nombre d'entre eux sont rédacteurs, certains même sont
propriétaires de petits journaux locaux. Quand ils n'ont pas cet accès direct à
la presse locale, ils font passer des communiqués. A titre individuel, les FF\
militent dans les Chambres de commerce ou d'agriculture, les syndicats, les
mutuelles. Ils expriment largement leurs opinions politiques, essentiellement au
parti radical et au parti socialiste quand ces partis existent sur place. Ils
participent activement à l'administration des municipalités, certains accèdent
au poste de maire et, de là, à celui de sénateur ou député. Quelques noms : en
Algérie Aubry de Sétif, à la Réunion Benard de St-Louis et Gasparin de St-Denis,
à Madagascar Estèbe de Tananarive et futur GM\
du GODF, en Guyane Monnerville de Cayenne…
En un mot, les Francs-Maçons des
colonies ne se contentent pas de l'information et de l'action dirigées vers la
métropole, ils sont présents dans la cité.
Retour Haut de Page