CHAPITRE III
La crise du système colonial
sous la Révolution
Le profil, en 1789, de la Franc-Maçonnerie dans les colonies
La question de l'esclavage et la_"Société des Amis des Noirs"
Les décisions des "Hommes de_la_Révolution" en matière coloniale
Les conséquences de la Révolution dans les colonies de l'Océan indien
Les conséquences de la Révolution dans les colonies des Antilles
Première diaspora des FF\
"émigrés" des Antilles Françaises
De Grasse-Tilly : Homme du XVIIIè siècle, attiré par le mouvement et les grades
.

Le profil,
en 1789, de la Franc-Maçonnerie dans les colonies
Si en France, depuis quelques
années, les effectifs des loges ont considérablement diminué, il n'en va pas de
même aux colonies. Dans une société du XVIII° siècle, à la recherche de cercles
d'idées, l'absence de salons, clubs et académies, dans ces îles lointaines, n'a
pu que favoriser l'éclosion de loges, lieux uniques de rencontres de ce type.
Les Ateliers se sont donc développés, malgré de nombreux handicaps :
Malgré les calamités
naturelles qui ne les ont pas épargnées et les épidémies chroniques. Malgré la
petitesse des villes, les difficultés et l'insécurité des chemins pour les FF\
éloignés à l'intérieur des terres. Malgré le va-et-vient perpétuel et les
absences renouvelées des FF\
« pérégrins » capitaines de navire, négociants ou militaires.
Malgré l'éloignement de la
Métropole. Compensé par le choix obligé d'un député qui atténuait quelque peu
le manque de contact avec les responsables de l'obédience à Paris. Compensé par
la présence des deux ou trois cents FF\
à Paris ou dans les ports qui, par leur origine ou leur état, avaient des
intérêts dans les îles. Compensé également par la protection d'un duc de
Chartres ou d'un duc de Luxembourg et de façon plus directe d'un Bacon de la
Chevalerie qui séjourna et se maria à St-Domingue, de gouverneurs généraux ou
particuliers des colonies, d'intendants, de commissaires généraux des colonies…
Par contre, l'éloignement de
la Métropole a favorisé l'éclosion de loges sauvages qui ne se soucièrent pas
toujours de se faire régulariser. Régulières ou non, elles ont permis à Bordeaux
et Marseille, entre autres, d'implanter leur propre rite ; à des esprits
ingénieux d'y inventer des grades, des régimes ou des systèmes (Morin** et de
Grasse Tilly** en sont des exemples). De sorte que les colonies ont été un creuset
de réflexion en matière rituellique.
Enfin, la proximité d'îles
anglaises et hollandaises, l'esprit « cosmopolite » de cette société des
Lumières, les aléas des occupations ont entraîné maintes fondations sous la
responsabilité d'obédiences diverses. L'unité et la régularité ont pu en pâtir
mais, à l'inverse, la vitalité maçonnique en a bénéficié.
Cet univers maçonnique, reflet de la
sociabilité du XVIII°,,
transplanté aux colonies, est ouvert, en priorité sinon exclusivement, aux
grands Blancs, par la naissance, les titres ou la fortune. Cela explique en
partie que chaque loge veuille son chapitre, sinon son conseil ou même son
consistoire.
Il y a là, comme dans la
période précédente, une majorité de citadins - marins, militaires, magistrats,
officiers, membres du clergé, négociants - le plus souvent nés en Métropole. Les
créoles, parfois « propriétaires » , sont une minorité. Le mouvement d'ouverture
aux bourgeois, constaté en Métropole depuis quelques années, n'a pas sa place
ici. Les petits Blancs ne sont pas admis ou tarderont à l'être, les mulâtres et
les Noirs sont exclus.
La
question de l'esclavage et la Société des Amis des Noirs
Le problème crucial que posent
les colonies est, sans conteste, celui de la population noire et de l'esclavage.
A la fin de l'Ancien Régime le rapport entre Blancs et Noirs est de 1 pour 4 aux
Mascareignes et de 1 pour 10 aux Antilles.
 La
question est soulevée, dès 1788 en France, par la «
Société
des Amis des Noirs», face aux propriétaires de
plantations et aux nobles, esclavagistes, qui, en réponse, vont se réunir à
l'Hôtel Massiac.
La
question est soulevée, dès 1788 en France, par la «
Société
des Amis des Noirs», face aux propriétaires de
plantations et aux nobles, esclavagistes, qui, en réponse, vont se réunir à
l'Hôtel Massiac.
Les Francs-Maçons, à
considérer les cas notoires, sont avantageusement représentés dans la «
Société des Amis des Noirs » : Brissot de Warwille, membre fondateur, est rapidement
rejoint par les FF\La Fayette**,
Mirabeau**,
St George**, (l'appartenance de Condorcet et de l'abbé
Grégoire à la Franc-Maçonnerie reste à prouver). Mais il faut se garder de
conclure à une harmonie intellectuelle et philosophique entre anti-esclavagisme
actif et Franc-Maçonnerie.
En effet le nombre de FF\
négriers et colons, dont certains membres du
club Massiac, atteste de la
présence également, dans les loges, d'un courant favorable à l'esclavage. En
même temps, l'expansion des loges dans les colonies confirme que l'appartenance
à la Maçonnerie n'est pas perçue comme incompatible avec la traite et
l'esclavage. Il est clair que le fait maçonnique a atteint un tel taux de
pénétration dans les élites de l'époque que toutes les options idéologiques et
tous les intérêts sociaux s'y croisent.
Pour les anti-esclavagistes,
largement minoritaires, il s'agit de convaincre le Ministère de la Marine de
s'associer au mouvement de condamnation de la traite lancé par l'Angleterre. Ils
demandent une législation abolitionniste progressive pour faire passer, par
paliers, à la liberté ; il y a là, un souci de ne pas bouleverser les économies
coloniales et de permettre une lente « régénération » des esclaves.
Les
décisions des « Hommes de la Révolution » en matière coloniale
 La question de l'esclavage
n'est pas unique concernant le dossier colonial. Bien sûr, l'opinion publique a
bien d'autres soucis que ce qui s'y passe : en 1789, sur mille deux cents
quarante trois cahiers de doléances, deux cents dix huit en parlent et quarante
quatre seulement abordent l'esclavage. Pourtant, dans la mesure où il n'est pas
envisager de se retirer des colonies, trois grandes questions se posent aux
Hommes de la Révolution et aux Francs-Maçons :
La question de l'esclavage
n'est pas unique concernant le dossier colonial. Bien sûr, l'opinion publique a
bien d'autres soucis que ce qui s'y passe : en 1789, sur mille deux cents
quarante trois cahiers de doléances, deux cents dix huit en parlent et quarante
quatre seulement abordent l'esclavage. Pourtant, dans la mesure où il n'est pas
envisager de se retirer des colonies, trois grandes questions se posent aux
Hommes de la Révolution et aux Francs-Maçons :
Doit-on supprimer
définitivement et complètement les survivances de
l'Exclusif ? Accorder
l'égalité des droits aux Hommes Libres de couleur ? Abolir l'esclavage ou tout
au moins la traite ?
Sur le plan économique, la Constituante abolit la liberté commerciale avec les Indes, le Sénégal mais
maintient l'Exclusif avec l'étranger. La Convention supprime les Compagnies de
colonisation et les douanes entre les colonies et la Métropole mais, par l'acte
de Navigation de 1793, elle décrète que tout le commerce colonial doit se faire
sous pavillon français : l'Exclusif est remplacé par le Protectionnisme.
Sur le plan humain, le
principe fondamental de l'assimilation, effleuré par l'Ancien Régime, est
affirmé. Cependant les réalités vont être autres. Le sort des Hommes Libres de
couleur est abandonné, en 1791, aux assemblées locales qui sont régies par les
grands Blancs. Le sort des esclaves est réglé plus difficilement encore. La
Constituante n'y touche pas, la
Législative non plus,
mais, en 1792, elle compense un peu cet abandon masqué en leur accordant
les droits politiques. En 1794, pour avoir l'appui des Noirs contre les Anglais,
la
Convention
vote
l'abolition mais, par la suite, sous la pression des grands Blancs, accepte le
principe du travail obligatoire.
Les
conséquences de la Révolution dans les colonies de l'Océan indien
Si, au travers de ces
approches prudentes et contradictoires, l'idée de l'assimilation se précise, il
n'en reste pas moins vrai que tous ces atermoiements favorisent des réactions
sur le terrain. La problématique des îles colonisées est posée mais non résolue,
d'où des tensions sur place entre les différents groupes ethniques et sociaux.
La Franc-Maçonnerie n'en est pas exempte.
Les Mascareignes, bien que
concernées par la problématique générale des îles tropicales françaises, ne sont
l'objet que de faibles remous sociaux et que d'un intérêt secondaire de la part
des Anglais.
 Ά l'île Bourbon, compte
tenu des circonstances et des tensions dans l'île, l'activité maçonnique est
pratiquement en sommeil de 1790 à 1795. Que ce soit sur décision du gouverneur
pour la loge de St-Denis ou que ce soit sur décision souveraine de la Grande
Loge provinciale. Entre temps l'île a pris le nom de la Réunion, comme en écho à
la loge « L'Heureuse Réunion » de St-Paul.
Ά l'île Bourbon, compte
tenu des circonstances et des tensions dans l'île, l'activité maçonnique est
pratiquement en sommeil de 1790 à 1795. Que ce soit sur décision du gouverneur
pour la loge de St-Denis ou que ce soit sur décision souveraine de la Grande
Loge provinciale. Entre temps l'île a pris le nom de la Réunion, comme en écho à
la loge « L'Heureuse Réunion » de St-Paul.
 Ά l'île de France, les
Ateliers traversent sans trop en souffrir les épisodes de la Révolution.
L'adaptation aux évolutions en cours est indiscutable. Dans cette Maçonnerie,
jusque là très sélective, la loge « Quinze Artistes », née en 1792 est
animée par des marchands et une douzaine de maîtres artisans. Son succès est tel
que ses effectifs, un an après son inauguration, se chiffrent à cent vingt
huit FF\.
«
La Triple Espérance » cependant continue à faire sentir son influence
en initiant des tentatives de loges : aux Seychelles en 1793, à Madagascar en
1798, à Chandernagor en 1803.
Ά l'île de France, les
Ateliers traversent sans trop en souffrir les épisodes de la Révolution.
L'adaptation aux évolutions en cours est indiscutable. Dans cette Maçonnerie,
jusque là très sélective, la loge « Quinze Artistes », née en 1792 est
animée par des marchands et une douzaine de maîtres artisans. Son succès est tel
que ses effectifs, un an après son inauguration, se chiffrent à cent vingt
huit FF\.
«
La Triple Espérance » cependant continue à faire sentir son influence
en initiant des tentatives de loges : aux Seychelles en 1793, à Madagascar en
1798, à Chandernagor en 1803.
 Ά Pondichéry, la
problématique est différente car les Anglais s'y intéressent. Les activités
reposent sur trois loges dont la dernière est ouverte en 1792, essentiellement
composée d'officiers de l'armée de terre et de la Marine. Cette intense activité
maçonnique cesse brutalement, en 1793, avec la chute de la ville qui se rend aux
Anglais, à l'annonce de la mort du roi en France. Aussitôt, l'assemblée
coloniale donne l'ordre de la reddition au gouverneur.
Ά Pondichéry, la
problématique est différente car les Anglais s'y intéressent. Les activités
reposent sur trois loges dont la dernière est ouverte en 1792, essentiellement
composée d'officiers de l'armée de terre et de la Marine. Cette intense activité
maçonnique cesse brutalement, en 1793, avec la chute de la ville qui se rend aux
Anglais, à l'annonce de la mort du roi en France. Aussitôt, l'assemblée
coloniale donne l'ordre de la reddition au gouverneur.
Les conséquences de la Révolution dans les colonies des Antilles
Aux Antilles les tensions sont
vives : agitation autonomiste et séparatiste des grands Blancs, insurrection des
Hommes Libres de couleur, soulèvement des esclaves. A quoi s'ajoute, pour
certaines îles, l'occupation par les Anglais une fois la guerre déclarée.
 Ά St-Domingue, la
problématique coloniale atteint son point culminant. La révolte des Noirs éclate
en août 1791 dans la plaine du Nord.. Un peu plus tard, la résistance organisée
par Toussaint Louverture affirme l'indépendance des Noirs. Les temples, l'un des
symboles de la domination des grands Blancs, sont incendiés. Des FF\
sont tués tandis que d'autres choisissent l'exil. Quelques rares FF\
maintiennent une activité clandestine et opèrent les premières initiations de
Noirs : G.J. Bonnet, L..Dieudonné.
Jusqu'en 1798, les contacts sont interrompus avec le Grand Orient, lui-même en
sommeil de 1793 à 1797.
Ά St-Domingue, la
problématique coloniale atteint son point culminant. La révolte des Noirs éclate
en août 1791 dans la plaine du Nord.. Un peu plus tard, la résistance organisée
par Toussaint Louverture affirme l'indépendance des Noirs. Les temples, l'un des
symboles de la domination des grands Blancs, sont incendiés. Des FF\
sont tués tandis que d'autres choisissent l'exil. Quelques rares FF\
maintiennent une activité clandestine et opèrent les premières initiations de
Noirs : G.J. Bonnet, L..Dieudonné.
Jusqu'en 1798, les contacts sont interrompus avec le Grand Orient, lui-même en
sommeil de 1793 à 1797.
 Ά la Guadeloupe, les FF\
procèdent encore à
l'allumage de six loges ou chapitres entre 1789 et 1792. Mais les divisions
entre les Blancs, l'insurrection des Noirs et la courte incursion des Anglais
entraînent la fermeture des loges. La reconquête de l'île par Hugues ne
s'accompagne pas d'une reprise des travaux qui ne se fera qu'en 1798 seulement.
Ά la Guadeloupe, les FF\
procèdent encore à
l'allumage de six loges ou chapitres entre 1789 et 1792. Mais les divisions
entre les Blancs, l'insurrection des Noirs et la courte incursion des Anglais
entraînent la fermeture des loges. La reconquête de l'île par Hugues ne
s'accompagne pas d'une reprise des travaux qui ne se fera qu'en 1798 seulement.
 En Martinique, la
guerre civile et le débarquement des Anglais, en 1794, mettent un terme
momentané aux activités des Ateliers. Les temples sont détruits, des FF\
sont tués, d'autres fuient et certains entrent, sur place, dans une
clandestinité dont ils ne ressortiront qu'une fois la paix signée par le
Consulat.
En Martinique, la
guerre civile et le débarquement des Anglais, en 1794, mettent un terme
momentané aux activités des Ateliers. Les temples sont détruits, des FF\
sont tués, d'autres fuient et certains entrent, sur place, dans une
clandestinité dont ils ne ressortiront qu'une fois la paix signée par le
Consulat.
Dans les îles environnantes
les loges cessent également leurs activités… Ά Marie Galante, la loge
ferme ses portes en1791, alors que les FF\
envisagent la naissance d'un second Atelier à l'Orient du Grand Bourg. La
Franc-Maçonnerie ne réapparaîtra que tardivement au XIXè siècle…
L'île Sainte Lucie - occupée par les Anglais en 1794, reprise par Hugues
puis à nouveau, en 1796, par les Anglais - perd ses quatre loges dont une seule
reprendra son cours au début du XIX° siècle.
Première
diaspora des FF\
« émigrés » des Antilles Françaises
 De tout temps, les FF\
des colonies ont été attirés par les déplacements. Cette fois, la situation
locale en fait une obligation.;
ils fuient le soulèvement quand ce n'est pas une vraie guerre civile. Ces FF\
exilés créent, dès qu'ils le peuvent, des loges dans les ports atlantiques en
relation avec les Antilles. Ils sont, en quelque sorte les« « émigrés » des
Antilles.
De tout temps, les FF\
des colonies ont été attirés par les déplacements. Cette fois, la situation
locale en fait une obligation.;
ils fuient le soulèvement quand ce n'est pas une vraie guerre civile. Ces FF\
exilés créent, dès qu'ils le peuvent, des loges dans les ports atlantiques en
relation avec les Antilles. Ils sont, en quelque sorte les« « émigrés » des
Antilles.
 Ά Trinidad, la loge «
Les Frères Unis » doit son existence et son nom à celle précédemment
installée à Ste-Lucie et fermée par les soins de Clovis Hugues. La loge se place
finalement, en 1798, sous l'obédience de la Grande Loge de Pennsylvanie.
Ά Trinidad, la loge «
Les Frères Unis » doit son existence et son nom à celle précédemment
installée à Ste-Lucie et fermée par les soins de Clovis Hugues. La loge se place
finalement, en 1798, sous l'obédience de la Grande Loge de Pennsylvanie.
 Ά Cuba, s'ouvrent les
loges « La Concorde » et « La Persévérance », qui rejoindront,
plus tard, la Nouvelle-Orléans, dans ce territoire de
Louisiane
depuis peu perdu par la France et où se maintiennent des liens avec les Antilles
Ά Cuba, s'ouvrent les
loges « La Concorde » et « La Persévérance », qui rejoindront,
plus tard, la Nouvelle-Orléans, dans ce territoire de
Louisiane
depuis peu perdu par la France et où se maintiennent des liens avec les Antilles
 Ά la Nouvelle-Orléans,
justement, où des loges se sont très tôt installées : « L'Etoile
Polaire » et « La Parfaite Union » avec l'apport des FF\
venus directement des Antilles Françaises…. Ά New-York, les FF\
allument les feux de « L'Unité Américaine.»,
sous obédience du Grand Orient de New-York. Dans le même élan, se reconstitue
sur place la Grande Loge Provinciale d'Hérédon qui s'octroie le droit
d'installer au nom du GODF, des loges, dont le chapitre « Vérité et Union
».… Ά Philadelphie, la Grande Loge de Pennsylvanie va accueillir deux de
ces loges d'exilés Français. « L'Aménité » réunit surtout des FF\
venus de St-Domingue et, comme il est fréquent à l'époque où l'on ne conçoit pas
de Franc-Maçonnerie sans Hauts Grades, la loge se prolonge d'un chapitre «
Candeur et Amitié ». La seconde loge « La Parfaite Union n° 19 »
se justifie par le nombre de transfuges venus des îles…. Ά Baltimore, le
nom de « La Vérité.» rappelle celui de
la loge d'origine des FF\fondateurs, à l'Orient du Cap Français à St-Domingue.
Ά la Nouvelle-Orléans,
justement, où des loges se sont très tôt installées : « L'Etoile
Polaire » et « La Parfaite Union » avec l'apport des FF\
venus directement des Antilles Françaises…. Ά New-York, les FF\
allument les feux de « L'Unité Américaine.»,
sous obédience du Grand Orient de New-York. Dans le même élan, se reconstitue
sur place la Grande Loge Provinciale d'Hérédon qui s'octroie le droit
d'installer au nom du GODF, des loges, dont le chapitre « Vérité et Union
».… Ά Philadelphie, la Grande Loge de Pennsylvanie va accueillir deux de
ces loges d'exilés Français. « L'Aménité » réunit surtout des FF\
venus de St-Domingue et, comme il est fréquent à l'époque où l'on ne conçoit pas
de Franc-Maçonnerie sans Hauts Grades, la loge se prolonge d'un chapitre «
Candeur et Amitié ». La seconde loge « La Parfaite Union n° 19 »
se justifie par le nombre de transfuges venus des îles…. Ά Baltimore, le
nom de « La Vérité.» rappelle celui de
la loge d'origine des FF\fondateurs, à l'Orient du Cap Français à St-Domingue.
De
Grasse-Tilly : Homme du XVIIIè siècle, attiré par le mouvement et les
grades
 Il est intéressant de rappeler
que l'un des Francs-Maçons participant à la diaspora des Antilles, et
représentatif de ce monde cosmopolite où l'interaction des rituels était vive,
est
le F\de Grasse de Tilly**.
Il est intéressant de rappeler
que l'un des Francs-Maçons participant à la diaspora des Antilles, et
représentatif de ce monde cosmopolite où l'interaction des rituels était vive,
est
le F\de Grasse de Tilly**.
Alexandre François Auguste, Comte de Grasse,
Marquis de Tilly, né en 1765, est initié le 8 janvier 1783 à Paris. Capitaine au
régiment d'infanterie du roi, il débarque à St-Domingue, fin 1789, pour
recueillir, en succession de son père décédé, une importante plantation. Loin
des événements en cours dans la Métropole, son avenir semble assuré dans les
colonies
Mais, alors qu'il vient de se marier avec la
fille d'un notaire, maître de la loge « la Vérité », la révolte des Noirs
le conduit à quitter l'île en juillet 1793. Jouant de malchance, tous ses biens
sont pillés sur le brick qui le transporte. Participant à la première diaspora,
il sera partie prenante, quelques années après, de la seconde. Sa vie
aventureuse commence et, aussi, son errance et sa créativité maçonniques. De
sorte qu'il va devenir un prototype de ces « pérégrins » de passage aux colonies
et en Amérique.
Ά Charlestone, où il débarque, il fait partie, en
1796, des membres fondateurs de « la Candeur », intégrée rapidement au
sein de la Grande Loge de Caroline. Il devient en 1798 Vénérable de cette loge,
puis en démissionne l'année suivante pour rejoindre l'autre Grande Loge, rivale,
Ancien York Masons ; il y fonde, en 1800, « la Réunion Française ».
Bien que devenu citoyen américain, sa situation
financière précaire l'oblige à reprendre ses activités dans l'armée française à
St-Domingue. A cette époque, il est porté sur le tableau des membres du «
Suprême Conseil au 33° établis aux îles françaises de l'Amérique ».
En 1803, suite à la reddition du fort Picolet, qu'il commande, Grasse-Tilly se
retrouve prisonnier des Anglais qui le libèrent, en 1804, en raison de sa
nationalité américaine.
Après un bref passage à Charlestone, il débarque
à Bordeaux. Revenu aussitôt à Paris, il constitue en novembre 1804 la Grande
Loge Générale Ecossaise qui se pose rapidement comme rivale du Grand Orient de
France. L'aventure du REAA débute en France pour se prolonger, toujours au gré
des déplacements de Grasse-Tilly, en Italie puis en Espagne.
Le F\ Morin était parti
aux Antilles avec le rite de Perfection, le F\ Grasse-Tilly en revient avec une adaptation, le Rite Ecossais Ancien [et]
Accepté étendu à trente
trois degrés. Tous deux, avec leur transfert de grades de la Métropole vers les
Colonies puis inversement, sont bien dans la logique du système colonial. Ils
ont ainsi fait, au-delà de leurs préoccupations toutes personnelles, que le
bouillonnement de rites que connaissent alors les Antilles laisse une trace et
que le système colonial ne soit pas resté étranger à l'histoire des rites de la
Franc-Maçonnerie.
Retour Haut de page
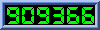




 La question de l'esclavage
n'est pas unique concernant le dossier colonial. Bien sûr, l'opinion publique a
bien d'autres soucis que ce qui s'y passe : en 1789, sur mille deux cents
quarante trois cahiers de doléances, deux cents dix huit en parlent et quarante
quatre seulement abordent l'esclavage. Pourtant, dans la mesure où il n'est pas
envisager de se retirer des colonies, trois grandes questions se posent aux
Hommes de la Révolution et aux Francs-Maçons :
La question de l'esclavage
n'est pas unique concernant le dossier colonial. Bien sûr, l'opinion publique a
bien d'autres soucis que ce qui s'y passe : en 1789, sur mille deux cents
quarante trois cahiers de doléances, deux cents dix huit en parlent et quarante
quatre seulement abordent l'esclavage. Pourtant, dans la mesure où il n'est pas
envisager de se retirer des colonies, trois grandes questions se posent aux
Hommes de la Révolution et aux Francs-Maçons : Ά l'île de France, les
Ateliers traversent sans trop en souffrir les épisodes de la Révolution.
L'adaptation aux évolutions en cours est indiscutable. Dans cette Maçonnerie,
jusque là très sélective, la loge « Quinze Artistes », née en 1792 est
animée par des marchands et une douzaine de maîtres artisans. Son succès est tel
que ses effectifs, un an après son inauguration, se chiffrent à cent vingt
huit FF\.
«
Ά l'île de France, les
Ateliers traversent sans trop en souffrir les épisodes de la Révolution.
L'adaptation aux évolutions en cours est indiscutable. Dans cette Maçonnerie,
jusque là très sélective, la loge « Quinze Artistes », née en 1792 est
animée par des marchands et une douzaine de maîtres artisans. Son succès est tel
que ses effectifs, un an après son inauguration, se chiffrent à cent vingt
huit FF\.
«  Ά Pondichéry, la
problématique est différente car les Anglais s'y intéressent. Les activités
reposent sur trois loges dont la dernière est ouverte en 1792, essentiellement
composée d'officiers de l'armée de terre et de la Marine. Cette intense activité
maçonnique cesse brutalement, en 1793, avec la chute de la ville qui se rend aux
Anglais, à l'annonce de la mort du roi en France. Aussitôt, l'assemblée
coloniale donne l'ordre de la reddition au gouverneur.
Ά Pondichéry, la
problématique est différente car les Anglais s'y intéressent. Les activités
reposent sur trois loges dont la dernière est ouverte en 1792, essentiellement
composée d'officiers de l'armée de terre et de la Marine. Cette intense activité
maçonnique cesse brutalement, en 1793, avec la chute de la ville qui se rend aux
Anglais, à l'annonce de la mort du roi en France. Aussitôt, l'assemblée
coloniale donne l'ordre de la reddition au gouverneur. 



 Il est intéressant de rappeler
que l'un des Francs-Maçons participant à la diaspora des Antilles, et
représentatif de ce monde cosmopolite où l'interaction des rituels était vive,
est
Il est intéressant de rappeler
que l'un des Francs-Maçons participant à la diaspora des Antilles, et
représentatif de ce monde cosmopolite où l'interaction des rituels était vive,
est