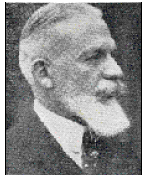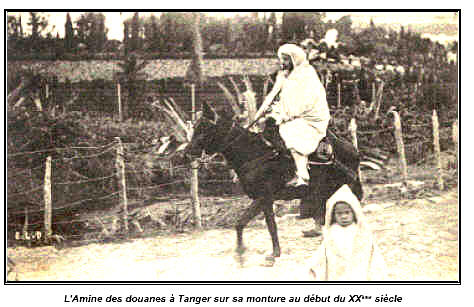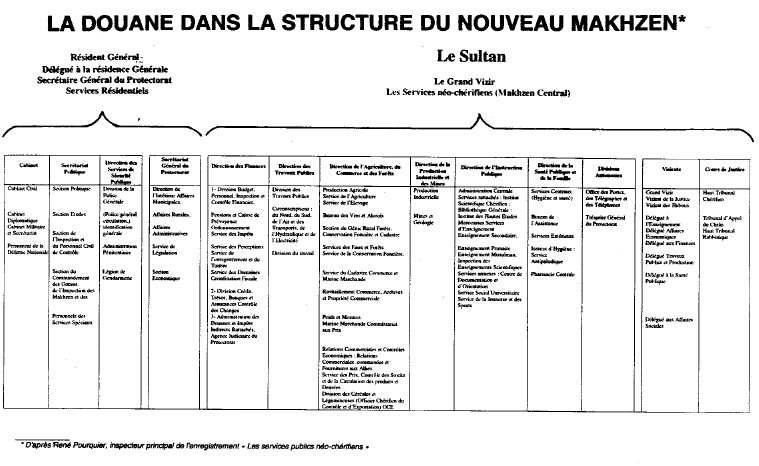|
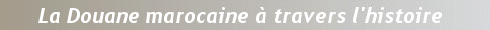
 Gautsch Gautsch

NAISSANCE DU RÉGIME
DOUANIER DU PROTECTORAT
Nous avons pu
constater que depuis l’avènement de Sidi Mohamed Ben Abdallah, le
makhzen mena une série de négociations commerciales avec les
puissances européennes. Les dispositions douanières furent de plus
en plus la clé de voûte de ce concert avec le monde extérieur. La
réglementation douanière était, à l’évidence, un véritable
instrument utilisé judicieusement par les Sultans pour éviter que le
commerce ne devienne le monopole d’une puissance déterminée. La
barrière douanière était judicieusement utilisée pour freiner la
subite et forte pénétration étrangère à l’intérieur du pays. Malgré
le développement rapide du commerce international du XIXème siècle,
le Maroc tenait à n’importer de l’Europe que les produits qui lui
étaient strictement indispensables.
Le développement du
régime de la protection consulaire, après la conférence de Madrid8
7, aida à l’installation des maisons de commerce étrangères et
facilita leur action. Le traité anglo-marocain de 18568 8 qui assura
pour de longues années la suprématie du négoce britannique, ouvrit
de plus en plus l’Empire Chérifien aux courants commerciaux
extérieurs. L’ouverture de ces brèches dans le traditionnel
isolement makhzenien aboutira à de profondes mutations dans
l’organisation administrative du pays et notamment le fonctionnement
de ses douanes.
La conférence d’Algésiras,
qui établissait l’égalité économique entre les puissances, ouvrait
officiellement le Maroc au commerce international. Mais les clauses
économiques de ce traité international ne devinrent effectives
qu’après l’établissement du protectorat.
Ainsi, le statut
douanier du Maroc sous le protectorat avait en fait été institué par
l’acte d’Algésiras en 1906. Ce traité instaura dans son article
premier le principe de la stricte égalité économique pour toutes les
importations. Quelle que soit leur origine ou leur provenance, les
marchandises entrant au Maroc par mer étaient soumises à un droit de
10 % ad valorem et à une taxe de 2,5 % au profit de la caisse
spéciale des travaux publics.

Ce régime de porte
ouverte fut souligné par plusieurs analystes qui trouveront dans le
mécanisme douanier marocain basé sur un ordre purement fiscal un ”modèle
enviable de sagesse et de raison”90.
En ce qui concerne
les échanges par voie de surface, le régime algéro-marocain a fait
l’objet de nombreux pourparlers et des accords ont été passés à
différentes époques pour tenter de trouver une solution au problème
posé par la proximité du Maroc Oriental et de ”l’Algérie Française”.
Il s’agissait en effet de gérer un régime douanier coutumier qui
s’opérait depuis fort longtemps dans cette région.
Une première loi du
18 juin 1867 avait accordé l’entrée en franchise des produits
marocains sur le territoire algérien par le bureau d’Oujda. En 1892,
un accord franco-marocain a ramené les droits d’entrée des produits
algériens par la frontière orientale de 10 à 5 %. Depuis, naquit
dans la zone un véritable régime douanier spécial dont nous
développerons l’évolution par la suite.
LE PASSAGE DE L’AMANA AU
STATUT D’ADMINISTRATION
DES DOUANES ET IMPÔTS
INDIRECTS

|
L’institution des oumana des douanes avait pu garder son
cadre traditionnel tout en s’adaptant aux multiples réformes
structurelles et fonctionnelles que le makhzen n’a cessé d’y
apporter sous la pression des puissances coloniales. Ainsi,
bien après l’établissement du protectorat, le régime des
oumana des douanes avait perduré. La question peut se poser
alors : à partir de quel moment l’administration des Douanes
fut-elle restructurée selon les règles de la nouvelle
administration néo-coloniale ?
En guise de
tentative de réponse, il y a lieu de considérer que cette
mutation a commencé à se dessiner à travers les différents
plans de réforme mis en chantier par l’administration
coloniale dès 1912. C’est au mois de juillet 1912 que
l’inspecteur des finances Gallut fut appelé au Maroc pour
installer les services financiers du protectorat. Durant les
dix huit mois de service qu’il passa au Maroc, il établit
les premiers services de la direction générale des finances,
notamment les services du budget et des domaines. De 1914 à
1917, son successeur De Fabry, prit la relève en
s’intéressant particulièrement aux questions de la
comptabilité des impôts et de l’enregistrement. Il prépara
notamment le règlement sur la comptabilité publique de 1917.
Il appartient ensuite à François Pietri91 de diriger pendant
plusieurs années les destinées financières du Royaume. C’est
à lui qu’on attribue la nouvelle organisation des services
des douanes, des perceptions et du contrôle des engagements
de dépenses. |
Depuis que Pietri a
quitté l’administration coloniale pour la politique, c’est Mr Brauly
qui prit en mains la direction des services financiers.
L’administration
douanière qui fut rattachée aux services des finances du protectorat
était considérée parmi les administrations qui, quoique placée sous
l’autorité et le contrôle de la résidence, relevait néanmoins du
pouvoir législatif du Sultan92.

Les droits de
douane avaient en effet, depuis la naissance de l’Etat marocain sous
les Idrissides constitué la ressource principale la plus stable et
la plus rentable du budget de l’Etat. En 1904, le gouvernement du
Maroc, pour payer des dettes diverses et notamment le solde de
l’indemnité de guerre due à l’Espagne, avait emprunté d’un
consortium de banques françaises ayant à sa tête la Banque de Paris
et des Pays Bas. Le montant nominal de l’emprunt était fixé à
soixante deux millions cinq cent mille francs. Cet emprunt
constituait un engagement direct du Trésor du makhzen et recevait la
dénomination : “Emprunt 5% 1904 gagé par le produit des douanes
des ports de l’empire du Maroc” .
En vertu des
dispositions de l’article onze du contrat, l’emprunt était garanti
spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous
autres emprunts, par la totalité du produit des droits de douane,
tant à l’entrée qu’à la sortie, de tous les ports de l’empire
existant ou à créer. Le produit des droits de douane devait servir
jusqu’à due concurrence à assurer le service des obligations en
intérêts, amortissements et frais de change. Dans le cas où le
produit des douanes des ports chérifiens serait insuffisant,
l’accord préconisait que le gouvernement marocain s’engageait à
compléter le service de l’emprunt par la totalité des autres
ressources de l’Etat.
Toutefois, compte
tenu du fait que la moyenne annuelle des droits de douane encaissés
de 1900 à 1904 estimée à douze millions de pesetas et dépassant
ainsi le montant nécessaire au service de l’emprunt, il avait été
décidé qu’une partie seulement de ces droits serait prélevée. Le
prélèvement des droits et taxes s’effectuait quotidiennement dans
chaque port et correspondait en fait à 60% de la recette globale.
L’accord prévoyait
une mesure de sauvegarde des intérêts des porteurs de titres. Si le
produit total des recettes douanières subissait pendant deux années
consécutives une diminution et n’atteignait plus la moyenne annuelle
de douze millions de pesetas, l’encaissement quotidien devrait être
augmenté dans une proportion telle que cette part représente
toujours 60 % de douze millions de pesetas, et ce, jusqu’à ce que le
montant total du produit annuel des douanes puisse atteindre de
nouveau le niveau de la recette de référence.
De même, l’article
quatorze de la convention stipulait que les droits de douane
devaient être toujours payés en monnaie or et argent ayant cours au
Maroc. L’encaissement des droits de douane affectés à l’emprunt
s’opérait par les soins des agents des douanes marocaines.
Cependant, le représentant des porteurs de titres avait la
possibilité de nommer un délégué auprès de chacune des douanes. Ce
délégué avait pour mission de procéder à des contrôles et enquêtes
pour tout ce qui concerne les affaires de la douane auprès de
laquelle il était accrédité.
Les oumana
devaient, à ce titre, remettre à ce contrôleur l’état des
encaissements, à l’entrée et à la sortie. Ainsi, était établi le
contrôle de la dette marocaine. Regnault, Consul Général de France à
Genève fut mis à la disposition du syndicat des porteurs français de
la dette marocaine. Le syndicat était domicilié à Tanger. Les
premiers délégués furent Levret et Berti, contrôleurs civils en
Tunisie, Jessé-Curély, élève consul, Valada, élève interprète, et
deux fonctionnaires des douanes tunisiennes9 3. Lorsque le Général
Lyautey retourna au Maroc le 29 mai 1917, Monsieur Berti, Directeur
du Contrôle de la Dette, était parmi les personnalités qui
assistaient à Casablanca à la cérémonie protocolaire de son
accueil94.
L’Administration
Centrale du Contrôle de la Dette s’établissait à, Fuente Nueva,
à Tanger sous la direction d’Eugène Luret, contrôleur civil,
autrefois détaché à la section d’Etat du gouvernement tunisien. Des
agences du contrôle furent également établies à Tanger, Tétouan,
Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi et Mogador.
Les agents du
contrôle de la douane jouissaient de privilèges vis-à-vis du
makhzen. Ainsi, lorsqu’en 1912, le Grand Vizir El Mokri adressa une
circulaire aux caïd de Rabat, Salé, Casablanca, Safi et Mogador,
leur interdisant de recevoir les requêtes présentées directement par
les étrangers, il précisa que cette mesure ne s’appliquait pas aux
agents du contrôle de la douane95.

Dans chaque agence
était perçue, en monnaie hassani, 60 % des recettes douanières du
port d’attache. La délégation des porteurs de titres avait ainsi
touché, du premier juillet 1904 au 15 Mars1905, cinq millions de p e
s e t a s9 6. Outre la perception des droits et taxes, les agents du
contrôle s’occupaient dans les ports marocains à prendre
communication des manifestes ainsi que de tous les documents pouvant
servir à établir les statistiques des importations et exportations
marocaines.
Cette nouvelle
organisation était en fait conçue dans le but de suppléer à
l’administration traditionnelle des “oumana” des douanes. La
gestion des banques et le gouvernement français tenaient à ce que le
service de la dette fut organisé avec le maximum de soin et de
précision. De son côté, le “makhzen” avait demandé que les
délégués fussent des fonctionnaires spécialisés, envoyés d’Europe,
et non des commerçants investis des fonctions consulaires. Ces
derniers étaient soupçonnés d’une éventuelle entente avec les “oumana”
à la résidence, ce qui rendrait le contrôle douanier moins efficace.
C’est dans cet
esprit que le consul général Regnault, arrivé au Maroc le premier
juillet 1904, prit possession à partir du 11 juillet des douanes de
Tanger. Dès le 12 juillet, il effectua une randonnée à travers les
différents ports marocains pour y installer les délégués de la
nouvelle administration du contrôle de la dette. Plusieurs
témoignages soulignent que les cérémonies d’installation furent
entachées de nombreux incidents.
En effet, les ”oumana”
des douanes refusèrent de se dessaisir de leurs prérogatives et
s’opposèrent au contrôle que les agents français voulurent leur
imposer97. Dans certaines villes, comme à Casablanca, la cérémonie
se transforma en acte populaire de résistance qui provoqua les
premières émeutes de la future capitale économique du Royaume98.
Le quai d’Orsay
prit un grand soin de cacher ces incidents à l’opinion française. La
presse française s’est évidemment empressée d’assurer que tout
s’était très bien passé. Ainsi, le journal ”le Temps” publiait un
rapport attribué à Regnault dans lequel on pouvait lire” il n’y a
pas eu l’ombre d’un incident, et nous avons trouvé toujours le calme
le plus parfait. Partout, les ”oumana” nous ont
accueilli amicalement. Partout notre agent a été accrédité le plus
facilement du monde”99.
En réalité, d’après
Guillen, le rapport publié fut forgé de toutes pièces pour rassurer
l’opinion publique française et ne pas compromettre la hausse sur
les titres de l’emprunt qui garantissait un juteux bénéfice au
consortium des banques100.
Le rapport de
Regnault, conservé dans les archives du quai d’Orsay, est en fait
très différent. On peut y noter “l serait trop long de relater
les incidents de ce pénible voyage…...... Je me suis heurté à
l’hostilité générale des “oumana”, qui invoquaient la
longueur et les difficultés du texte du contrat pour demander des
délais et des instructions complémentaires ……… Mon secrétaire
marocain a refusé de m’aider, et s’est dérobé en disant qu’il était
seulement chargé de porter les ordres du Sultan et non de les
commenter…… A Casablanca, l’opposition des “oumana”
fut irréductible”.
Il aurait fallu à
Saint-René Taillandier de formuler d’énergiques protestations auprès
du makhzen pour que ce dernier adressât aux oumana de nouvelles
instructions. Ce n’est finalement qu’au courant du mois d’août que
le nouveau service mis en place commença à fonctionner101.
C’est dans ce
contexte que le service du “contrôle de la dette” fut donc
amené à superviser la gestion des oumana en douane, chargés de
l’encaissement des recettes douanières.
Ces mutations dans
la gestion des affaires douanières préoccupait au plus haut niveau
les représentations diplomatiques étrangères accréditées au Maroc.
Ainsi, dans une évaluation du nouveau système de gestion du service
de la dette, un an après sa mise en place, le consul britannique
Gerard Lawther notait dans un rapport confidentiel du 10 juin 1905
émis à partir de la capitale du makhzen à Fès :

Après le nouvel
emprunt contracté en 1910, la gestion directe des douanes fut
confiée à la même structure.
Jusqu’à
l’établissement du protectorat, les services des douanes à l’instar
des autres services financiers du makhzen étaient gérés par l’amine
al ”oumana”. La charge de ce grand commis de l’Etat semble
avoir été supprimée par le dahir du 5 août 1914 qui en avait confié
provisoirement les fonctions au grand vizir.
Le service des
douanes marocaines était passé, le 1er janvier 1918, des mains du
contrôle de la dette aux mains de l’administration du protectorat.
L’arrêté viziriel du 26 avril 1918 précise à cet effet que :“considérant
que l’Administration de la dette marocaine a remis au protectorat, à
compter du 1er janvier1918 le service des douanes, ce dernier est
rattaché à la Direction Générale des Finances”103.
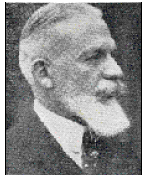
|
Le 19
janvier 1918, Monsieur Pierre Paul SERRA, inspecteur
principal des douanes françaises, détaché hors cadres au
Maroc, a été nommé chef du service des douanes
marocaines104.
En
fait, ce n’est que le 26 janvier 1918 que la douane a
été rattachée à la Direction des Finances du nouveau
makhzen. Cette date pourrait être retenue comme
anniversaire de la naissance d’une nouvelle structure
douanière moderne au Maroc, d’autant plus qu’au niveau
de l’histoire contemporaine, le 26 janvier a été decresé
universellement comme journée mondiale des douanes.
|
La nouvelle
organisation des douanes au Maroc s’est caractérisée par l’adoption,
dès le 26 avril 1918, d’un nouveau statut du personnel français et
assimilé des douanes du protectorat français de l’empire
chérifien105.
Ce personnel était
divisé désormais en trois catégories :
- le cadre
supérieur ;
- le cadre
principal ;
- le cadre
secondaire.
Un arrêté du grand
vizir Mohammed El Mokri fixait, à partir du 27 avril 1918, les
pouvoirs et attributions du chef du service des douanes. Un arrêté
du 16 décembre 1918 fixa les pouvoirs du chef du service des douanes
et du directeur général des finances en matière de transaction.

Réorganisée par
dahir du 24 juillet 1920, la Direction Générale des Finances
comprenait de nouveaux services : budget et comptabilité, impôts et
contributions, douanes et régies, enregistrement et timbre et
domaines.
Dans le cadre de la
réforme administrative de 1947, les services publics du nouveau
makhzen furent érigés en six directions :
- des finances ;
- des travaux
publics ;
- de l’agriculture,
du commerce et des forêts ;
- de la production
industrielle et des mines ;
- de l’instruction
publique ;
- de la santé
publique et de la famille.
La Direction
Générale des Finances crée par dahir du Sultan Moulay Youssef en
date du 24 juillet 1920, comprenait trois divisions ayant chacune à
leur tête un directeur adjoint1 0 6. Compte tenu de sa grande
importance, l’administration des Douanes et Impôts Indirects,
constituait une des principales divisions de la Direction Générale
des Finances. De nouvelles attributions ont été confiées à la douane
comme suit :
a) les tarifs des
douanes et impôts indirects, les admissions exceptionnelles, les
privilèges diplomatiques, les propositions d’importation et
d’exportation ;
b) le recouvrement
et l’application des impôts indirects, taxes de consommation et
droit de garantie ;
c) les régimes
spéciaux, entrepôt, transit, admission temporaire, zones
bénéficiaires de droits réduits, rapport avec les autres zones du
Maroc ;
d) la surveillance
générale des côtes et frontières ainsi que la répression de la
contrebande ;
Des services
accessoires, ont été rattachés à la nouvelle administration, tels
que la perception de la taxe spéciale ad valorem de deux et demi
pour cent, du droit des pauvres, des droits de portes des
municipalités aux entrées par mer ainsi que la gestion du budget et
de la douane de Tanger.
LES CONSÉQUENCES DES
EMPRUNTS
(1902 - 1904 – 1910107)
SUR LA GESTION ET
L’ORGANISATION DES
DOUANES AU MAROC
Devant
l’aggravation de la situation financière et après l’échec de la mise
en oeuvre du Tertib, le makhzen était contraint de chercher de
nouvelles voies pour se procurer de l’argent. Il s’adressa alors à
Fabarez en mars 1902. Ce négociant en finance qui était co-associé
de la société
Gautsch,
se trouvait justement à Rabat auprès du Sultan.
Dans une lettre
adressée à
Gautsch
le 10 Septembre, le gouvernement marocain sollicite officiellement
un prêt commercial de 300.000 livres sterling (7.500.000 FF). Après,
d’âpres négociations et l’intervention de la Banque de Paris et des
Pays Bas, le contrat de prêt avait été finalement signé dans la nuit
du 30 au 31 décembre 1902108.

Multipliant les
prétextes pour différer le paiement, la Banque de Paris et des Pays
Bas demanda au préalable que les oumana des douanes, chargés de
prélever les sommes destinées au paiement trimestriel des intérêts,
aient reçu les instructions nécessaires. Le Sultan, adressa à cet
effet une lettre en l’objet aux oumana de Tanger dès la signature du
contrat.
N’ayant pu régler
définitivement ses difficultés financières, le makhzen s’était mis
d’accord, au cours de l’été 1903 avec la B.P.P.B. sur le principe
d’un gros emprunt public, lancé exclusivement à Paris et gagé sur
les douanes. Le 31 mai 1904, le conseil des vizirs approuva le
contrat final de l’emprunt proposé au makhzen. Ce contrat comportait
en fait d’onéreuses conditions imposées pratiquement aux
négociateurs marocains. Le makhzen n’avait donc pu toucher en
réalité que 10 millions de francs, mais s’était engagé à rembourser
62 millions et demi. Afin d’assurer le service de l’emprunt, il
avait dû abandonner 60 % des revenus douaniers pour toute la durée
de l’amortissement109.
Le 24 juin 1904, un
règlement instituait les conditions de ”contrôle provisoire”
exercé par la nouvelle administration de la gestion de la dette
marocaine.
L’article premier
de ce règlement consacrait le droit de désignation de contrôleurs
auprès de toutes les douanes chérifiennes. Les conditions d’exercice
du contrôle ont été minutieusement déterminées110.
Par un accord du 14
janvier 1910, le makhzen fit appel au concours du gouvernement
français en vue de faciliter le règlement de sa situation
financière. Dans ce cadre, un arrangement fut signé entre le Maroc
et la France le 21 mars 1910. Cette convention annonce un emprunt de
90 millions de francs pour le remboursement des dettes contractées
par le gouvernement marocain antérieurement au 30 juin 1909.
L’emprunt était garanti spécialement et irrévocablement en priorité
par le produit des droits de douane tant à l’entrée qu’à la sortie
de tous les bureaux de douane existant ou à créer. La garantie
s’exerçait uniquement sur la partie qui n’était pas nécessaire au
service de l’emprunt de 1904, à la garantie duquel la totalité du
produit desdits droits de douanes a été affectée et sous réserve
expresse de tous les droits appartenant au porteurs des titres de
l’emprunt 1904, en vertu du contrat du 12 juin 1904, qui régissait
cet emprunt. 5% seulement du produit des douanes tel que défini
ci-dessus étaient réservés au trésor du makhzen.
Cependant,
conformément à l’article 5 de l’arrangement du 21 mars 1910, le
gouvernement français admettait que les dépenses de l’administration
douanière soient imputées sur les recettes des douanes et que les
taxes nouvelles que le makhzen établirait dans les ports ne soient
comprises ni dans les gages ni dans le contrôle. A partir du premier
juin 1910, l’excédent libre du produit des douanes devait être porté
d’office par la Banque d’Etat à un compte nouveau ouvert
spécifiquement au service du nouvel emprunt.

La gestion de cette
série de prêts contractés par le makhzen et gagés sur ses douanes
avait eu plusieurs effets sur l’organisation de l’administration
douanière marocaine.
1) Effet sur la
gestion :
Ainsi, la
délégation de l’emprunt 1904, qui dirigeait le contrôle des douanes
a été depuis, chargée également de contrôler l’assiette et la
perception tant des droits de douane que des moustafade et sakkat.
Selon l’article 8
de la convention, le délégué des porteurs de titres111 a été
confirmé dans sa mission de contrôle des douanes jusqu’à complet
remboursement de l’emprunt de 90 millions de francs et exécution
intégrale des engagements financiers contractés par le makhzen à
l’égard du gouvernement français.
Ce délégué exerçait
ses attributions de contrôle douanier non seulement au profit des
porteurs de l’emprunt 1904, mais aussi dans l’intérêt tant des
porteurs de l’emprunt 1910 que de l’Etat français pris en sa qualité
de créancier du makhzen. Dans ce cadre, les attributions du délégué
du Ministre des Finances à l’Administration des Douanes étaient
étendues aux moustafades et à la sakkat.
Le délégué de
l’emprunt 1904 et le délégué du Ministère des Finances à
l’Administration des Douanes prenaient la qualification de “délégués
au contrôle de la dette makhzenienne”.
Les fonctions de
délégué du makhzen ne devaient toutefois être attribuées ou même
retirées sans le consentement du gouvernement français.
Tous les pouvoirs
ont été donnés aux deux délégués pour organiser le contrôle de
manière à faire produire aux divers revenus concédés leur rendement
maximum.
2/ Effets sur
l’organisation :
L’arrangement
franco-marocain de 1910 préconisait un règlement fixant les
conditions de fonctionnement intérieur de l’administration du
contrôle de la dette. Ce nouveau règlement devait être élaboré d’un
commun accord entre le Ministre des Finances du makhzen et le
délégué français.
Désormais, les
oumana, les adouls et les capitaines des ports ne pourront être
nommés par le makhzen que sur une liste de présentation dressée par
le délégué du Sultan, conformément aux lettres échangées entre les
Ambassadeurs et le Ministre des Affaires Etrangères. Leur révocation
devrait s’effectuer selon la même procédure.
Cette main mise sur
la gestion du personnel douanier a été confirmée par le droit
octroyé au délégué de France de nommer des contrôleurs au sein des
douanes. En ce qui concerne l’administration du service, toutes les
mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des services ne
pouvaient s’effectuer qu’après accord du délégué français.
Pour sauvegarder
une apparence de souveraineté, l’article 9 de l’accord précisait
cependant que le personnel des douanes, y compris les agents des
capitaineries du port, de l’aconage, des moustafade et sakkat, était
placé sous l’autorité du délégué marocain.
Un autre fait
important et très significatif pour l’organisation des douanes
consistait en l’abandon du calendrier de l’hégire pour la tenue des
écritures administratives et comptables. A partir de 1910, le budget
des douanes devrait être établi sur la base du calendrier grégorien
et avec la concordance du calendrier arabe.
Le délégué marocain
fut l’ordonnateur de ce budget, il devait à ce titre, le communiquer
dans le mois qui précède l’ouverture de l’exercice au Ministre des
Finances marocain et au gouvernement français. Ce budget était
alimenté en recette par une retenue sur le produit des revenus
encaissés et par les taxes d’aconage et de magasinage. En dépense,
le budget des douanes, supportait en sus des charges propres à ses
services, celles du contrôle et celles de l’aconage. Là aussi la
souveraineté de l’ordonnateur marocain n’était que théorique, car au
niveau de l’exécution du contrôle, le règlement de 1910 offrait au
délégué français des pouvoirs absolus.

Ainsi, tous actes
administratifs, décisions, ordres de paiement, et pièces comptables,
ordre de service, correspondances de toute nature, quel qu’en soit
le destinataire, émanant soit du délégué marocain, soit de ses
subordonnés dans les ports (les oumana en particulier) étaient
obligatoirement revêtus de la signature du délégué français ou d’un
contrôleur. Les infractions à cette règle devraient être punies
d’une peine disciplinaire et, en cas de récidive, de révocation.
Pour contrecarrer
la résistance des ”oumana” à cette véritable ingérence, le règlement
de 1910 avait pris le soin de prévoir que la seule signature du
délégué français ou du contrôleur en chef dans les ports, sera, en
cas d’absence ou d’abstention injustifiée des fonctionnaires
marocains considérée comme suffisante pour donner valeur et
authenticité à tous les documents sur lesquels elle était apposée.
Enfin, dans un
souci de rompre avec le système traditionnel de gestion des douanes
marocaines, toutes les dispositions réglementaires antérieures
concernant l’organisation et la gestion des douanes avaient été
abrogées. L’article 10 du règlement anticipait sur les nouvelles
missions douanières. Ainsi, dès que l’accroissement des recettes le
permettrait, le nouveau règlement prévoyait que les délégués au
contrôle de la dette organiseraient la surveillance de la
contrebande de commerce. A cet égard, il était prévu une
concertation avec le comité permanent des douanes à Tanger et le
makhzen en vue d’une plus sévère répression des délits de fraude et
de contrebande.
A partir de 1910,
le fermage des moustafade et sakkat dans les ports est mis sous la
gestion directe du service du contrôle de la dette. Les fermiers en
exercice de ces concessions avaient été invités à verser à partir de
la date du contrat d’emprunt, aux mains des délégués au contrôle de
la dette, la totalité des redevances stipulées à leur contrat.
Suivant qu’ils le jugeraient avantageux aux intérêts du trésor, les
délégués au contrôle de la dette avaient le choix soit de maintenir
les fermages ou biens, à expiration du délai de fermage en cours, y
substituer le régime de la perception directe.

LE STATUT DOUANIER DE LA
ZONE
INTERNATIONALE DE TANGER
Le makhzen avait
délibérément fait de Tanger une zone tampon à la pression économique
et commerciale qui s’exerçait avec une grande intensité et
régularité sur le pays depuis le XVIIème siècle.
Ainsi, la ville du
Détroit était-elle devenue au long des années une véritable capitale
diplomatico-économique. La diplomatie économique y était
particulièrement active et les questions douanières étaient souvent
l’objet de débats plus ou moins passionnants.
La lettre du Sultan
Moulay abderrahmane du 18 avril 1824112 au sujet des rapports de la
douane avec le corps consulaire montre bien la constante
préoccupation du makhzen pour la question douanière.
Cet état d’esprit
donna en fait à la ville de Tanger un statut douanier particulier.
L’amine des douanes de Tanger était choisi parmi les grands
personnages de l’Etat. Tel fut le cas de Sidi Mohammed Ben Boubker
Laamarti qui était cité dans un rapport établi le 9 avril 1822 par
le commandant de l’escadre suédoise en ces termes ”Directeur des
douanes, commandant de la marine, ami de longue date de la Suède et
sans contredit le meilleur fonctionnaire public de l’empire qui
jouit d’un grand crédit auprès du Sultan et d’une influence bien
au-dessus de celle du gouverneur de Tanger”. Par ailleurs Hadj
Ahmed Ahardane fut un homme de confiance et Tajjer (commerçant) du
Sultan. A ce titre, il traita de nombreuses affaires sur les places
européennes. L’amine Abdallah Ibn Saïd Assalaoui fut chargé
d’accueillir Guillaume II lors de son débarquement théâtral à Tanger
le 31 mars 1905. Il fut décoré pour ses précieux services par
l’empereur d’Allemagne.
Dés le début du XX
ème siècle ce choix stratégique avait été notamment confirmé dans
les dispositions de l’Acte d’Algésiras de 1906. Tanger a été
désignée comme siège de la commission des valeurs douanières. Par
ailleurs, l’article 97 de la convention instituait à Tanger le
comité des douanes qui exerçait une haute surveillance sur le
fonctionnement des douanes. Le 3 juin 1910, le Consul Britanique
White fut désigné comme représentant du corps diplomatique au sein
du comité permanent des douanes pour un mandat de trois ans113.
UN RÉGIME DOUANIER
CONVENTIONNEL
Pour illustrer ce
constant statut douanier particulier de Tanger, il convient de
rappeler l’ordre du Sultan du Maroc du 12 avril 1883 désignant le
seul port de Tanger exclusivement pour l’exportation de 6.000 têtes
de bovins accordées à l’armée des Etats-Unis d’Amérique.
En 1910, la maison
de la dette marocaine ou ”Dar-Esself” fut la première
construction sur un verger qui deviendra “le Boulevard Pasteur”.
Cet édifice devait abriter un organisme d’Etat qui contrôlait les
emprunts contractés par le Maroc avant et après l’Acte
d’Algésiras114.
Dans ce cadre, un
véritable régime spécifique avait été instauré par la convention de
Paris du 18 décembre 1923115 et le dahir y annexé organisant
l’administration de la zone de Tanger fait à Rabat le 16 février
1924. Conformément aux dispositions de l’article premier du traité
de protectorat du 30 mars 1912 et de l’article sept de la convention
franco-espagnole, relative au Maroc, du 27 Novembre1912, “les
gouvernements contractants”116 avaient convenu de créer une zone
internationale à Tanger où il appartenait à des autorités et
organismes nommément désignés d’assurer l’ordre public et
l’administration générale de la zone par délégation de Sa Majesté le
Sultan du Maroc.
Cette délégation
d’administration fut expressément accordée par l’article premier du
dahir du 16 février 1924 a un organisme particulier : “Nous
octroyons par les présentes
à une administration internationale, une délégation générale et
permanente sous réserve de l’exercice de nos droits et pouvoirs à
l’égard de nos sujets dans ladite zone, droits et pouvoirs qui
seront exclusivement exercés par notre Mendoub et par nos
fonctionnaires chérifiens à Tanger ……..”.
Cette délégation
générale et permanente ne s’appliquait pas en matière diplomatique,
où il n’était pas dérogé aux dispositions de l’article 5 du traité
de protectorat du 30 mars 1912. Toutefois, l’administration
internationale était qualifiée pour traiter avec les consuls des
puissances à Tanger les questions intéressant ladite zone dans les
limites de son autonomie.

La zone de Tanger
était comprise dans les limites fixées par la convention
franco-espagnole du 27 novembre 1912117. Pour la zone de Tanger qui
bénéficiait d’un régime spécial et particulier, la circonscription
administrative et douanière fut instituée par l’article sept du
traité comme suit :
“Partant de Punta
Altarès sur la côte sud du détroit de Gibraltar, la frontière se
dirigera en ligne droite sur la crête de Djebel Beni Meyimel,
laissant à l’ouest le village appelé Douar Ez-Zeitoun et suivra
ensuite la ligne des limites entre le Fahs d’un côté et les tribus
de l’Andjera et de l’Oud-Ras de l’autre côté jusqu’à la rencontre de
l’oued Es-Seghir. De là, la frontière suivra le Thalweg de l’oued
Es-seghir, puis ceux des oueds M’harhar et Tahaddart jusqu’à la mer.
Le tout conformément au tracé indiqué sur la carte de l’Etat Major
espagnol qui a pour titre : “Croquis del Imperio de marruecos” à
l’échelle de 1/100.000e. Edition de 1906 .”
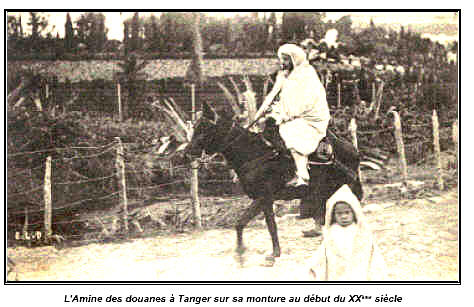
Le chef du
service de la douane de Tanger relevait de l’administration des
douanes marocaines. Il en découle que bien qu’intégrée dans
l’administration internationale de Tanger, l’institution douanière a
toujours pu conserver ses liens avec le makhzen ce qui impliquait
une unité douanière organisationnelle sur l’ensemble du territoire
douanier marocain.
Ce principe fut
d’ailleurs confirmé dans une lettre annexée à la convention du 18
décembre 1923 adressée par Poincaré, Président du Conseil, Ministre
des Affaires Etrangères, à Mr Quinones de Leon, Ambassadeur
d’Espagne à Paris. Dans cette missive datée à Paris du 7 février
1924, le Président du Conseil français signifiait à l’Ambassadeur
espagnol la décision d’affectation aux douanes chérifiennes d’un
fonctionnaire espagnol du service des douanes et du grade de
vérificateur principal (interventor principal)118. Cet agent était
nommé par le chef du service des douanes sur une liste de deux noms
présentés par le gouvernement espagnol. Il était placé sous
l’autorité du chef de service des douanes marocaines et venait
immédiatement après lui dans l’ordre hiérarchique. Il ne relevait
que de lui et ne pourrait cependant être son suppléant dans le
service. En fait, ce fonctionnaire “international” des douanes
chérifiennes était mis à même de s’assurer de l’application
impartiale du régime de taxation ad valorem des marchandises.
Dix ans après
l’entrée en vigueur du statut international de Tanger, il semble que
”le principe annoncé en ce qui concerne le rôle des agents
espagnols avait été reconsidéré par les autorités coloniales”.
Dans ce cadre, on peut retenir la déclaration de Pierre Laval à
l’ambassadeur espagnol Cardinas consignée dans cette lettre en date
du 13 novembre 1935.
“Se référant à
l’article 39 de la convention de Paris du 18 décembre 1923 et à
l’échange de lettres franco-espagnoles du 7 février 1924, le
gouvernement de la République Française s’emploiera volontiers en ce
qui le concerne, pour que pendant la prochaine période statutaire de
12 ans, un vérificateur principal espagnol de la douane de Tanger
exerce les fonctions de directeur adjoint de ce service et en cas
d’absence du titulaire ou de vacance du poste, assure la direction
intermédiaire du service aux mêmes conditions que le Directeur119”.
L’article 20 du
statut de Tanger fixait d’une façon très précise le domaine
d’intervention de l’administration douanière. La douane n’y était
habilitée à percevoir que les droits et taxes afférents aux
marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone. Les
marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées ou
livrées à la consommation dans les zones française et espagnole
bénéficiaient du régime du transit ordinaire, de l’entrepôt ou de
l’admission temporaire. Les droits de douane y afférents devaient
être perçus aux bureaux de douane de la zone de consommation. Ce
régime de transit applicable était inspiré des conclusions de la
conférence de Barcelone de 1921. Les marchandises transitant par les
zones françaises et espagnoles acquittaient de leur côté, les droits
d’importation dès leur introduction sur le territoire assujetti de
la zone internationale de Tanger. Les droits d’exportation ne
portaient que sur les marchandises originaires de la zone.
Par ailleurs, en
vertu des dispositions de l’article 21 de la même convention, la
zone de Tanger participait pour sa part au service des emprunts de
1904 et de1910. La participation était proportionnelle au montant
des recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux
recettes totales encaissées dans les ports des trois zones du Maroc
pendant l’année précédente. Le montant en était annuellement fixé
par rapport au montant des recettes douanières, après entente avec
les autorités des deux autres zones. Pour la première année, cette
participation n’était définitivement établie qu’en fin d’exercice et
les prélèvements de la douane s’exerçaient jusqu’à concurrence d’un
forfait de 500.000 francs et donnaient lieu, ultérieurement à
réception ou à restitution.
Les tabacs importés
sous le régime du transit dans le territoire douanier de Tanger y
étaient admis sous le régime de la suspension des droits de douane.
Ces denrées n’y acquittaient ni droit de porte ni taxe indirecte
locale. Cependant, le droit de deux et demi pour cent dont étaient
passibles les tabacs importés pour la consommation dans la zone
étaient acquis intégralement à la zone.
La convention
prévoyait par ailleurs la rédaction dans un délai de trois mois, par
une commission de techniciens britanniques, espagnols et français,
de projets de dahir réglementant les taxes de consommation sur les
sucres, les principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé,
café, cacao, vanille etc.…), les bougies, les bières.
Le produit de la
taxe spéciale revenant à la zone de Tanger était versé à la Banque
d’Etat, pour le compte de la zone.
L’administration du
contrôle de la dette qui conservait les droits privilèges et
obligations qu’elle tenait de la convention du 21 mars 1910 avait le
droit de demander au gouvernement chérifien de nommer le chef du
service de la douane de Tanger qui relevait de l’administration
centrale des douanes marocaines.
Le service des
douanes et régies de Tanger percevait les droits et taxes de douane
sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et
sur les marchandises exportées de ladite zone. Il encaissait
également les redevances et bénéfices du monopole des tabacs ainsi
que le droit de deux et demi pour cent établi par l’acte d’Algésiras
au titre de la taxe spéciale des travaux publics.
Il ordonnançait et
recouvrait en outre le produit des diverses taxes de consommation.
Le service des douanes de Tanger était également habilité à prélever
d’office sur les sommes qu’il encaissait, et après remboursement de
ses frais de régie, le montant des diverses dépenses obligatoires de
la zone internationale qu’il remettait à l’échéance aux créanciers
auxquelles elles revenaient:
1) A la délégation
des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910 : la part de
Tanger dans le service desdits emprunts ;
2) A l’Etat
chérifien : les droits de douane payés par le monopole des tabacs et
qui ne correspondaient pas à la consommation tangeroise ;
3) A la compagnie
de Tanger - Fès : la part de Tanger dans la garantie de ses emprunts
;
4) A la compagnie
du port de Tanger : les annuités du service de ses emprunts.
Le service des
douanes et régies remettait d’autre part le produit de la taxe
spéciale à la banque du Maroc. Lorsque les recettes encaissées
étaient inférieures au total des prélèvements ci-dessus, le déficit
était alors imputé par référence sur l’ensemble des recettes de
Tanger ou le cas échéant, sur son fond de réserve. Par contre si les
recettes étaient supérieures, l’excédent était versé à la Banque
d’Etat à la disposition de l’administration de la zone.
Le budget du
service de la douane était présenté chaque année, avant le 15
novembre, à l’Administrateur de la zone, qui le soumettait à
l’approbation de l’assemblée. En cas de désaccord, le différend
entre l’administration de la zone et le service de la douane était
arbitré par le comité de contrôle qui statuait à la majorité des
voix. Une majorité des trois quarts était nécessaire pour les
différends relatifs à la création et à la suppression d’emplois. Au
cas où l’approbation du budget du service de la douane
n’interviendrait pas avant le 1er janvier, les prévisions
budgétaires de l’année antérieure s’appliquaient d’office au nouvel
exercice. Le comité de contrôle devait le cas échéant, et à la
majorité des trois quarts, soumettre au gouvernement chérifien une
demande motivée de remplacement du chef du service de la douane.
Le dahir chérifien
du 16 février 1924 organisant l’administration de la zone de Tanger
comportait également un ensemble de dispositions relatives à la
douane et son rôle dans la gestion administrative de la zone. Le
comité de contrôle du budget de la zone devait ainsi s’assurer pour
chaque exercice que le produit des douanes et des taxes de
consommation suffisait à assurer les dépenses obligatoires. Dans le
cas contraire, il procédait à l’affectation de tous autres produits
qu’il jugeait utiles à l’acquittement intégral des dépenses.
En dehors des
dépenses obligatoires, l’ordonnancement des dépenses appartenait au
Directeur des Finances. L’encaissement des recettes et le paiement
des dépenses étaient effectués par un comptable nommé par le comité
du contrôle à l’exception du produit des douanes et des taxes de
consommation.
Le produit des
douanes et des taxes de consommation était directement recouvré par
les agents de la douane. Cette procédure marquait déjà l’autonomie
du service douanier par rapport aux autres services de
l’administration internationale de Tanger. Ce rôle prépondérant que
jouait la douane dans l’exercice budgétaire de la zone de Tanger fut
expressément reconnu par l’article 46 du dahir susvisé qui stipulait
notamment que les principales recettes d’intérêt général sont
fournies par :
- les douanes ;
- les taxes de
consommation sur le sucre, le thé, le café, les bières, les bougies,
l’alcool, les denrées coloniales ;
- le produit de la
taxe spéciale de deux et demi pour cent sur les importations.
Le même article 46
ajoutait que l’une des principales dépenses d’intérêt général était
entre autres, la contribution aux emprunts de 1904 et de 1910 qui
fut une dépense obligatoire imputée par priorité sur le produit des
douanes et taxes de consommation.
Par ailleurs, en
vertu des dispositions de l’article 14 dudit dahir, l’administration
internationale ne pouvait, sans entente préalable avec les autorités
des deux autres zones, réglementer les questions concernant le
cabotage et toutes autres matières connexes aux questions douanières
et intéressant la généralité des ports marocains. Enfin, il convient
de signaler la confirmation par le dahir (Art 3) du principe de la
franchise douanière accordée pour les effets et objets importés par
le Sultan ainsi que tous les membres de la famille Royale résidant
dans la zone de Tanger.
En 1926, un arrêté
viziriel approuva l’accord intervenu entre la zone française et la
zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises
d’origine étrangères effectués par mer entre ces deux zones. L’objet
de cet accord douanier était la facilitation des relations
commerciales tout en réservant à chaque zone les droits et taxes
afférent aux marchandises d’origine étrangère effectivement
consommées sur son territoire douanier.
Dans ce cadre, les
marchandises étrangères faisant l’objet d’échange par mer entre
Tanger et la zone française devaient être expédiées soit en
transbordement, soit sous le régime du cabotage. Dans le premier
cas, le bureau de douane où la marchandise était transbordée devait
délivrer simplement le titre de mouvement destiné à accompagner la
marchandise. Les droits de douane, taxe spéciale et taxes de
consommation étaient dès lors liquidés et perçus au port de
destination. Si au contraire, la marchandise étrangère provenait du
commerce libre qui en a déjà acquitté les droits et taxes, le bureau
d’expédition devait délivrer au déclarant un passavant sur lequel il
liquidait pour ordre les droits de douane à la valeur du jour de
l’expédition en vue de leur restitution ultérieure à la zone de
destination. Les passavants étaient recueillis par la douane de la
zone de destination et repris sur un registre ouvert à cet effet. A
la fin de chaque trimestre, un bordereau récapitulatif devait être
envoyé au bureau de destination. Ce dernier devait en accuser
réception dans un délai de 15 jours et faire les observations qu’il
jugeait opportunes.
Ce règlement ne
visait que les droits de douane. Les taxes intérieures de
consommation demeuraient définitivement acquises à la zone qui en
avait effectué la perception. Quand aux droits d’exportation sur les
marchandises marocaines, il avait été décidé, qu’ils revenaient à la
zone dont elles sont originaires120.
En matière de
règles d’origine, il importe de souligner qu’une loi spécifique du
22 novembre 1943 définissait expressément l’origine tangéroise des
marchandises en matière douanière. Cette réglementation spéciale de
l’origine tangeroise en douane fut appliquée jusqu’en 1958. A cette
époque, il avait été jugé que les conditions de l’octroi de
l’origine tangeroise étaient plus restrictives que celles qui furent
en vigueur dans les autres parties du Royaume. S’appuyant sur les
perspectives de la charte Royale de Tanger d’unifier les
réglementations et de faciliter la circulation des marchandises,
l’article premier de la loi de 1943 avait été abrogée. Un dahir du 5
février 1958 étendait à la province de Tanger les dispositions de
l’article 3 du dahir du 30 décembre 1939 concernant la définition de
l’origine des marchandises en matière douanière121.
NOUVELLES MESURES
DOUANIÈRES SPÉCIFIQUES PROPRES
À LA ZONE INTERNATIONALE
DE TANGER
L’article premier
de la convention de Paris du 18 décembre 1923 avait instauré le
principe de création d’une autorité chargée d’assurer, par
délégation du Sultan, l’ordre public et l’administration générale de
la zone internationale de Tanger.
Le dahir du Sultan
Moulay Youssef du 16 février 1924, organisant l’administration de la
zone octroya à une administration internationale, une délégation
générale et permanente pour la gestion de la zone. Cette délégation
comportait cependant deux limites :
1) elle ne
s’étendait pas aux droits et pouvoirs qui étaient exclusivement
exercés par le mandoub et les fonctionnaires du makhzen à Tanger ;
2) elle ne
s’appliquait pas en matière diplomatique qui continuait à être régie
par les dispositions de l’article 5 du traité du protectorat du 30
mars 1912.
Dans ce cadre, une
assemblée législative internationale exerçait le pouvoir législatif
et réglementaire. Le pouvoir exécutif était confié à
l’administrateur , qui représentait l’organisme international à
l’égard des tiers et transmettait les décisions de l’assemblée au
comité de contrôle. L’administrateur de la zone internationale de
Tanger notifiait aux chefs des services intéressés les décisions de
l’assemblée qui en assuraient l’exécution sous sa responsabilité.
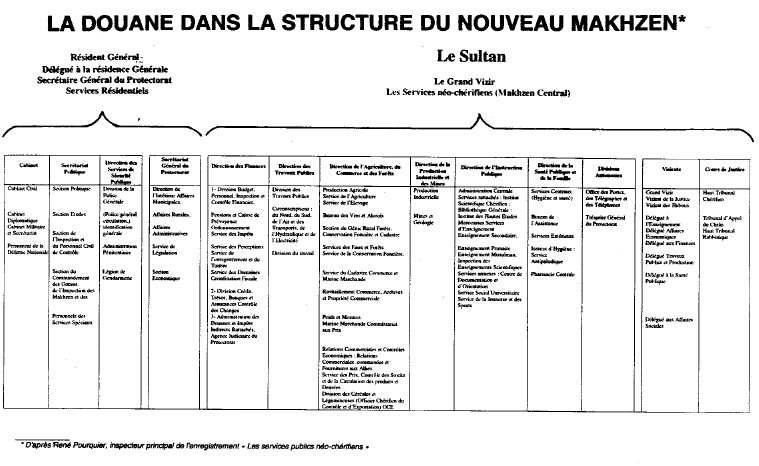
|
L’administrateur avait sous ses ordres trois
administrateurs adjoints. Un premier adjoint qui le
remplaçait en cas d’absence et qui sous sa direction
était plus spécialement chargé des services d’hygiène et
d’assistance. Le second adjoint était chargé des
services judiciaires. Le troisième administrateur
adjoint supervisait particulièrement les services
financiers. Selon la convention de Paris (Art 35)
l’administrateur adjoint chargé des services financiers
devait être obligatoirement de nationalité britannique.
Il était nommé par dahir sur demande du comité de
contrôle. A ce titre, il supervisait les services de
douane à Tanger122.
|
C’est dans le cadre
de ce nouvel environnement politico-réglementaire qu’étaient
instaurées les nouvelles réformes de l’administration internationale
de Ta n g e r. Parmi ces réformes s’inscrivaient des nouveaux
régimes douaniers dont on peut citer notamment le régime de
l’entrepôt fictif, celui des droits de consommation sur certaines
denrées, ainsi que le régime des alcools et des bières.
1/ Institution de
droits de consommation :
Par dahir du 15 mai
1925 (21 Chaoual 1343) des droits de consommation avaient été
institués dans la zone de Tanger sur les sucres et produits
édulcorants, les denrées coloniales et leurs succédanés et sur les
bougies. Ces droits étaient perçus à l’importation ou à la
production. Les déclarations, vérifications et perceptions étaient
opérées suivant les règles admises en matière de droits de douane.
Les produits passibles des droits de consommation ne pouvaient être
importés que par le bureau des douanes du port de Tanger ou des
bureaux expressément désignés par la douane sur la frontière
terrestre . Des mesures coercitives étaient prévues pour tous les
contrevenants à la réglementation en la matière.
Les produits
concernés par cette réglementation étaient :
- les sucres bruts,
raffinés et candis-glucose, sirop, miel, bonbons et fruits, confits
au sucre, biscuits sucrés, confitures, marmelades, gelées et
compotes de fruits (200 francs les cent kilogrammes nets) ;
- la saccharine et
autres substances édulcorantes artificielles (300 francs/kg net) ;
- les mélasses (20
francs les 100 kgs nets) ;
- le thé (500
francs les 100 kgs nets), le café vert (300 francs les 100 kgs nets)
;
- le café torréfié
ou moulu et succédanés (400 francs les 100 kgs nets) ;
- les racines de
chicorée préparées (100 fracs les 100 kgs nets) ;
- le poivre, le
piment fort (500 francs les cents kgs nets) ;
- le cacao broyé et
le beurre de cacao (300 francs les cents kgs nets) ;
- le cacao en fèves
et pellicules (200 francs les 100 kgs nets) ;
- le chocolat (300
francs les 100 kgs nets) ;
- les amomes,
cardamones, macis, cannelles, muscades et girofles (500 francs les
100 kgs nets) ;
- les bougies et
cierges (150 francs les 100 kgs nets)123 ;
- gasoils (70
francs les 100 kgs nets) ;
- cartes à jouer
(10 francs le jeu) ;
- briquets (20
francs le briquet en métal) (50 francs le briquet en argent) (200
francs le briquet en or ou en platine).
2/ Institution du
régime de l’entrepôt fictif dans la zone de Tanger :

|
La loi
du 26 avril 19271 2 4 instaurant le régime de l’entrepôt
fictif dans la zone de Tanger constituait l’une des
premières réformes instituées par la nouvelle
administration internationale. Un entrepôt fictif
pouvait être constitué dans les magasins du commerce
pour les marchandises d’origine étrangère spécialement
désignées par l’assemblée consultative. La liste des
produits bénéficiant de ce régime était arrêtée par
l’assemblée après avis du chef du service des douanes de
la zone. La durée de séjour des marchandises dans les
magasins ne pouvait excéder le délai d’un an. Les
marchandises entreposées pouvaient être réexportées ou
mise à la consommation locale dans les conditions
réglementaires .
|
L’admission au
bénéfice de l’entrepôt fictif était autorisée par décision du chef
du service des douanes à Tanger au vu d’une demande établie sur
papier timbré et contenant l’engagement de payer à la douane , à
titre de frais de surveillance, une redevance forfaitaire fixée à
500 francs par an125. Cette redevance pouvait être fractionnée par
douzièmes, mais elle était due pour la totalité du mois grégorien au
cours duquel commençait ou finissait l’entrepôt. Le demandeur devait
en outre donner à la douane la description des locaux d’entrepôt et
la désignation précise des marchandises à entreposer.
Les marchandises
étaient reçues en entrepôt sous couvert d’une déclaration détaillée
indiquant les magasins où elles étaient enfermées. La régularisation
s’effectuait par le dépôt d’une déclaration en détail écrite après
octroi d’un permis spécial de la douane. Les marchandises mises à la
consommation dans le délai réglementaire étaient passibles des
droits et taxes sur la base de la valeur à la date de
l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Le
service des douanes tenait pour chaque entrepôt un compte d’entrée
et de sortie des marchandises entreposées. Les marchandises admises
au bénéfice du régime de l’entrepôt fictif se présentaient comme
suit126 :
- houilles ;
- huiles minérales
lourdes ;
- huiles minérales
(brutes et raffinées) et leur dérivées ;
- huiles
comestibles destinées à la fabrication des conserves ;
- feuilles de fer
blanc destinées à la fabrication des emballages ;
- caisses en bois
vides ;
- bois bruts
équarris ou sciés ;
- boites, bidons,
estagnons et autres récipients en fer blanc ;
- tabacs en
feuilles ;
- eaux de vie de
vin ;
- moût concentré de
raisins ;
- tartrate de chaux
et de potasse ;
- farine de manioc
;
- fécule de manioc
;
- fécule de maïs ;
- fécule de pomme
de terre ;
- farine de viande
;
- peaux et
pelleteries pour fourrures ;
- sacs et toiles
d’emballage.
En 1948,
l’assemblée consultative adopta une nouvelle loi portant
réglementation du régime de l’entrepôt fictif pour les matières d’or
et d’argent brutes ou monnayées, le platine et le palladium, ainsi
que pour les pierres gemmes et perles fines dites précieuses.
L’importation de ces produits sous le régime de l’entrepôt fictif de
la zone de Tanger était réservée exclusivement aux établissements
bancaires agréés à cet effet par l’administrateur de la zone, et
dont les noms ont été publiés au bulletin officiel de la zone.
L’agrément était délivré pour une période d’un an, renouvelable par
tacite reconduction par période annuelle sauf préavis de trois mois.
Il pouvait être retiré par l’administrateur de la zone sans
justification de sa décision.
L’admission au
bénéfice de ce régime était autorisée par décision du chef du
service des douanes au vu d’une demande établie sur papier timbré et
contenant :
- l’indication de
l’objet de l’entrepôt ;
- la description
des locaux de l’entrepôt ;
- le montant
maximum des droits dont le crédit est demandé ;
- l’engagement de
payer à la douane à titre de frais de surveillance : une redevance
forfaitaire fixée à 25.000 francs par an.
Les marchandises
étaient admises en entrepôt fictif sur présentation d’une
déclaration signée par l’entrepositaire. Toute opération de sortie,
soit en vue du transfert dans un autre entrepôt, soit pour la
consommation, soit pour la réexportation devait avoir lieu sous
couvert d’une déclaration en détail écrite après octroi d’un permis
spécial des douanes.
Les agents de
l’administration des douanes tenaient pour chaque entrepôt un compte
d’entrée et de sortie des marchandises entreposées. Ces marchandises
devaient être présentées par le soumissionnaire et à toute
réquisition en mêmes qualité et quantité, dans les mêmes colis et
avec les mêmes marques. Le soumissionnaire était, en outre, tenu de
mettre à la disposition des agents des douanes, les hommes et le
matériel nécessaire pour faciliter le recensement des marchandises
en entrepôt.
Les banques
entrepositaires étaient seules obligées vis-à-vis de la douane en
vertu de leurs déclarations alors même qu’elles n’étaient pas
propriétaires des articles mis en entrepôt. Leur responsabilité ne
cessait qu’après qu’elles eurent fait intervenir un tiers pour qu’il
s’engageât vis-à-vis du service et que l’engagement de ce tiers eut
été accepté par la douane.
3/ Régime douanier
des alcools et des bières :
Ce régime fut
instauré dans la zone internationale de Tanger par dahir du 15 mai
1925 (21 chaoual 1343). En vertu de cette réglementation, étaient
passibles d’un droit de consommation de 500 francs l’hectolitre
d’alcool pur, les alcools excédant quatorze degrés centésimaux
contenus dans les vins, mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou
d’imitation et sur la totalité de l’alcool contenu dans les eaux de
vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau de vie, les médicaments, les
parfums et les autres liqueurs non dénommées. Les alcools éthyliques
dénaturés en vue des usages industriels ou domestiques n’étaient
assujettis qu’à un droit de deux francs par hectolitre d’alcool pur.
Cette même
réglementation interdisait, sauf autorisation du chef du service des
douanes, l’importation, la fabrication et la circulation des
alambics et de tout appareil ou portion d’appareil propre à la
distillation des alcools ou au repassage des eaux de vie et des
esprits. Le déplacement de ces instruments dans la zone était soumis
à la délivrance par le service des douanes locales d’un
laissez-passer. Les bières étaient passibles d’un droit de
consommation de quatre francs par degré hectolitre de moût.
Un dispositif
répressif était également prévu à l’encontre des auteurs d’actes de
fausses déclarations et de contrebande en la matière.
4/ Régime de
prohibition et de change :
Un avis de l’Office
Marocain des Changes du 14 octobre 1952 avait prescrit aux
commerçants importateurs de marchandises marocaines en provenance de
Tanger qu’ils pourraient, après importation, obtenir l’autorisation
de régler leur fournisseur tangerois. Pour ce faire, il leur
appartenait au moment du dédouanement de la marchandise, d’établir,
en triple exemplaires, un certificat d’importation1 2 7 en y
joignant le passavant de douane et une facture visée pour
certification d’origine par l’attaché commercial près le Consulat
Général de France à Tanger.

RÉGIME DOUANIER DE LA
ZONE ESPAGNOLE
Le statut de la
zone du protectorat espagnol au Maroc découlait en principe des
dispositions du traité franco-espagnol du 27 novembre 1912. Par
cette convention, la France instaura une zone d’influence dans
laquelle il appartenait à l’Espagne de prêter son assistance au
gouvernement marocain pour l’introduction de réformes
administratives, économiques et financières. Les articles, deux et
sept du traité, instauraient des lignes de démarcations qui
délimitèrent les trois zones d’administration attribuée
respectivement à la France, à l’Espagne et à l’administration
internationale de Tanger.
De ce fait, un
nouveau territoire douanier assujetti à l’administration espagnole
était ainsi délimité au Nord du Maroc, la frontière séparatrice des
zones d’influence française et espagnole partait de l’embouchure de
la moulouya et remontait le thalweg de cet oued jusqu’à un kilomètre
en aval de Mechra-klila. De ce point, la ligne de démarcation
suivait jusqu’à Djbel Beni Hassan le tracé fixé par l’article deux
de la convention du 3 octobre 1904.
Du Djebel Ben
Hassen, la frontière rejoignait l’oued Ouergha au Nord de la Djema
des cheurfa Tfraout, en amont du coude formé par la rivière. De là,
se dirigeant vers l’Ouest, elle suivait la ligne des hauteurs
dominant la rive droite de l’oued Ouergha jusqu’à son interception
avec la ligne Nord-Sud définie par l’article 2 de la convention de
1904. Dans ce parcours, la frontière contournait le plus étroitement
possible la limite Nord des tribus riveraines de l’oued Ouergha et
la limite sud de celles qui n’étaient pas riveraines en assurant une
communication militaire non interrompue entre les différentes
régions de la zone espagnole. Elle remontait ensuite vers le Nord en
se tenant à une distance d’au moins 25 kilomètres à l’Est de la
route de Fès à El kssar El Kébir par Ouezzan jusqu’à la rencontre de
l’oued Loukkos, dont elle decendait le thalweg jusqu’à la limite
entre les tribus Sarsar et Tlix. De ce point, elle contournera le
Djebel Ghani, laissant cette montagne dans la zone espagnole, sous
réserve qu’il n’y serait construit de fortifications permanentes.
Enfin, la frontière rejoignait le parallèle 35° de latitude Nord
entre le douar Mgarya et la Marva de Sidi Slama, et suivait ce
parallèle jusqu’à la mer.
Au sud du Maroc, la
frontière des zones française et espagnole était définie par le
Thalweg de l’oued Draâ, qu’elle remontait depuis la mer jusqu’à sa
rencontre avec le méridien 11° ouest de Paris. Elle suivait ce
méridien vers le sud jusqu’à sa rencontre avec le parallèle 27° 40’
de latitude nord. Au sud de ce parallèle, les articles 5 et 6 de la
convention du 3 octobre 1904 restaient applicables. Les régions
marocaines situées au nord et à l’est de cette délimitation
demeuraient sous l’influence administrative française.

Le gouvernement
marocain ayant, par l’article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé
à l’Espagne un établissement à Santa Cruz de Mar Pequena (Ifni), il
était entendu que le territoire de cet établissement avait les
limites suivantes : au nord, l’oued Bou Sedra depuis son embouchure,
au sud, l’oued Noun depuis son embouchure, à l’est, une ligne
distante approximativement de 25 kilomètres de la côte.
Le traité, après
avoir fixé avec précision les zones d’influence de chacune des
parties, avait défini la répartition des produits des recettes
douanières d’une part ainsi que les droits, prérogatives et
privilèges des emprunts de 1904 et 1910 d’autre part. La répartition
du produit des douanes fut réglée par l’article 13 du traité qui
préconisait qu’il y avait lieu d’assurer à la zone française et à la
zone espagnole le produit revenant à chacune d’elles sur les droits
de douane perçus à l’importation. Les deux gouvernements convenaient
ainsi :
“1/
que balance faite des recettes douanières que chacune des deux
administrations zonières encaissera sur les produits introduits par
ses douanes à destination de l’autre zone, il reviendra à la zone
française une somme totale de 500.000 pesetas hassani, se
décomposant ainsi :
a) une somme
forfaitaire de 300.000 pesetas hassani applicable aux recettes des
ports de l’ouest ;
b) une somme de
200.000 pesetas hassani applicable aux recettes de la côte
méditerranéenne, sujette à révision lorsque le fonctionnement des
chemins de fer fournira des éléments exacts de calcul. Cette
révision éventuelle pourrait s’appliquer aux versements
antérieurement affectés, si le montant de ceux-ci était supérieur à
celui des versements à réaliser dans l’avenir ; toutefois, les
versements dont il s’agit ne porteraient que sur le capital et ne
donneraient pas lieu à un calcul d’intérêts. Si la révision ainsi
opérée donne lieu à une réduction des recettes françaises relatives
aux produits douaniers des ports de la Méditerranée, elle entraînera
ipso facto le relèvement de la contribution espagnole aux charges
des emprunts susmentionnés.
2/ Que les recettes
douanières encaissées par le bureau de Tanger devront être réparties
entre la zone internationalisée et les deux autres zones, au prorata
de la destination finale des marchandises. En attendant que le
fonctionnement des chemins de fer permette une exacte répartition
des sommes dues à la zone française et à la zone espagnole, le
service des douanes versera en dépôt à la Banque d’Etat l’excédent
de ces recettes, paiement fait de la part de Tanger.”
Les administrations
douanières des deux zones s’entendront par l’entremise de
représentants qui se réuniront périodiquement à Tanger, sur les
mesures propres à assurer l’unité d’application des tarifs. Ces
délégués se communiqueront à toutes fins utiles les informations
qu’ils auront pu recueillir tant sur la contrebande que sur les
opérations irrégulières éventuellement effectuées dans les bureaux
des douanes.
Les deux
gouvernements s’efforceront de mettre en vigueur à la date du 1er
mars 1913 les mesures visées sous le présent article.
De plus, l’article
15 précisait qu’en ce qui concerne les avances faites par la Banque
de l’Etat sur les cinq pour cent des douanes, il était apparu
équitable de faire supporter par les deux zones non seulement le
remboursement desdites avances, mais d’une manière générale, les
charges de la liquidation du passif du makhzen à cette époque. Ceci
indique clairement que les avances de la Banque d’Etat gagées sur le
cinq pour cent du produit de la douane constituaient une grande
partie du passif du makhzen.
Après avoir
confirmé dans son article dix le principe d’affectation aux dépenses
du produit des impôts collectés dans la zone y compris les revenus
des douanes, le traité fixa les conditions de garantie des droits,
prérogatives et privilèges des emprunts de 1904 et 1910 dans ladite
zone. Dans ce cadre, l’article douze du traité apportait les
précisions ci-après :
“- le Gouvernement
de Sa Majesté le Roi d’Espagne ne portera pas atteinte aux droits,
prérogatives et privilèges des emprunts 1904 et 1910 dans sa zone
d’influence.
- en vue de mettre
l’exercice de ces droits en harmonie avec la nouvelle situation, le
Gouvernement de la République française usera de son influence sur
le représentant des porteurs pour que le fonctionnement des
garanties dans ladite zone s’accorde avec les dispositions
suivantes:
La zone d’influence
espagnole contribuera aux charges des emprunts 1904 et 1910 suivant
la proportion que les ports de ladite zone, déduction faite des
500.000 p.h.1 2 8 dont il sera parlé plus loin, fournissent à
l’ensemble des recettes douanières des ports ouverts au commerce.
- Cette
contribution est fixée provisoirement à 7,95 %, chiffre basé sur les
résultats de l’année 1911. elle sera révisable tous les ans, à la
demande de l’une ou de l’autre des parties. La révision prévue devra
intervenir avant le 15 mai suivant l’exercice qui lui servira de
base. Il sera tenu compte de ces résultats dans le versement à
effectuer par le Gouvernement espagnol.
- Le Gouvernement
de Sa Majesté le Roi d’Espagne constituera chaque année à la date du
1er mars, pour le service de l’emprunt 1910 et, à la date du 1er
juin, pour le service de l’emprunt 1904, entre les mains du
représentant des porteurs de titres de ces deux emprunts, le montant
des annuités fixées. En conséquence, l’encaissement au titre des
emprunts sera suspendu dans la zone espagnole par application des
articles 20 du contrat du 12 juin 1904 et 19 du contrat du 17 mai
1910.”
En ce qui
concerne la détermination de la valeur en douane, l’article dix huit
du traité préconisait la désignation d’un délégué représentant le
khalifa de la zone espagnole pour siéger au sein du comité de la
valeur en douane créé par l’article 96 de l’acte d’Algésiras.
Le produit de la
taxe spéciale prévu à l’article 66 de l’acte d’Algésiras perçu par
la douane dans la zone espagnole était spécifiquement affecté à
l’exécution aux travaux publics destinés au développement de la
navigation et du commerce dans les ports de cette zone. Toutefois,
les modifications des taux de droits de douane ne pourraient être
décidées que d’un commun accord du gouvernement de la république
française et le gouvernement de Sa Majesté Catholique.
Enfin, il y aurait
lieu de signaler que l’article trente de l’acte d’Algésiras
spécifiait que l’application du règlement sur la contrebande des
armes dans le Rif et, en général, dans les régions frontières des
possessions espagnoles, resterait l’affaire exclusive de l’Espagne
et du Maroc.

LE RÉGIME DOUANIER DU
PROTECTORAT FRANÇAIS
Dans les annales
des mérinides d’Abou Mohamed Salah Ben Abdelhalim129 on peut
constater que les français avaient fréquenté les côtes marocaines
depuis 1260. Peu après, un français, Bethen Court devait reconnaître
le littoral de Tanger jusqu’au Cap Blanc. En 1577, Henri III établit
un consul à Fès qui fut un commerçant marseillais dénommé Guillaume
Berard. En 1617, le Marseillais Castellane s’établit à Fès comme
consul français. Le 17 septembre 1631 un traité de commerce et
d’amitié fut signé entre le Maroc et la France. Parmi ses clauses on
peut noter :
“Que tous les
marchands français qui viendront aux ports du Royaume pourront
mettre à terre leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans
payer aucun droit que la dîme”.
Depuis, le Maroc
concluait régulièrement des conventions de commerce avec la France
dont on peut citer notamment :
- un traité du 24
septembre 1631 fait à Safi ;
- un traité du 18
juillet 1635 fait à Safi également ;
- le traité de
Saint Germain En Laye du 29 janvier 1682.
En 1733, la France
vendait au Maroc pour 640.000 livres de toiles de France, telles que
les Lavals, les Bretagnes et les Cambrais, et pour 900.000 livres de
drap, papier, sucre, coton et quincaillerie. Mais, selon
Thomassy130, la décadence arrivait non moins rapide. Vers 1750, les
bâtiments français pour le Maroc n’étaient plus que dix à douze par
an et ne représentaient plus qu’un commerce de 400.000 à 500.000
livres. En 1764, se manifestaient en France d’intéressantes
initiatives pour un regain d’activité commerciale au Maroc. Le 28
mai 1767 fut signé en effet un important traité de paix et d’amitié
entre la France et le Maroc. Cette convention comportait des clauses
qui touchaient le commerce et les affaires.
Le 24 décembre
1892, un accord commercial était conclu entre la France et le Maroc
réglant notamment la réduction de certains droits douaniers et
l’annulation de diverses prohibitions. Sur toute une série de
marchandises. Les droits de douane furent dès lors réduits de
moitié1 3 1. Le 20 avril 1902 un second accord créait des postes de
garde pour maintenir la libre circulation entre le Maroc et la
frontière Oranaise et seconder les agents des douanes.

Le 8 avril 1904,
l’entente cordiale franco-britannique fut officialisée par la
signature de la convention Paul Cambon- Lans downe, qui permit à
l’Angleterre de reconnaître à la France le droit à une influence
prépondérante au Maroc en qualité de puissance limitrophe. Le
principe de la liberté commerciale au Maroc sera observé par la
France sans droit de préférence.
En 1905, l’Allemagne,
se disant oubliée dans les arrangements de 1904 déclare les ignorer.
Ainsi, avait-on pu constater un brusque revirement de la position de
l’Allemagne au début du XXème siècle, à l’égard de la politique
française au Maroc. Cette puissance avait d’abord manifesté à
différentes reprises son intention de ne pas entraver l’action de la
France au Maroc. Mais, le discours prononcé par Guillaume II à
Tanger le 31 mars 1905 contraignait la France, une année après, à
porter la question marocaine devant une conférence internationale
qui se tint à Algésiras avec la participation des représentants de
treize puissances132.
Le statut du Maroc
issu de la conférence fut caractérisé par le respect de trois
principes énoncés dans le préambule du traité : ”la souveraineté du
Sultan, l’intégrité de ses Etats et la liberté économique sans
aucune inégalité”. Le chapitre cinq de la convention introduisait un
nouveau règlement sur les douanes et la répression de la fraude et
de la contrebande. De nouvelles règles de conduite et de mise en
douane des marchandises furent également instaurées.
Conduite et mise en
douane des marchandises :
Les capitaines de
navires de commerce, venant de l’étranger ou d’autres ports du Maroc
devaient ainsi, dans les vingt quatre heures de leur admission en
libre pratique dans un des ports marocains, déposer au bureau de
douane une copie exacte du manifeste.
La douane avait, en
outre, autorité d’installer à bord des navires des agents de service
pour prévenir tout trafic illégal. Etaient toutefois dispensés du
dépôt du manifeste :
1) les bâtiments de
guerre ou affrétés pour le compte d’une puissance ;
2) les canots
appartenant à des particuliers pour usage personnel ;
3) les bateaux ou
embarcations utilisées pour la pêche côtière ;
4) le yachts employés
uniquement à la navigation de plaisance et enregistrés au port
d’attache dans cette catégorie ;
5) les navires chargés
spécialement de la pose et de la réparation des câbles
télégraphiques ;
6) les bateaux
uniquement affrétés au sauvetage ;
7) les bâtiments
hospitaliers ;
8) les navires écoles
de la marine marchande.
Les manifestes
déposés en douane devaient énoncer la nature et la provenance des
marchandises avec indication des espèces, marques et numéro des
colis. Tout retard de dépôt du manifeste dans le délai réglementaire
était sanctionné par le paiement d’une amende de cinquante pesetas
par jour de retard, sauf cas de force majeure. Le montant total de
l’amende du au retard ne pouvait cependant excéder six cent pesetas.
Lorsqu’un capitaine de navire présentait frauduleusement un
manifeste inexact ou incomplet, il était personnellement condamné au
paiement d’une somme égale à la valeur des marchandises pour
lesquelles il n’avait pas produit de manifeste et à une amende de
cinq cent à mille pesetas. Le bâtiment et les marchandises
pouvaient, en outre, être saisies par l’autorité consulaire
compétente, pour la sûreté de l’amende. Au cas où il y avait des
indices sérieux, faisant soupçonner l’inexactitude du manifeste, ou
lorsque le capitaine du navire refusait de se prêter à la visite et
aux vérifications des agents de la douane l’autorité consulaire
était immédiatement saisie. Il était alors procédé en présence des
agents de la douane aux enquêtes, visites et vérifications
nécessaires.
Introduction du
principe de la déclaration en détail écrite :
A l’étude de
l’évolution de l’histoire des douanes au Maroc, tout porte à croire
que si le principe du dépôt d’une déclaration sommaire en douane
était institué depuis le XIè m e siècle, les opérateurs n’auraient
pas eu d’obligation de déposer une déclaration en détail par écrit
pour le dédouanement de leurs marchandises. En effet, nous avons
constaté que le principe de la conduite et de la mise en douane des
marchandises avait été implicitement confirmé dans les premiers
traités de commerce qu’avaient conclu les sultans Almoravides,
Almohades et Mérinides avec les puissances européennes de l’époque.
Le dépôt de l’état de chargement des navires qui est l’équivalent du
manifeste commercial était souvent prévu expressément dans certaines
conventions. Nous avons également pu remarquer que dans les anciens
traités la douane avait la possibilité de demander la traduction des
états de chargement. Tout cela confirme le caractère écrit de la
déclaration sommaire traité par les douanes au Maroc dès le XIème
siècle. Comment donc peut-on imaginer d’abord et justifier ensuite
l’absence de déclaration écrite en détail dans le système
traditionnel du dédouanement au Maroc?
Nous avons pu noter
dans la description des procédures de dédouanement du temps des
Almohades que les techniques douanières étaient très développées à
l’époque. Dès leur débarquement, les marchandises étaient présentées
à la douane pour inscription sur un registre ad-hoc avant d’être
entreposées soit dans les magasins des douanes soit dans les
foundouks. La douane procédait ainsi à une prise en charge comptable
systématique de toutes les marchandises en mouvement dans les
enceintes portuaires ou dans les foundouks.
Par ailleurs, nous
avons constaté à travers l’analyse du système des oumana que ces
derniers tenaient des registres spécifiques aux opérations de
dédouanement. Chaque opération était inscrite par des adoul sur le
registre douanier. Ceci équivalait à une déclaration en détail
écrite qui avait en outre le caractère juridique et officiel du fait
de la transcription adoulaire.
On peut, dès lors,
déduire que les opérateurs du commerce extérieur avant l’avènement
de l’acte d’Algésiras, déclaraient verbalement leurs marchandises
pour leur affecter un régime douanier. L’article 82 de l’acte d’Algésiras
constitue-t-il à cet égard le fondement juridique de la déclaration
en détail par écrit dans l’histoire de la douane marocaine ? Seule
une recherche minutieuse des archives manuscrites nous permettrait
de répondre à cette interrogation. Mais au niveau des investigations
entreprises, nous pouvons considérer que cet article constituerait
la base de l’obligation qui fut faite aux opérateurs du commerce
extérieur de déposer une déclaration en détail par écrit, au moment
du dédouanement des marchandises importées ou présentées à
l’exportation. Cette obligation fut définie dans les mêmes termes
que celle découlant de l’actuel article 65 du code des douanes
marocaines. Toutefois, le texte d’Algésiras de 1906 ne spécifiait
pas la liaison entre la déclaration en détail et le régime douanier
à assigner à la marchandise.
L’objet de la
déclaration en détail était également défini par le même article 82
de l’acte d’Algésiras. La déclaration douanière devait énoncer l ’ e
s p è c e , la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la valeur
des marchandises ainsi que l’espèce, les marques et les mesures des
colis qui les emballent. La fourniture des formules destinées à
établir les déclarations en détail semble avoir incombé à
l’administration douanière du moins jusqu’au 1er janvier 1919. En
effet, depuis cette date un arrêté du Grand Vizir Mohammed El Mokri
imposait aux déclarants en douane l’établissement en doubles
exemplaires, des déclarations en détail133.
Les formules types
de ces déclarations avaient été déposées aux sièges des chambres de
commerce et dans les bureaux de douane. Désormais, leur
approvisionnement était libre dans le commerce sous la seule
condition d’observer le format et dans le libellé, les indications
déterminées par le modèle officiel. Curieusement, l’arrêté du 22
juillet 1918, ne faisait pas référence aux dispositions du règlement
du 10 juillet 1908 sur les formules des déclarations en détail qu’il
avait abrogé en fait134.
Il convient de
préciser à cet effet que le comité permanent des douanes, institué
par l’article 97 de l’acte général de la conférence d’Algésiras,
avait instauré depuis le 10 juillet 1908 un nouveau modèle de
formule de déclaration en détail. Ce document était fourni aux
déclarants par les oumana des douanes au prix de 0,05 hassani /
pièce.
Régime de la
vérification des marchandises :
Un nouveau régime
de vérification des marchandises fut instauré par la convention
d’Algésiras en rapport avec la souscription de la déclaration en
détail à la douane. Les litiges, qui pouvaient se présenter à
l’occasion de la vérification matérielle des marchandises par la
douane, étaient réglés différemment selon l’objet et l’importance de
l’inexactitude constatés. Mais, dans tous les cas, la justification
de la bonne foi était toujours profitable au déclarant. Ainsi, en
cas de déficit, le déclarant devait payer une amende de deux fois
les droits et taxes dus sur les articles manquants. Les marchandises
présentées étaient retenues en douane pour la sûreté de la
perception de l’amende. Si au contraire il était constaté un
excédent quant au nombre de colis, à la quantité ou au poids des
marchandises, l’excédent était saisi et confisqué au profit du
makhzen. Lorsque le service des douanes constatait une fausse
déclaration d’espèce ou de qualité, les marchandises étaient
également saisies et confisquées.
En matière de
contestation de la valeur en douane, les rédacteurs de la convention
d’Algésiras s’étaient manifestement inspirés des directives du dahir
de 1862 du Sultan Moulay Abderrahman sur les douanes. Ainsi, peut-on
noter que l’article 85 de l’acte d’Algésiras stipulait que dans le
cas où la déclaration serait reconnue inexacte quant à la valeur
déclarée, la douane pourra soit prélever le droit en nature séance
tenante, soit au cas où la marchandise est indivisible, acquérir
ladite marchandise, en payant immédiatement au déclarant la valeur
déclarée, augmentée de 5 %.
L’application des
dispositions de l’article 85 de l’acte d’Algésiras requiera de vives
protestations des importateurs américains spécialement.
Dans une lettre
adressée au directeur des douanes et régies au Maroc en date du 13
novembre 1934, le Consul des Etats-Unis d’Amérique George D. Hopper
signalait que cinq firmes avaient présenté des plaintes au consulat
et exigeait sous forme d’ultimatum, la régularisation de leur
situation.
Les sociétés
requérantes affirmaient qu’elles n’avaient aucun désir de payer le
montant des droits en nature, mais que devant les exigences de la
douane elles ont été acculées à demander le paiement en nature,
seule alternative à leur disposition pour terminer la liquidation
des droits et finir la transaction ……..135.
Au plan
procédurale, une particularité a été introduite dans la législation
douanière de 1906 en ce qui concerne les résultats de la
vérification matérielle. Elle consistait en la distinction entre la
fausse déclaration d’espèce et la fausse déclaration de nature des
marchandises . Cette dernière était tout simplement considérée comme
un acte de contrebande.
La perception des
droits et taxes :
L’acte d’Algésiras
avait instauré un régime de recouvrement des droits et taxes basé
sur le paiement au comptant au bureau de douane où il aurait été
procédé à la liquidation de ces droits tant à l’importation qu’à
l’exportation. Il a été également instauré le principe de la
liquidation ad valorem. C’est-àdire en tenant compte de la valeur au
comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau de douane et
franche des droits de douane et magasinage.
En cas d’avarie, il
était tenu compte dans l’estimation, de la dépréciation subie par la
marchandise.
L’enlèvement des
marchandises n’était autorisé qu’après paiement des droits de douane
et de magasinage. Toute prise en charge de marchandise ou perception
de droit était attestée par la délivrance d’un récépissé régulier
délivré par l’agent des douanes, chargé de l’opération.
L’aconage et le
magasinage :
L’acte d’Algésiras
perpétuait une constante politique des douanes marocaines depuis le
Xème siècle qui conférait aux agents du service le soin de prendre
matériellement en charge les marchandises dans les enceintes de
dédouanement. Ainsi, dans les douanes où il existait des magasins
suffisants, le service des douanes était tenu de prendre en charge
les marchandises débarquées à partir du moment où elles étaient
remises, contre récépissé, par le capitaine du bateau aux agents
préposés à l’aconage jusqu’au moment où elles étaient régulièrement
dédouanées.
Le service était,
en outre, responsable des dommages causés par les pertes ou avaries
des marchandises qui étaient imputables à la faute ou à la
négligence de ses agents. Il n’était toutefois pas responsable des
avaries résultant soit des dépérissements naturels de la
marchandise, soit de son trop long séjour en magasin, soit des cas
de force majeure. Dans les enceintes où la douane ne possédait pas
de magasins suffisants, les agents du makhzen étaient tenus
d’employer les moyens de préservation dont disposait le bureau de la
douane.

Problématique de la
définition de la valeur en douane :
La définition de la
valeur taxable en douane a été réglée par les articles 95 et 96 de
l’acte d’Algésiras. La valeur des principales marchandises était
déterminée chaque année par une commission des valeurs douanières
qui se réunissait à Tanger. Cette commission se composait de :
- trois membres
désignés par le gouvernement marocain ;
- trois membres
désignés par le corps diplomatique de Tanger ;
- un délégué de la
Banque d’Etat ;
- un agent de la
délégation de l’emprunt marocain de 1904.
La commission
devait nommer douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc,
qu’elle consulterait quand il s’agirait de fixer les valeurs et
toutes les fois qu’elle le jugera utile. Ces consultants étaient
choisis sur les listes des notables, établies par chaque légation
pour les étrangers et par le représentant du Sultan pour les
marocains. En principe, ils étaient désignés autant que possible,
proportionnellement à l’importance du commerce de chaque nation. La
durée du mandat des consultants était de trois ans.
Dans un rapport
établi par le conseiller du commerce extérieur de la France, le
Docteur Lucien Graux cite un extrait du procès verbal de la réunion
de la commission des valeurs du 7 Juin 1933 à Tanger. La commission
notait que ”Le service des douanes de la zone espagnole adoptait
comme élément d’appréciation pour l’application des droits : la
facture d’origine, les frais de transport jusqu’au port importateur,
la valeur de la marchandise sur le marché local à l’arrivée, les
mercuriales et tout autre renseignement pouvant être utile pour
fixer la valeur imposable”
Le tarif des
valeurs fixées par la commission, servait de base aux estimations
qui étaient faites dans chaque bureau par l’administration des
douanes. Ce tarif était affiché dans les bureaux de douane et dans
les chancelleries des légations et des consulats à Tanger. Il était
susceptible d’être révisé au bout de six mois si des modifications
notables intervenaient dans la valeur de certaines marchandises.
L’application des
dispositions de l’acte d’Algésiras sur la valeur en douane fut
marquée sur le plan historique notamment par la grande controverse
qui avait abouti à un affrontement juridico-politique entre la
France et les Etats-Unis. En effet après l’établissement du
protectorat français au Maroc en 1912, les Etats-Unis d’Amérique
avaient remis en question l’interprétation de l’article 95 de l’acte
d’Algésiras sur la valeur en douane. Par une série de notes
adressées à la résidence générale, les consuls des Etats-Unis
n’avaient guerre cessé de demander le changement de la méthode
d’évaluation des marchandises pratiquée par les douanes
chérifiennes. Ce litige avait d’ailleurs fini par être porté devant
une instance juridictionnelle internationale tellement l’enjeu était
important. Le Gouvernement Américain estimait qu’avant 1912, la
valeur retenue par la douane correspondait à la valeur d’achat au
pays d’origine augmentée des frais de transport et d’aconage.
Ainsi, peut-on
noter dans le contre mémoire présenté à la cour de justice
internationale que Monsieur Luret, délégué du contrôle de la dette
écrivait dans une lettre du 16 juillet 1912 concernant la firme
américaine Vacuam Oil Company :
“Cette valeur
comporte le prix d’achat du pétrole FOB New York, augmenté de tous
les frais postérieurs à l’achat, tels que les droits de sortie
acquittés aux douanes étrangères, le transport, l’emballage, le
frêt, l’assurance, les manipulations, le débarquement, etc… en un
mot, tout ce qui contribue à former au moment de la présentation au
bureau de douane, la valeur au comptant et en gros du produit
suivant laquelle doivent, d’après l’article 95 de l’acte
d’Algésiras, être liquidés les droits”.
Après 1912, les
services douaniers marocains assirent les droits en partant des prix
du marché marocain. Cette mesure provoqua les protestations du
gouvernement américain. Mr Sweeney, avocat du gouvernement américain
déclarait à ce propos que “l’innocente petite soustraction proposée
par le gouvernement français à partir du prix du marché intérieur
n’est pas aussi simple que cela, car le prix de la marchandise sur
le marché intérieur ne comprend pas seulement le prix d’achat et les
droits de douane. Il comprend encore une quantité de facteurs tels
que les frais encourus après passage en douane pour manipulation,
emballage, transport, commissions, frais généraux et bénéfices”.
Pour sa part, la
France dans ses mémoires à la Cour estimait qu’une appréciation
fondée comme l’entendait la légation des Etats-Unis sur le prix de
revient dans leur pays d’origine des produits d’importation
aboutirait, inévitablement, à frapper au même moment de taxes
différentes des marchandises identiques, suivant leur provenance,
les circonstances de leur vente ou les variations des changes, ce
qui aurait précisément pour effet de contrevenir à la règle
d’uniformité de taxation sur laquelle repose tout l’esprit et la
lettre du régime douanier institué par l’acte d’Algésiras.
Cette
considération, ajoutait le mémorandum français a été retenue par la
cour de cassation, qui a adopté, en cette matière, les conclusions
des représentants de la douane chérifienne, dans un arrêt rendu le
29 juillet 1948136. En effet six voix contre cinq la Cour avait
décidé qu’elle était d’avis, que pour fixer aux fins de la douane la
valeur des marchandises importées, les autorités douanières de la
zone française avaient le devoir de prendre en considération les
facteurs suivants :
- les quatre
facteurs spécifiés à l’article 95 de l’acte d’Algésiras ;
- le contenu de la
déclaration qu’aux termes de l’acte, l’importateur doit faire à la
douane ;
- la valeur au
comptant et en gros sur le marché dans la zone française ;
- le coût dans le
pays d’origine, malgré des frais de chargement et de déchargement,
de l’assurance, du frêt et des autres frais encourus avant la remise
des marchandises au bureau de douane ;
- les tarifs des
valeurs, s’il en existe, préparés par la commission des valeurs
douanières, visés à l’article 96 ou par toute autre commission qu’a
pu lui être substituée par des arrangements auxquels la France et
les Etats-Unis avaient donné leur assentiment exprès ou tacite ;
- tout autre
facteur imposé par les conditions particulières à tel envoi ou à
telle espèce de marchandises.
Ces facteurs
n’étaient pas énumérés dans un ordre de priorité, ils devaient jouer
librement dans les limites établies ou à établir en vertu de
l’article 96 de l’acte d’Algésiras et, eu égard au principe
directeur de l’égalité économique, les mêmes méthodes devraient être
appliquées sans discrimination à toutes les importations quelles que
soient l’origine des marchandises ou la nationalité des
importateurs, le pouvoir d’évaluer appartenant aux autorités
douanières qui devaient en user raisonnablement et de bonne foi.
C’est d’ailleurs
cette thèse qui constitua le fil conducteur du législateur marocain,
pour déterminer la valeur en douane lors la réforme de la
législation douanière de 1977137.
Après l’adhésion du
Maroc à l’organisation mondiale du commerce, cette théorie fut
abandonnée et l’on adopta dès lors le principe du GATT sur
l’évaluation des marchandises en douane138.
Le comité permanent
des douanes :
Un comité permanent
dit “comité des douanes” était institué à Tanger en vertu des
dispositions de l’article 97 de l’acte d’Algésiras. Le comité était
composé :
- d’un commissaire
spécial de Sa Majesté le Sultan du Maroc ;
- d’un membre du
corps diplomatique ou consulaire désigné par le corps diplomatique
de Tanger ;
- d’un délégué de
la banque d’Etat du Maroc.
Un ou plusieurs
représentants du service des douanes pouvaient s’adjoindre à titre
consultatif aux travaux du comité. Le mandat des membres du comité
était fixé à trois ans. Le comité devait exercer une haute
surveillance sur le fonctionnement des douanes. Il pouvait proposer
au Sultan les mesures propres à apporter des améliorations dans le
service, et à assurer la régularité et le contrôle des opérations et
perceptions. Cet organe pouvait également élaborer, de concert avec
les services intéressés, les instructions proposées par la
commission des valeurs en douane.
Autres dispositions
douanières de l’acte d’Algésiras :
Le régime de
cabotage :
Un nouveau régime
douanier a été instauré pour la navigation du cabotage. Les
marchandises non soumises aux droits d’exportation, embarquées dans
un port marocain pour être transportées par mer dans un autre port
de l’empire, devaient être accompagnées d’un certificat de sortie
délivré par la douane, sous peine d’être assujetties au paiement du
droit d’importation et même confisquées, si elle ne figuraient pas
au manifeste.
Le transport par
cabotage des produits soumis au droit d’exportation ne pourrait
s’effectuer qu’en consignant au bureau de départ, contre quittance,
le montant des droits d’exportation relatifs à ces marchandises.
Cette consignation devait être remboursée au déposant par le service
des douanes du bureau où elle a été effectuée. Le déclarant devait
ainsi produire une copie de la déclaration revêtue par la douane de
la mention d’arrivée de la marchandise. Il devait en outre produire
la quittance de la consignation des droits en douane. Ces pièces
justificatives de l’arrivée de la marchandise devaient être
produites dans un délai n’excédant pas trois mois depuis la date
d’expédition. Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, les
sommes consignées devenaient propriété du makhzen.
Tout en instaurant
un nouveau régime de cabotage, le règlement douanier issue de l’acte
d’Algésiras avait sauvegardé le système du cabotage intérieur, crée
par le makhzen depuis 1862. Ainsi, l’article 69 de l’acte
précisait-i l que :
“Conformément aux
décisions antérieures de Sa Majesté chérifienne et notamment à la
décision du 28 septembre 1901, est autorisé entre les ports de
l’empire le transport par cabotage des céréales, graines, légumes,
oeufs, fruits, volailles et en général des marchandises et animaux
de toutes espèces, originaires ou non du Maroc, à l’exception des
chevaux, mulets, ânes et chameaux , pour lesquels un permis spécial
du makhzen était nécessaire. Le cabotage intérieur s’effectuait par
des bateaux de toute nationalité en exonération des droits
d’exportation. Les articles étaient toutefois assujettis aux droits
spéciaux et aux règlements sur la matière”.
Institution de
nouvelles taxes douanières :
La conférence
d’Algésiras se ralliant à la proposition faite par la délégation
marocaine avait établi un droit de statistique et de pesage, au
maximum de un pour cent ad valorem, sur les marchandises
transportées par cabotage.
Une taxe spéciale
sur l’importation des marchandises d’origine étrangère fut également
établie à titre temporaire au taux de deux et demi pour cent ad
valorem. Le produit intégral de cette taxe devait former un fonds
spécial pour les dépenses d’exécution de travaux publics destinés au
développement de la navigation et du commerce. Le caractère
provisoire de cette nouvelle taxe illustre bien l’adage : “le
provisoire qui dure”. En fait, la douane avait continué à percevoir
cette taxe plusieurs dizaines d’années après l’indépendance. Son
taux fixé initialement à 2,5 % en 1906 passa de 5 % en 1973 à 15 %
en 1979 avant d’être ramené à nouveau à 5 % en 1987. Elle fut
finalement remplacée à partir de 1988 par une autre taxe d’effet
équivalent, le prélèvement fiscal à l’importation au taux de 12,5 %.
Cette dernière a été finalement intégrée dans les taux du tarif des
droits d’importation par la loi des Finances du 28 juin 2000139

NAISSANCE D’UN RÉGIME
DOUANIER
SPÉCIFIQUE AU MAROC
ORIENTAL
Au Maroc oriental,
tout porte à croire que le régime douanier qui était applicable
avant le protectorat fut étroitement lié aux grandes mutations
politico-économiques qu’avait connu cette région depuis la naissance
de l’Etat islamique au Maroc. L’histoire des douanes au Maroc a été
intimement liée à l’activité commerciale de ses côtes maritimes. A
ce niveau la démarcation géographique des frontières avait coïncidé
avec une démarcation d’ordre spirituel : la théorie théologique en
Islam considérait que la terre d’Islam était en elle même une zone
douanière unique. On peut conclure donc que la réglementation
douanière dans cette région a été pendant très longtemps
d’application aléatoire. De plus, le makhzen qui percevait, avec les
difficultés qu’on connaît les droits et taxes dans les ports,
n’avait pas pu instaurer de structures douanières stables dans la
zone. L’usage consistait, dans la pratique, à faire payer à toute
caravane partant vers l’orient des droits perçu généralement aux
portes de Fès ou de Sijilmassa. Par ailleurs, il y a lieu de noter
que depuis le XIème siècle la délimitation du territoire douanier
marocain subissait de grandes variations en fonction de l’évolution
du pouvoir politique établi par les différentes dynasties régnantes.
Cet état de fait
avait été consolidé expressément dans le traité franco-marocain de
Lalla Maghnia du 18 Mars1845140. En 1867, le gouvernement français
promulgua une loi admettant en Algérie au bénéfice de la franchise,
les produits marocains importés par voie terrestre.
Le régime
algéro-marocain à l’importation :
Un régime douanier
spécifique à cette zone avait ainsi commencé à se développer. Les
bases de ce régime ont été instaurés par les accords de 1901 et
19021 4 1. L’accord du 20 juillet 1901, avait prévu, dans ce cadre,
l’institution de postes de douane jusqu’à Figuig142. Pour assurer le
contrôle de l’activité commerciale et la perception des droits et
taxes le long des frontières, des bureaux ont été ouverts à Saïdia,
AJeroud et Oujda côté marocain et à Magoura, Ajeroud et Maghnia pour
l’Algérie.

Un protocole du 7
mai 1902 permettait au makhzen de percevoir des droits de transit
qui étaient en faits de véritables droits de douane à l’entrée et/ou
à la sortie. A l’importation, le tarif de transit était fixé à cinq
pour cent ad valorem sauf pour un certain nombre d’articles pour
lesquels les droits étaient spécifiques. Par contre, à l’exportation
les droits spécifiques étaient établis sauf pour quelques
marchandises qui devaient être taxées sur la base de la valeur en
douane. Ces droits étaient dans la pratique recouvrés par les
services du haut commissariat du gouvernement à Oujda. En 1912, pour
les droits de transit, la recette globale fut de l’ordre de 628.000
francs. Les droits de transit avaient produit durant la même année
115.000 francs143.
Le même droit de
transit avait été instauré par l’accord hispano marocain du 17
novembre 1910 à la frontière avec Mellilia qui a rétabli le bureau
de douane marocaine. En fait, avec les événements survenus suite à
la révolte de Rougui dit “Bouhmara”, la douane marocaine a du se
replier sur le préside de Mellilia. Le dissident marocain avait
institué à “Selouane” sa propre “douane”qui agissait d’une façon
anarchique en percevant des redevances arbitraires sur le mouvement
des marchandises transitant par la région soumise à son contrôle.
Le régime
maroco-algerien a l’exportation :
Au début de
l’occupation française de l’Algérie, les importations des
marchandises étaient prohibées par ordonnance du 16 décembre 1843.
Cette prohibition fut en fait théorique car ce n’était que le 11
août 1853 qu’un décret institua un service des douanes sur les
frontières de la Tunisie et du Maroc. Cette loi avait levé la
prohibition générale pour les produits d’origine marocaine et
instaura des droits modérés à l’importation en Algérie. Un régime
douanier définitif avait enfin été instauré par la loi du 17 juillet
1867 sur le régime commercial de l’Algérie. Les produits figurant
aux tableaux A et B de cette loi, importés par mer du Maroc étaient
soumis à un droit spécifique. Par contre les produits importés par
voie terrestre furent exonérés des droits et taxes à condition
qu’ils fussent originaires du Maroc.
LA DOUANE ET LE
PROTECTORAT FRANÇAIS
DANS LE MAROC ORIENTAL
Les questions
financières en général et douanières en particulier furent le
premier sujet de préoccupation des autorités coloniales françaises
au moment de l’occupation militaire de la ville marocaine d’Oujda.
Les autorités militaires qui s’étaient vu refuser les dotations
supplémentaires réclamées auprès du Ministère des Finances à Paris
avaient conclu que seule la maîtrise des revenus des finances
publiques locales leur permettaient de mettre en pratique leurs
projets d’occupation.

Jusqu’au début du
XXème siècle, les bureaux des douanes à Oujda et Ajroud furent les
seules structures douanières qui contrôlaient l’activité du commerce
extérieur par voie terrestre dans l’oriental. Ils procuraient aux
Trésor du makhzen des recettes non négligeables. A ce titre, dès
1907 les douanes du Maroc oriental avaient été mises sous la
gestion, plus ou moins directe, des autorités de l’occupation. En
effet, dès le mois d’avril 1907, l’officier interprète Martinot fut
désigné pour gérer les douanes de l’oriental144. Tout le personnel
douanier en fonction y compris les oumana Mohamed Berrada et Tahar
Lazrak fut maintenu en poste. Une année après, cette mission a été
confiée à un capitaine des douanes françaises en Algérie nommé
Pandori143.


Tout en maintenant
le système traditionnel de gestion des comptes, la nouvelle
administration introduisit des aménagements de forme dans la gestion
des douanes.
Ainsi, deux agents
des douanes algériennes furent nommés à Oujda. Une séparation des
écritures comptables des recettes et dépenses fut introduite par
l’institution de deux registres distincts. Le 11 Mars 1908, le poste
douanier de la Kasbaa Bouajroud à Saïdia situé à l’embouchure de
l’oued Kiss a été réouvert pour drainer de nouvelles recettes
douanières et lutter efficacement contre la contrebande. L’ex amine
des douanes à la résidence Ahmed Ben Tayaa a été rappelé au service
après avoir suivi un stage de perfectionnement au bureau d’Oujda. Il
était assisté d’un fonctionnaire des douanes algériennes dont la
mission consistait à délivrer les quittances de dédouanement aux
redevables. Ce contrôleur était chargé également de tenir un
registre spécial des recettes douanières. Cette mission a été confié
au sous lieutenant Piétri1 4 6. Pour des raisons de sécurité, les
fonds provenant des recettes douanières étaient déposés auprès du
receveur des douanes du port algérien de Say147 avant d’être
acheminés au bureau central à Oujda.
Cette gestion
directe des douanes marocaines fut la conséquence de la pression
systématique qu’exerçaient les autorités coloniales françaises
d’Algérie sur le makhzen marocain. Pour contenir ce forcing, le
gouvernement du Maroc s’engagea avec la France dans un processus de
négociations diplomatiques dont les aspects douaniers furent
toujours évoqués. Dans ce cadre, le protocole de Paris du 20 Juillet
1901 intervenu entre M. Declassé, Ministre des Affaires Etrangères
de la République Française, et Si Abdelkrim Ben Slimane, Ministre
des Affaires Etrangères et Ambassadeur plénipotentiaire du Sultan du
Maroc auprès du gouvernement de France, stipulait dans son article
deux que :
“le makhzen pourra
établir des postes de garde et de douane en maçonnerie ou sous une
autre forme, à l’extrémité des territoires des tribus qui font
partie de son Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniet-
Essassi, jusqu’au Qçar de Isch et au territoire de Figuig”.
L’article quatre du
même protocole précisait en outre :
“Le gouvernement
marocain pourra établir autant de postes de garde et de douane qu’il
voudra du côté de l’Empire Marocain, au delà de la ligne qui est
considérée approximativement comme la limite de parcours des
Dani-menia et des Ouled Djerir et qui va de l’extrémité du
territoire de Figuig à Sidi-eddaher, traverse l’Oued El Kheroua et
atteint, par le lieu connu sous le nom d’Elmorra, le confluent de l’Oued-telzaza
et de l’Oued-Guir. Il pourra également établir des postes de garde
et de douane sur la rive occidentale de l’Oued Guir, du confluent
des deux rivières sus dites jusqu’à 15 kilomètres au dessus du Qçar
d’Igli.
De même, le
gouvernement français pourra établir des postes de garde et de
douane sur la ligne voisine de Djenan-Eddar, passant sur le versant
oriental du Djebel Bechar et suivant cette direction jusqu’à
l’Oued-Guir.
En vue de
développer les transactions commerciales un accord signé le 20 Avril
1902 à Alger par l’ex amine des douanes Si Mohammed El Guebbas du
côté marocain et Cauchenuz du côté français préconisa que chacun des
deux gouvernements établira, dans les régions limitrophes, des
marchés ainsi que des postes chargés de la perception des droits qui
seraient établis pour augmenter les ressources et les moyens
d’action des deux pays. Cependant, au moment de la ratification de
cet acte qui n’était intervenu pour le Maroc que le 16 décembre
1902, le makhzen avait émis des réserves au sujet de l’installation
du dispositif douanier. Ainsi, a été ajoutée, par accord subséquent
la mention ci-après :
“le gouvernement
marocain après avoir examiné le présent accord, l’a trouvé conforme
aux nécessités du voisinage. Comme l’établissement des douanes
prévues au protocole de Paris, pour la perception des droits de
douane, est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé
de l’ajourner jusqu’au moment où il sera possible, et de se borner
actuellement à percevoir les droits de marché et de passage …”


RÉGIME DOUANIER
PARTICULIER AUX RELATIONS COMMERCIALES
PAR VOIE TERRESTRE
ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC
En dépit des
réserves marocaines sur l’installation de nouvelles structures des
douanes au Maroc Oriental, un nouvel accord a été signé entre les
deux parties à Alger le 7 mai 1902. Cette nouvelle convention
consacrait en pratique le régime douanier particulier qui avait
toujours existé pour les relations par voie de terre entre l’Algérie
et le Maroc. Ainsi, le makhzen eut-il le maintien de sa faculté
d’établir les droits de sortie et ou les droits de transit sur les
marchandises présentées à l’exportation. D’autre part, le
gouvernement français avait déclaré son intention d’appliquer ou de
maintenir, conformément à sa législation en vigueur, les droits de
statistique et de taxe sanitaire. Des tarifs douaniers ont été
établis par l’article premier de l’accord. Ces tarifs ne pouvaient
faire l’objet de modification sans accord préalable des deux
parties. Ils comptaient d’une part les droits de transit pour les
marchandises importées au Maroc. D’autre part des droits de sortie
ont été instaurés pour certains produits en provenance du Maroc
Tarifs douaniers prévus
par le protocole d’Alger du 7 mai 1902


Ce tarif semble
avoir été appliqué jusqu’au 1er janvier 1922. A partir de ce moment,
les marchandises importées au Maroc par la frontière algéromarocaine
étaient uniformément passibles d’un droit de douane de 5 % sur leur
valeur au point où elles sont déclarées. Al’exportation, les droits
de sortie étaient les mêmes que ceux perçus dans les ports. Il
s’agissait là d’une mesure provisoire148 qui fut la première étape
d’une série de décisions réglementaires qui régiront les douanes du
Maroc Oriental. Ainsi, après avoir fixé un règlement douanier
spécifique à la gare internationale d’Oujda, l’administration du
protectorat établit un nouveau régime douanier des confins
algéro-marocains149. A partir du 1er janvier 1924, les produits et
marchandises autres que ceux d’origine marocaine, passant de la zone
du Maroc Oriental dans la zone du Maroc Occidental, étaient
assujettis aux mêmes droits que ceux appliqués dans les ports
maritimes, sans déduction, toutefois, de la taxe acquittée à la
frontière algéro-marocaine. Il devraient en outre payer la taxe
spéciale de 2,5 % ad valorem prévue par l’article 66 de l’acte
général d’Algésiras. Les formalités douanières de dédouanement
s’effectuaient à Taza où un bureau de douane a été créé
provisoirement à cet effet. Le conduite des marchandises s’oppérait
soit par voie ferrée, soit par la route principale Oujda – Fès. Dès
leur arrivée au bureau de douane à Taza, les marchandises devaient
faire l’objet de déclarations en détail réglementaires.
Ces mesures
provisoires destinées à prévenir les éventuels abus avaient été
édictées par une conjoncture spéciale et spécifique, que l’arrêté
visiriel instituant ce régime douanier contresigné en personne par
le Maréchal de France Commissaire Résident Général Lyautey, résumait
dans un long préambule comme suit :
“Vu les accords
franco-marocains des 7 avril et 20 mai 1902 qui ont établi, pour la
région des confins algéro-marocains un tarif spécial de douane en
faveur des marchandises françaises et algériennes ;
Vu l’accord
franco-britannique du 8 avril 1904 et les traités de commerce
ultérieurs, par lesquels la France a accordé le même régime aux
marchandises de toute origine, avec faculté de transit à travers
l’Algérie ;
Vu l’accord
hispano-marocain du 17 novembre 1910 qui a assimilé, au point de vue
douanier, la frontière du préside de Mellila à la frontière
algéro-marocaine ;
Attendu que les
accords de 1902 n’avaient en vue qu’un arrangement de bon voisinage
;
Attendu que le
règlement des douanes de l’acte d’Algésiras en stipulant, en son
article 103, que dans la région frontière de l’Algérie,
l’application du règlement douanier restera l’affaire exclusive de
la France et du Maroc, a confirmé le caractère purement frontalier
du régime issu des accords de 1902 ;
Attendu que,
jusqu’à 1919 et 1920, la délimitation de la région frontalière
susvisée s’est trouvée établie d’elle même tant par le défaut total
de voies de communication entre le Maroc Oriental et le Maroc
Occidental que par l’insécurité de la région intermédiaire ;
Attendu que, depuis
cette époque, la pacification du pays et, d’autre part, l’ouverture
de routes et d’une voie ferrée ont crée une situation entièrement
nouvelle, qui a eu pour conséquence une dérivation de trafic très
considérable ;
Attendu que cette
dérivation de trafic compromet gravement la situation économique et
budgétaire du Maroc ;
Attendu que, pour
remédier à cet état de choses et, après avoir, d’accord avec le
Gouvernement Français, envisagé différentes solutions, le
Gouvernement chérifien a proposé de procéder à une délimitation
concertée de la zone des confins ;
Attendu que cette
proposition, prise en considération et adoptée en principe, demande,
pour être réalisée, des délais au cours desquels des stocks peuvent
être accumulés et des spéculations sont à craindre”.
RÉINSTALLATION DES
DOUANES MAROCAINES
DANS LA RÉGIONE DE
MELILLA - 1910 -
Le projet de traité
de commerce qui fut, le 26 janvier 1861 entre les mains des
plénipotentiaires marocains contenait un article stipulant l’étab
lissement de douanes aux frontières des territoires occupés à Sebta
et Mellilia. A la signature à Madrid de la convention, le
négociateur espagnol Carlderon Collantes avait dû céder devant
l’intransigeance du Prince Moulay Abbas qui avait des instructions
formelles du Sultan de ne pas céder sur ce point. Les grands
avantages qu’attendait l’Espagne disparurent car le Sultan
n’autorisa pas l’installation des douanes à la frontière des
présides. Le gouvernement espagnol n’avait sans doute pas abandonné
son idée et à peine les ratifications du traité de commerce
furent-elles échangées (avril 1862) et les clauses en devinrent
obligatoires, il chargea son Ministre d’Etat d’entreprendre des
négociations avec le gouvernement marocain afin de modifier
l’article 45 du traité du 20 novembre 1811 et obtenir
l’établissement de douanes et le commerce par terre de toutes
espèces de marchandises.
En juin 1866, Merry
Y Colom émissaire spécial recevait ordre formel pour traiter
directement de cette affaire avec le Sultan du Maroc en vertu du
privilège que l’agent diplomatique de l’Espagne tenait de l’article
12 du traité de paix maroco-espagnol. Ainsi, le diplomate se rendit
à Fès et aurait été le premier représentant de l’Espagne qui
pénétrait dans l’antique et célèbre cité de Moulay Idriss al
azhar150. Le Ministre des A ffaires Etrangères marocain présenta la
demande espagnole au diwan du makhzen, réuni en session
extraordinaire à la mosquée karaouiine. Il se fit accuser de
trahison. Devant l’intransigeance des oulama de Fès et d’un makhzen
conservateur et intransigeant, l’Espagne devait recourir à
l’arbitrage du Sultan pour obtenir l’établissement de la douane à
Mellilia et la promesse que “si celle-ci ne s’avérait pas trop
pernicieuse, le makhzen consentirait à
l’établissement d’une autre douane à
Ceuta1 5 1”
Un accord pour
l’établissement d’une douane à la frontière de Mellilia a été signé
à Fès le 31 juillet 1866 avec objectif de convertir Mellilia en
dépôt de commerce du Rif et des riches tribus marocaines qui
peuplaient le territoire compris entre la côte de le Méditerranée et
le Tafilalet. Tenant compte de l’hostilité manifestée à cette
nouvelle création par les tribus avoisinantes, le makhzen ne procéda
à l’ouverture du bureau de Mellilia qu’en 1867. Pour plus de
sécurité, l’installation des locaux s’effectua dans la ville sous
domination espagnole152. Suite à la révolte de Rogui dit Bouhmara
dans l’oriental, les oumana des douanes du Sultan du Maroc à
Mellilia ont dû se replier à partir de 1907. Depuis, Rogui avait
instauré sa propre douane à Sélouane. Selon Augustin Bernard153, la
douane de Bouhmara fut gérée d’une manière passablement fantaisiste
et arbitraire154.

L’accord de Madrid
du 17 Novembre 1910 signé par Manuel Garcia Prieto, Ministre d’Etat
Espagnol et Si Mohammed El Mokri, Ministre des Affaires Etrangères,
des Finances et des Travaux Publics prévoyait la réinstallation, par
le makhzen, des douanes marocaines dans la région de Melilla.
L’emplacement des postes dont se composait la ligne douanière
devrait être déterminé d’un commun accord par les hauts commissaires
espagnols et marocains. Selon les dispositions de l’accord, les
droits à percevoir ne devraient pas être plus élevés que ceux perçus
à n’importe quelle autre frontière du Maroc. Le gouvernement de sa
Majesté catholique devrait mettre également à la disposition du
Sultan du Maroc, un fonctionnaire du corps des experts des douanes
espagnoles, qui aura qualité pour intervenir dans la vérification
des marchandises, la perception des droits, la comptabilité etc.… Ce
fonctionnaire des douanes chérifiennes devrait être nommé par les
deux hauts commissaires marocain et espagnol.
Le statut des
oumana et des adoul demeura inchangé. L’accord stipulait à cet égard
que les agents de ce corps spécifique de la douane marocaine étaient
nommés et révoqués par le Sultan. Pour chaque nomination, le haut
commissaire marocain devait présenter au souverain une liste de
quatre candidats arrêtée de concert avec le haut commissaire
espagnol. Les traitements des agents des douanes, comme celui du
fonctionnaire espagnol, étaient à la charge des recettes de la
douane de Mellilia.
Tentative
d’installation d’un bureau de douane à Sebta :
Le projet
d’ouverture d’un bureau marocain de douane à Sebta semble avoir été
énergiquement contrecarré par la France. C’est ce qui ressort d’un
rapport confidentiel de l’Ambassade de France à Londres en date du
20 octobre 1910155.
D’après le
représentant diplomatique français, la création d’un bureau de
douane dans cette zone aurait dû atteindre directement les intérêts
des obligataires des emprunts 1904 et 1910, emprunts gagés sur tous
les revenus douaniers des ports du Maroc. En effet, les dispositions
du traité hispano-marocain de 1861 n’avaient pas prévu de douane à
Sebta. Elles réglementaient cependant les transactions locales liées
à l’approvisionnement de la ville.
En conséquence, le
commerce international était interdit par le makhzen entre le port
de Sebta et l’intérieur marocain, car on estimait que les ports de
Tanger et Tétouan étaient suffisamment rapprochés de l’Andjera pour
desservir la région.

D’après l’analyse
des représentants diplomatiques, l’installation d’une nouvelle
douane marocaine à Sebta aurait eu pour conséquence le détournement
des trafics des ports de Tanger et Tétouan. Elle aurait pu favoriser
la pénétration dans l’Andjera par les nombreuses criques d’un côté
très découpée et difficile à surveiller. Après leur débarquement,
les marchandises seraient en fait insaisissables sur les routes de
terre.
La réserve
recommandée avait finalement prévalu sous une forte pression
diplomatique française. Cette hypothèse se trouve confirmée dans les
conclusions de l’Ambassadeur de France en Grande Bretagne qui
concluait en 1910 :
“le makhzen paraît
donc fondé à craindre que la mesure projetée lèse les droits de
l’Administration de la Dette marocaine. Le Gouvernement de la
République pense, de son côté, qu’une douane nouvelle placée à cet
endroit pourrait être difficilement représentée comme répondant à
des conditions géographiques et comme justifiée par un intérêt
économique important. Il espère que le Gouvernement Royal voudra
bien reconnaître l’avantage qu’il y aurait à ne pas lier une
question de cette nature à des négociations qui ont pour but de
régler les difficultés survenues entre l’Espagne et le Maroc, alors
que le régime appliqué depuis une cinquantaine d’années, en ce qui
concerne Ceuta, n’a pas compromis la sécurité du territoire
espagnol. Il est à craindre qu’une pression exercée sur le makhzen
au sujet de cette région risque de soulever de la part du corps
diplomatique à Tanger les mêmes objections qu’a motivées le projet
d’une route entre Ceuta et Tétouan.
Le maintien du statu quo se
recommande donc par des considérations sérieuses sur lesquelles le
gouvernement de la république appelle, dans l’esprit le plus amical,
l’attention du Gouvernement espagnol”.
Ambassade de France,
Londres
Le 20 octobre
1910156




L’UNITÉ DOUANIÈRE DU
MAROC
SOUS LE PROTECTORAT
Avant l’unification
douanière du Maroc concrétisée par la disparition, le 17 Février
1958, de la limite séparative des ex zones Nord et Sud, la
problématique de l’unité douanière, avait durant plusieurs décennies
fait l’objet d’un débat passionnel et passionné. Dans l’opposition
des thèses espagnole et française se heurtaient le principe de
l’unité du Maroc et celui de l’autonomie des zones que les
puissances coloniales entendaient y créer. Cette contradiction a eu
le mérite de déterminer les limites entre lesquelles devaient
s’effectuer l’arrangement franco-espagnol. Il s’agissait en fait, de
faire du Maroc un ensemble, tout en laissant une certaine liberté
d’action aux puissances dans leurs zones d’influence respectives.
Des liens avaient
été établis pour assurer la cohésion des zones au sein de l’Empire
Chérifien, corrigeant ce que la large autonomie des zones pourrait
avoir d’excessif, compléter la structure unitaire dans laquelle
prenaient place des zones d’administration autonome. L’institution
douanière, commune aux trois zones fut un des exemples qui illustra
pendant le régime du protectorat la solidarité conventionnelle et
quotidienne qui anima les différentes administrations.
L’organisation des
douanes au Maroc devait en effet tenir compte des clauses
conventionnelles découlant de plusieurs traités internationaux.
Parmi ces conventions, les conventions franco-allemande de 1911 et
franco espagnole de 1923, réservaient expressément que seraient
maintenus les traités antérieurs. Cette réserve concernait
spécialement les droits de douane. L’origine de cette clause
tarifaire réside dans les dispositions du traité anglo-marocain du 9
novembre 1856 conclu à Tanger et qui stipule dans son article 7 que
Sa Majesté le Sultan consentait à ce que les droits à percevoir sur
tous les articles importés dans ses territoires par des sujets
anglais n’excédassent pas 10 % de leur valeur au port de
débarquement.
En plus de cette
clause tarifaire fixant la limite des droits à l’importation, le
traité prévoyait une autre garantissant l’égalité de traitement des
commerçants des différentes nations. Le jeu combiné de ces deux
clauses allait étendre à tous les autres étrangers le tarif de 10 %
qui, de même, d’ailleurs, que tout droit ou charge sur les navires,
ne pouvait être plus bas pour les marocains ou les étrangers qu’il
ne l’était pour les sujets anglais. Le tarif de 10 % devenait
implicitement le tarif commun appliqué à tout le commerce extérieur
marocain à l’importation.

La conférence de
Madrid de 1880 confirma cette règle et étendit au concert des
grandes puissances la clause tarifaire en reconnaissant dans son
article 17 “le droit au traitement de la nation la plus favorisée à
tous les pays représentés à la conférence”. L’acte d’Algésiras
confirmait cette forme d’unité douanière à travers la clause
tarifaire.
A ces droits
acquis, l’introduction au Maroc du régime du protectorat n’apporta
aucune modification, mais, bien au contraire, de nouvelles
protections, dans son principe d’abord, puisque le respect des
traités passés antérieurement à son établissement est de l’essence
du protectorat, dans ses traités générateurs ensuite, puisque le
traité franco-allemand avait pour objets principaux de maintenir à
chaque puissance ses avantages économiques dans l’empire chérifien,
de confirmer une nouvelle fois les traités antérieurs et d’assurer
au Maroc une liberté commerciale stricte sans aucune inégalité. Deux
de ses articles traduisaient cette pensée :
L’article premier,
en réservant expressément que ”la liberté commerciale prévue par
les traités antérieurs serait maintenue”, mettait bien l’accent
sur la validité des traités antérieurs, tandis que l’article 4
faisait une mise au point précise : “le gouvernement français
fermement attaché au principe de la liberté commerciale au Maroc ne
se prêtera à aucune inégalité pas plus dans l’établissement des
droits de douane (impôts et autres taxes) que dans l’établissement
des tarifs de transport et toute question de transit. le
gouvernement français s’emploiera afin d’empêcher tout traitement
différentiel entre les ressortissants des différentes puissances”.
Ces clauses
devaient ainsi s’étendre à l’ensemble du territoire chérifien dont
elles réalisaient, en le soumettant à un seul et même régime
douanier, une unité à ce point de vue très ferme. C’est à la France,
investie du protectorat, qu’il appartenait de faire respecter leur
application. Cette mission allait de pair avec celle qui consistait
à rétablir et à maintenir l’ordre et la tranquillité, et assurer de
la sorte la sécurité des transactions. C’était pour la France une
obligation internationale. Il fallait que soit respectée l’unité
douanière du Maroc puisqu’elle était prévue par les traités et
réclamée par les puissances.
Aussi,
l’Administration du Protectorat avait-elle tenu à préserver les
accords de Madrid en 1912 et de Paris en 1923 à cet impératif, qui
apparaissait comme un des fondements du statut économique
international du Maroc.
Les accords
franco-espagnols surent, malgré l’existence d’administrations
douanières autonomes, établir une véritable unité douanière au
Maroc. Cette unité peut s’exprimer en ce que toute marchandise
entrant au Maroc par n’importe quel port, Tanger, Larache ou
Casablanca, n’est passible qu’une fois pour toutes de droits de
douane à l’importation qui sont les mêmes quel que soit le port
d’entrée158. Mais si cette garantie était aisée à donner dans son
principe1 5 9, elle était plus difficile à instituer, car
l’autonomie financière des zones posait le problème d’assurer à
chacune de celles-ci la recette des droits auxquels elles pouvaient
justement prétendre.
L’article 13, du
traité du 27 novembre 1912 fut-il consacré à la question douanière
pour poser le principe d’un système de balance dont des accords
postérieurs devaient préciser les modalités de fonctionnement.
“Le gouvernement
de la République Française et le gouvernement de Sa Majesté
Catholique se concerteront en vue de toutes les modifications qui
devaient être apportées dans l’avenir aux droits de douane”.
Il est remarquable
que sur ce point, les avants projets n’aient pas comporté de
divergences. L’article 12 du premier projet français ”les droits de
douane à l’entrée et à la sortie ne peuvent être modifiés dans
chaque zone que d’accord avec les deux puissances signataires sous
réserve des droits, stipulations et conventions en vigueur” n’était
que peu différent du texte espagnol (article 9). ”Les deux
gouvernements se concerteront en vue de toutes modifications qui
dans l’avenir devraient être apportées en ce qui touche les droits
de douane de l’empire sous réserve des traités en vigueur”, qui,
plus précis, et parlant paradoxalement de l’empire là où
exceptionnellement le projet français parlait zone.
Les deux projets
insistaient sur le respect des traités en vigueur et sur la
nécessité d’un accord dans l’éventualité de leur modification.
Pour les douanes,
la France ne proposait pas une unification de l’administration. La
question apparaissait en effet réglée et délimitée étroitement par
les traités en vigueur. Elle était presque extérieure à l’objet du
traité nouveau : la réglementation était déjà prescrite, élaborée,
et son application relèverait de chacune des administrations
zonières. Point n’était besoin à ce propos de règlements généraux.
La matière était étrangère aux réformes de rajeunissement et de
modernisation et leur préexistait. Mais elle intéressait le Maroc
entier, et si les droits de douane devaient être ultérieurement
modifiés, cette modification ne pourrait se faire, prescrit
l’article 19, qu’après qu’un accord soit intervenu entre la France
et l’Espagne. Le terme “concerté” exprime la nécessité d’un accord,
il ne doit pas être interprété restrectivement comme la simple
obligation pour chacun des gouvernements français et espagnol de
donner l’avis à l’autre des modifications qu’il aurait décidé
d’effectuer en la matière.
Si, en effet, les
tarifs douaniers pouvaient être modifiés, ils doivent, en vertu
d’une obligation internationale statutaire, être uniformément
appliqués dans chacune des zones, celles-ci devaient apparaître
comme constituant un seul et unique territoire douanier, malgré
l’existence de deux administrations différentes. Et cette nécessité
ne pouvait être satisfaite que par l’accord constant de la France et
l’Espagne. Mais chacune de ces zones devait tirer de ces droits de
douane des ressources légitimes. Une difficulté se posait alors,
celle d’assurer entre les budgets des zones la répartition équitable
du montant des droits perçus. Il fallait donc établir une
réglementation qui prévit les cas où les marchandises seraient
échangées entre les zones avant leur consommation finale. Cette
réglementation énoncée dans son principe par l’article 13 du traité
de Madrid, fut fixée par un accord franco-espagnol en date du 14
juillet 1931.
Par ailleurs
l’article 13 du traité du Madrid et la réglementation du 14 juillet
1931 instauraient le principe que les droits de douane et autres
taxes étaient exigibles dès que les marchandises entrent au Maroc.
Le Maroc était dés lors entouré d’une ceinture douanière sur les
limites de son territoire et ne constituait dés lors qu’un seul
territoire assujetti à la fiscalité et réglementation douanières.
Aussi pour des
marchandises débarquées à Larache à destination de la zone française
sur laquelle elles vont être acheminées ; les droits seront
acquittés à Larache à l’administration espagnole. Cependant, puisque
les marchandises doivent être consommées en zone française, il est
équitable que les droits de douane dont elles sont frappées
reviennent normalement à l’administration douanière de la zone
française qui, but de destination, est la raison de leur
importation. Il y a donc lieu d’assurer aux zones la part revenant à
chacune d’elles sur les droits de douane perçus à l’importation :
c’est ce qu’exprime l’article13 de l’accord de 1912.
Par ailleurs le
régime de transit a été rejeté : il portait atteinte au principe de
l’unité économique du Maroc comme seul territoire douanier, d’une
part. D’autre part, dans un pays où routes et chemins de fer étaient
quasiment inconnus, où le trafic se faisait par caravanes,
lesquelles suivaient des directions et non des pistes déterminées,
ce régime était impossible, la longueur de la ligne inter-zone
s’oppose de fait à l’institution d’un pareil système.
Enfin l’accord du
14 juillet 1931 consacra son titre premier aux marchandises
d’origine étrangère et édicte ensuite quelques dispositions
relatives aux taxes intérieures de consommation perçues sur ces
marchandises comme sur les produits marocains.
1) Marchandises
d’origine étrangère :
“Les recettes de
douane, de la taxe spéciale et des taxes intérieures de consommation
établies sur les marchandises qui, entrant par la zone espagnole,
sont destinées à la zone française, seront réservées par
l’administration espagnole à l’administration française aux
conditions particulières. Par réciprocité, les droits de douane, la
taxe spéciale et la taxe intérieure afférentes aux marchandises qui,
entrant par le port de la zone française, sont destinées à la
consommation de la zone espagnole seront reversées dans les mêmes
conditions par l’administration de la zone française à l’adresse de
la zone espagnole”.
Le principe est
aussi clairement énoncé par la convention. Tous les droits perçus
par un service sur les marchandises qui sont destinés à l’autre
zone, doivent être reversés par ce service à ladite zone. Mais le
reversement se fait dans des conditions différentes selon que les
échanges entre les zones se font par terre ou par mer.
a) Echanges de
marchandises par voie de terre ou voie ferrée :
La question était
donc de savoir quand et comment se fera la liquidation des droits.
Celle-ci sera effectuée dans des bureaux mixtes établis aux confins
des deux zones. Les marchandises expédiées d’une zone vers l’autre y
seront obligatoirement déclarées ; elles y seront vérifiées
simultanément par le service des douanes de chaque zone et
identifiées sur des registres spéciaux de statistique. Il était tenu
à cet effet deux registres : celui des marchandises allant de zone
espagnole en zone française, tenu par le service de la zone
française, et celui des marchandises de zone française en zone
espagnole, tenu par le service de la zone espagnole. Ces deux
registres sont signés par un employé de chaque service à la fin de
la journée ou de chaque vacation. Une copie des mentions des
registres est adressée tous les trois mois aux chefs des services
des douanes des deux zones, avec total et détail des droits que
chaque zone est tenue de rembourser à l’autre : les litiges sont
tranchés en dernier ressort par les chefs de services qui se
réuniront périodiquement dans ce but.
Ces bureaux mixtes
(route et voie ferrée El Ksar – Rabat et route Nador–Berkane),
établis pour identifier les marchandises d’origine étrangère passant
d’une zone dans l’autre, permettent à la zone de destination de
savoir de combien elle est créancière de la zone de provenance, et à
celle-ci de savoir de combien elle est débitrice.
b) Echanges par
voie de mer :
Deux régimes sont
possibles en ce cas : soit le transbordement soit le cabotage :
En ce qui concerne
le transbordement, la marchandise touchait la terre marocaine pour
être transbordée aussitôt : la douane du port de transbordement ne
percevait pas de droits : elle identifie et individualise la
marchandise à laquelle elle délivre un titre de mouvement. Les
droits seront perçus à la zone de destination.
Tandis que pour le
cabotage, la marchandise est débarquée par l’importateur qui la
réexpédie par mer : elle acquitte les droits à son débarquement
comme il se doit. Le bureau d’expédition délivre un passavant sur
lequel il liquide pour ordre les droits à la valeur du jour de
l’expédition, en vue de leur restitution ultérieure à la zone de
destination. Introduite une première fois au Maroc, la marchandise
aura acquitté ses droits et si elle est réexpédiée sur la zone
voisine, elle ne paiera pas de droits à l’entrée dans cette zone. Le
passavant délivré par le bureau d’expédition fait foi qu’elle a déjà
été taxée et prouvera que les droits doivent être versés en
définitive à la zone de destination. L’administration de la zone de
destination recueille les passavants qu’elle transcrit sur un
registre tenu à cet effet, et adresse, en double exemplaires, l’état
des expéditions reçues au bureau du lieu de ré- embarquement de la
marchandise, de sorte que les liquidations soient effectuées en
conformité avec ce bureau.
Au terme des
échanges intra zone la balance est faite des comptes, seul le solde
est versé. La comptabilité des marchandises venant de la zone
française est faite en francs : celle des produits venant de la zone
espagnole faite en pesetas, et la liquidation est effectuée d’après
les derniers cours trimestriels des changes de la Bourse de Madrid.
2) Taxes
intérieures de consommation :
Les droits
correspondants aux taxes de consommation sont liquidés conjointement
avec les droits de douane sur les bordereaux périodiques. Ainsi,
l’unité douanière prête le cadre de ses formalités à la perception
des taxes intérieures de consommation et permet une liquidation
globale et unique. Mais ces taxes de consommation peuvent ne pas
être les mêmes dans les deux zones. L’hypothèse est prévue, chaque
zone devant notifier à l’autre ses tarifs dans un tableau certifié
conforme. Lorsque le tarif de la zone de destination est plus élevé,
ladite zone sera créditée des sommes effectivement perçues et
assurera elle-même la perception du supplément. Deux perceptions en
ce cas sont effectuées. Si le tarif de la zone de destination est
moins élevé, la zone sera créditée du montant des droits calculés
d’après ses propres tarifs. Il n’est fait en ce cas qu’une seule
perception, mais l’usager ne profite pas de la différence de tarif.
Pour les
marchandises d’origine marocaine, celles-ci ne sont pas passibles
des droits de douane ; mais elles sont soumises à des taxes de
consommation et elles font l’objet de comptes spéciaux établis
suivant la procédure ci-dessus. Il y avait donc un versement ou deux
selon cette réglementation, soit en fait, un versement ou non aux
bureaux mixtes, le premier étant compris dans le prix d’achat.
Par ailleurs
l’application particulière du principe de l’unité douanière à
Tanger, découlait des accords anglo-fanco-espagnols. L’article 14 du
Dahir du 16 février 1924 stipulait en outre que
”l’administration ne peut sans entente
préalable avec les autorités des deux zones, réglementer les
questions concernant le cabotage et toutes matières connexes aux
questions douanières et intéressant la généralité des ports
marocains”.
Tanger bénéficiait
cependant d’un régime particulier :
D’une part la ville
n’avait pas une douane autonome : la douane Tangéroise était
chérifienne et relevait de l’administration des douanes de la zone
française. Le gouvernement chérifien désignait le chef du service de
la douane. L’unité douanière était poussée en ce domaine jusqu’à
l’unité de l’administration douanière. Mais place était faite à
l’Espagne : le vérificateur principal était espagnol et nommé par le
chef du service des douanes sur liste de deux noms proposés par le
gouvernement espagnol. Mais il ne pouvait en aucun cas être le
suppléant, dans le service, du chef du service de la douane à
Tanger.
D’autre part La
douane de Tanger ne percevait que les droits et taxes afférents aux
marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone. Les
marchandises débarquées dans la zone française et espagnole
bénéficiaient du régime de transit, d’entrepôt ou d’admission
temporaire, les droits de douane y afférents étant perçus aux
bureaux de la zone de destination. En conséquence, les marchandises
de Tanger à la zone française traversaient en transit le territoire
de la zone espagnole (article 13 – Convention 1931).
Enfin il y a lieu
de signaler que l’unité douanière du Maroc Colonial s’exprimait
particulièrement dans le domaine de la répression de la contrebande.
Afin de faire respecter la législation douanière au Maroc, la France
et l’Espagne étaient associées pour réprimer la contrebande et
interdire en particulier le commerce des armes et des munitions de
guerre. L’article 13, du titre II, de l’Acte d’Algésiras prohibait
en effet dans toute l’étendue de l’empire chérifien l’importation et
le commerce des armes de guerre, pièces d’armes, munitions chargées
ou non chargées, poudres diverses destinées à la fabrication de
munitions. D’autre part, l’article 89 interdisait toute importation
ou exportation en dehors des ports ouverts au commerce. Il a été
fait une stricte application de ces deux clauses qui frappaient
d’une même interdiction les trois zones. Par l’article 25 du traité
du 27 novembre1912, les puissances signataires s’étaient engagées à
prêter leur entier concours aux autorités marocaines pour la
surveillance et la répression de la contrebande des armes et des
munitions de guerre. L’article 4 de la Convention de Paris confia la
surveillance de la contrebande des armes et munitions de guerre dans
les eaux territoriales de Tanger aux forces navales britanniques,
espagnoles et françaises. L’article 12 du Dahir du 16 février1924
étendait de plein droit à la zone de Tanger toutes les dispositions
législatives applicables aux zones française et espagnole et
relatives au commerce des armes et munitions à leur usage. Enfin, un
accord franco-espagnol du 10 juillet 1926 décida que la surveillance
maritime serait exercée par chaque gouvernement dans les eaux
territoriales de sa zone d’influence ; on voit ici jouer le principe
d’autonomie, sauf le long de la côte sud entre les oueds Draa et Bou
Sedra où cette surveillance est effectuée conjointement.
87
Convention signée le 3 juillet 1860 à Madrid entre, la France,
l’Allemagne, le Prusse, l’Autriche, la Hongrie, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Italie, le
Maroc, les Pays Bas, le Portugal, la Suède et la Norvège.
88 Voir texte intégral du traité en Annexe.
89 Traité international sanctionnant une série de négociation
entre le Maroc et les puissances étrangères dont une grande partie
fut consacrée aux questions douanières. Le traité fut ratifié en
1906 par la Grande Bretagne (9 juillet), le Maroc (18 juillet), la
Belgique (25 juillet), l’Allemagne (17 novembre), l’Italie (29
novembre), les USA (14 décembre), la Suède (14 décembre), la France
(21 décembre), l’Autriche-Hongrie (22 décembre), l’Espagne (24
décembre), le Portugal (24 décembre) et les Pays-Bas (30 décembre).
90 Pietri François: Justice et injustice fiscale p. 149.
91 Ancien Directeur Général des Finances au Maroc Mr Pietri fut
Député puis Ministre de France.
92 voir organigramme de l’Administration coloniale au Maroc.
93 L’Afrique française, 7, 1904 p. 238.
94 B.O 241 du 04.06.1917.
95 B.O n° 14 du 31.01.1913. Circulaire du Grand Vizir aux caïds
relative aux réclamations adressées par les étrangers.
96 Annuaire du Maroc Année 1905.
97 Pierre Guiller ”Les emprunts marocains 1902 – 1904 Edition
Richelière p. 150.
98 Ibnou Zidane - Al Athaf.
99 L’Afrique française, 9, 1904 p. 285 – 286.
100 Pierre Guillen op cit p. 149 – 150.
101 Dans ses mémoires, Saint-René Taillandier écrivait que tout
se passa ”vite et bien”, mais reconnaît ensuite qu’il y eut des
difficultés ”Dès le 8/8, je pus annoncer à Mr Declassé que quelques
malentendus de la première heure étaient dissipés” – D’après Guillen
p. 153.
102 F. 0413137 annexé au document 315 du 26 juin 1905 –
Memorandum respecting french financial proposals.
103 B.O 288 du 29 avril 1918.
104 Arrêté visieiel du 5 Rabia II 1336. B.O 288 du 29 avril
1918.
105 Cf. statut en annexe ………
106 B.O n° 407 du 10.08.1920.
107 Document du Foreing - office - Londres Fo. 413 – 53.
108 Pierre Guillen: les emprunts marocains 1902 – 1904 – Edition
Richelieu p. 59.
109 Cet amortissement devait commencer le 01/06/1906 et durer
jusqu’au 01/07/1945.
110 Voir règlement ci-contre.
111 Ce délégué a été chargé du contrôle des douanes par décision
du Sultan du 4 juillet 1907.
112 Lettre adressée par le Sultan à tous les membres de corps
consulaire accrédités à Tanger au sujet des affaires douanières (Cf.
texte intégrale de cette missive en annexe – Annexe 4).
113 F.O opcit 413/53 p. 170 n° 148.
114 Revue Maroc-Europe T1 p. 94.
115 Modifiée par le protocole du 25 juillet 1928.
116 France – Grande Bretagne – Espagne.
117 §2 de l’article 7.
118 Article 20 du statut de Tanger : ”un fonctionnaire espagnol
du service des douanes et du grade de vérificateur principal
figurera dans le personnel des douanes chérifiennes de Tanger”.
119 Diaz Merry. - Livre de Tanger Jurisprudence de la zone
internationale.
120 B.O n° 740 du 28 décembre 1926.
121 B.O n° 2366 du 28 février 1958.
122 Cette charge fut en effet confiée au ressortissant
britanique biotonifue Dicken C.B.E charles Werron né en Angleterre à
South sea en 1881, elu à l’unanimité par l’assemblée législative le
23 mars 1931.
123 Loi du 24 avril 1946 (BO 260).
124 BO de Tanger N° 16.
125 Cette redevance a été portée à 5.000 francs par la loi du 29
août 1946 (BO 392).
126 Loi du 29 août 1946 (BO 302) modifié par la loi du 16 avril
1947.
127 Voir modèle joint en annexe.
128 Peseta – Hassani.
129 Cité par le Docteur Lucien Graux – Le Maroc économique.
opcit.
130 Thomassy le Maroc et ses caravanes, Paris 1845.
131 Rouard de Card – Traités entre la France et le Maroc P.96
Paris 1898.
132 Grande Bretagne, Maroc, Belgique, Allemagne, Italie, USA,
Suède, France, Autriche, Hongrie, Espagne, Portugal, Pays-bas.
133 B.O 312 du 14.10.1918.
134 voir dispositions du règlement des douanes du 10 juillet
1908 en annexe.
135 Annexes To United States Conter – Memorial N° 48.
136 Arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1948 au sujet de
la valeur en douane.
137 Code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir
partant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), Art.
20, B.O n° 3389 bis du 29 chaoual 1397 (13 octobre 1977) page 1225.
138 Les règles détaillées du GATT concernant l’évaluation des
marchandises à des fins douaniers sont rassemblées dans l’Accord sur
l’évaluation en douane (Accord sur la mise en oeuvre de l’article
VII du GATTde 1994)
139 Loi de finances n° 25.00 pour la période allant du 1er
juillet au 31 décembre 2000 promulguée par dahir n° 1-00-24 du 28
juin 2000 portant fixation du tarif des droits d'importation tel
qu'il a été modifié et complété.
140 Article 1er du traité: ”Les deux plénipotentiaires ont
convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et
la Turquie resteraient les mêmes entre l’Algérie et le Maroc …”.
141 ulletin du comité de l’Afrique Française, année 1917, – p.
136 et 290.
142 Le premier bureau des douanes institué par l’autorité
française dans cette zone était babtisé : Martin Prey du Kiss.
143 Jean Donom: Régime douanier du Maroc – Edition Larose 1920
p. 115.
144 Lettre n° 196 du 14 avril 1908 du commissaire du
gouvernement français à Oujda à Monsieur Regnault, Ministre de
France à Ta n g e r. Selon cette correspondance, le Ministre de la
Guerre avait proposé de mettre hors cadres, à la disposition du
département, avec tous droits à l’avancement et à la retraite M.
l’officier interprète Martinot qui était chargé de la surveillance
des douanes et régies marocaines à Oujda depuis le mois d’avril
1907.
145 Le capitaine Pandori publia un article sur le service des
douanes au Maroc en 1907 au bulletin du comité de l’Afrique
française.
146 B e rrahab Okacha : Adaoula Al mokhribia wa mouchkilatou al
atraf fi matlaa al karn al ichrine – Thèse de doctorat Rabat 1996.
147 Port situé en face de Saïdia sur la rive orientale droite de
l’oued Ajroud kiss connu actuellement sous le nom de Al Mhidi (Marsat
Bel Mhidi).
148 Dahir fixant le régime douanier provisoire de la frontière
algéro-marocaine (B.O 480 du 03.01.1922).
149 Dahir du 18 octobre 1920 modifié par dahir du 28 décembre
1921 (B.O 480 du 03.01.1922).
150 Moulay Idriss II fondateur de la ville de Fès.
151 dépêche n° 138 de Fèz du 26 juillet 1866 du consul espagnol
Merry Y Colom in J.L. Miège le Maroc et l’Europe T. V p. 149.
152 Touzani N. op cité p. 75.
153 Les confins Algéro-Marocains – Augustin Bernard 1911 édition
Larose.
154 Leonhard Karow : neuf années au service du Marocopcit.
155 F.O opcit 413/53 p. 305.
156 FO opcit 413/53 p. 316.
157 Bulletin du Comité de l’Afrique française–1907 d’après le
capitaine Pandari officier des douanes française à Tlemcen.
158 (On ne comprend pas, dans les droits de douane, les taxes
intérieures propres à chaque zone qui s’y ajoutent dans le montant
global à acquitter).
159 (Art. 19 du traité de Madrid du 27 novembre 1912)
|