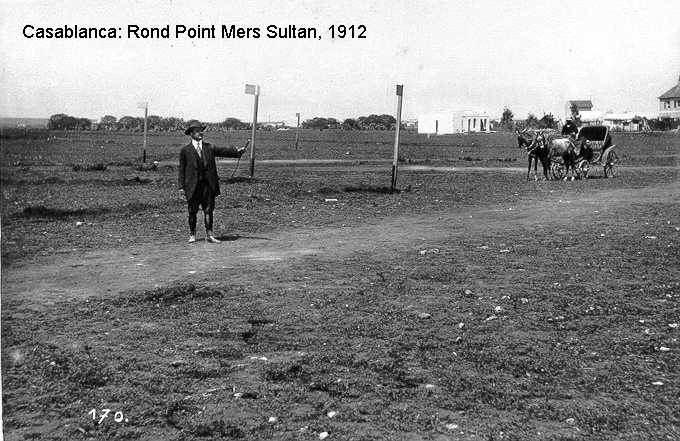
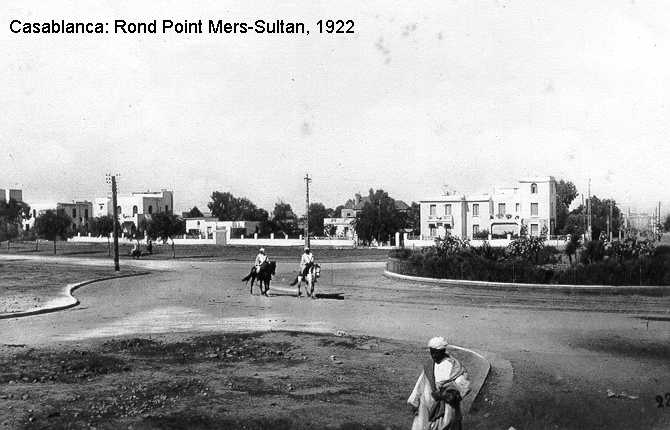
Les textes qui suivent ont été publiés dans la brochure éditée par le Lycée Lyautey en 1994.
Ils sont l'oeuvre des Classes de 1 ères S9 et SI1
la rédaction est de Patrick Cavaglieri - Professeur au Lycée Lyautey
Table des matières
Le paysage éducatif marocain jusqu'au XXe Siècle
Les différents systèmes scolaires avant 1912
Le sytème éducatif marocain sous le protectorat
le sytème éducatif français sous le protectorat (à Casablanca)
LE PAYSAGE EDUCATIF MAROCAIN JUSQU’AU XXe SIECLE
L’histoire du Maroc montre que l'enseignement a toujours été, dans ce pays, une préoccupation prioritaire, une source de réflexion sans cesse renouvelée, un choix de société constamment affirmé.
Lorsqu'en 1912, les Français instaurent le Protectorat et mettent en avant leur souci d'assistance et de formation d'un peuple, ils ne s'imaginent peut-être pas pénétrer dans un pays au passé éducatif si ancien et si riche.
Si les noms des universités de Bologne, Oxford, Cambridge, la Sorbonne, évoquent les institutions universitaires les plus anciennes et les plus prestigieuses du monde, les Français, découvrant le Maroc, lui reconnaîtront pourtant la paternité du joyau le plus ancien du patrimoine universitaire mondial : la Qaraouiyine de Fès, créée au IXe siècle et devançant ainsi de trois bons siècles sa cadette italienne de Bologne.
Ce que les Français découvrent aussi, c'est que, à l'instar de toutes les sociétés musulmanes, le Maroc dispose déjà d'un réseau d'enseignement primaire et secondaire.
En effet, à la veille du protectorat, 150.000 élèves fréquentent les écoles coraniques et 2.500 les médersas.
L’école coranique, petite école primaire appelée msid, assurait aux jeunes enfants, dès l'âge de cinq ans et quelle que soit leur origine sociale, une formation fondée sur la mémorisation des sourates du Coran.
En principe ouvertes à tous, ces écoles étaient cependant largement mieux organisées dans les villes que dans les campagnes.
A l'âge de douze ou treize ans, les élèves les plus doués et les plus méritants pouvaient accéder au second stade de l'apprentissage dans une mosquée ou dans une zaouia, où ils mémorisaient, utilisant toujours la méthode du "par coeur", les principes fondamentaux de la grammaire et du droit islamique.
Puis, si leur fortune le leur permettait, ils entraient dans une médersa prestigieuse, ou à la Qaraouiyine elle-même, comme leurs illustres ainés, savants et intellectuels du monde musulman, lesquels ont tous effectué des stages, plus ou moins prolongés, à Fès, la capitale du savoir: du géographe Ai-Idrissi au médecin et philosophe Ibn Tofail, en passant par le voyageur Ibn Battuta et surtout le mîcitre à penser du MVe siècle, Ibn Khaldoun.
Il est intéressant de noter l'effervescence et l'engouement suscités par les études dans une médersa, et justifiés sans doute par les conditions exceptionnelles qu'offrait cette dernière, aux chanceux qui la fréquentaient.
Réjouissances intellectuelles, certes, auprès des plus grands maîtres (mudarris), mais également hébergement, aide financière (bourses, prise en charge des élèves venant de l'extérieur par une riche famille de la ville) et divertissements mémorables : tous les ans, en effet, était célébrée la fête du "Sultan des tolbas" laquelle consistait à élire un étudiant qui, fictivement, recevait tous les pouvoirs du sultan (avec son accord!!!), formait un makbzen et une administration de parodie, dont les membres étaient chargés de collecter les fonds nécessaires à l'organisation d'un grand pique-nique, au cours duquel les étudiants parodiaient leurs professeurs et des personnages de l'administration dans des sketches où ils jouissaient d'une liberté totale.
Liberté totale, mais de courte durée: le reste du temps, la médersa restait, et c'était là sa fonction première, un 1ieu d'étude et de recueillement. Et la colère du Sultan pouvait être terrible si des manquements à ces règles étaient observés: ainsi, la médersa Al Labbadine fut-elle démolie parce que des étudiants y avaient invité des jeunes filles.
jusqu'au XXe siècle, l'enseignement au Maroc reste donc une affaire presque exclusivement masculine.
Mais, déjà, bien avant l'instauration du Protectorat français, le système éducatif marocain ne se limite pas aux seules institutions du royaume chérifien, mais coexiste avec des institutions d'origines très diverses.
Ainsi, le premier établissement juif de l'Alliance Israélite Universelle a ouvert en 1862 à Tétouan, bientôt suivi d'autres dans les principales villes marocaines. Les Français n'avaient pas non plus attendu le Traité de Fès pour lancer le principe des écoles franco-arabes dans les villes et le plus souvent dans les consulats.
MULTIPLICITÉ DES SYSTEMES SCOLAIRES
A PARTIR DE 1912
En 1912 donc, les Français recensent les institutions existantes, comparent leurs capacités d'accueil et de formation avec les objectifs qu'ils se sont fixés en matière d'enseignement et mettent peu à peu en place un système intégrant les données locales et les apports du pays de tutelle.
Le but annoncé est de généraliser l'accès à l'enseignement et de l'élargir à un pourcentage plus conséquent de la population en âge d'être scolarisée.
Ce point de vue est partagé par le Maréchal Lyautey qui s'est toujours personnellement intéressé aux questions relatives à l'éducation, et qui souhaite former une pepimere de jeunes gens, médiateurs entre deux sociétés qu'il souhaite faire coexister en harmonie. Ces derniers sont appelés à former l'élite intellectuelle avec laquelle il entend coopérer.
Ainsi s'ébauche, lentement, un système où la multiplicité et la diversité rivalisent, mais où comme dans la période pré-coloniale, les jeunes Marocains ne trouvent pas tous leur place. Les Français se heurtent, en effet, aux mêmes difficultés que celles rencontrées les décennies précédentes par le pouvoir marocain et que ce dernier devra de nouveau tenter de surmonter à l'Indépendance: difficultés qui tiennent à une conjonction de facteurs (de l'accroissement de la pression démographique à la diversité croissante de la demande scolaire), facteurs qu'engendre une société en perpétuelle mutation et qui expliquent la trop lente progression du taux d'alphabétisation.
LE SYSTEME EDUCATIF MAROCAIN SOUS LE PROTECTORAT
L’enseignement organisé par les Français, au Maroc, demeure donc assez élitiste et ne recrute souvent que des enfants issus des classes dirigeantes, dont les parents sont associés à l'action du Protectorat : c'est le cas des "Ecoles de fils de notables", qui devaient en principe délivrer un apprentissage fondé sur les deux langues, arabe et français, mais où l'arabe n'apparîtra en fin de compte qu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. Ces écoles, qui ne comptent que 1.468 élèves en 1913, en accueillent 21.400 à la veille de la seconde guerre mondiale, pour atteindre 314.800 en 1955.
Puis les élèves accédaient au second cycle dans les collèges dits "musulmans" créés par les Français, où ils bénéficiaient de conditions pédagogiques de premier choix, qui permettaient aux meilleurs d'obtenir le "Baccalauréat marocain". Les effectifs de ces établissements demeureront beaucoup plus limités, puisqu'ils comptent 608 élèves en 1938, 6712 en 1955. Par ailleurs, les lycées français, qui accueillaient exclusivement des élèves européens, ouvrent leurs portes, à partir de 1944, à des élèves marocains (12% des-effectifs en 1951).
Furent créées également, mais avec beaucoup moins de moyens, des écoles urbaines pour les enfants des classes moyennes et des écoles rurales franco-musulmanes, dans lesquelles était délivrée une formation professionnelle. Là encore, les effectifs restèrent limités (1.300 élèves en 1938, 7.500 en 1955).
Mais la diversité ne s'arrête pas là : des écoles franco-israélites viennent compléter le réseau déjà existant de l'Affiance Israélite Universelle, des écoles franco-berbères sont créées dans l'Atlas ou dans les plaines du sud du pays: "respecter la diversité de la population" disent les uns, "diviser pour mieux régner", rétorquent les autres.
Parallèlement, subsiste un système traditionnel marocain d'enseignement coranique; apparaissent même des écoles privées musulmanes, symbole de la naissance du mouvement nationaliste dans les années 30.
LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS SOUS LE PROTECTORAT
Les origines de ce système se trouvent dans l'ancienne médina ou, à la fin du siècle dernier, quelques écoles (par exemple l'école catholique de la Mission Espagnole et celle de l'Alliance Israélite) dispensaient déjà un enseignement en français. C'est en 1907, rue de la Croix-Rouge, au coeur de cette médina, qu'une institutrice, Madame Peterman, inaugure la première école française. Cette ouverture sera suivie en 1909 par celle de l'École Française de Garçons située rue de Tanger, toujours dans le quartier de la médina et proche de la mer. Cette école qui accueille la première année 14 élèves est confiée à un détaché du cadre de l'Algérie, M. Blache; elle est considérée comme la première école officielle française de Casablanca puisque sa création a été décidée par le Ministère des Affaires Étrangères. D'autres suivront et connaîtront très vite un grand succès. Réunies en 1911, elles accueillent, déjà à cette date, 231 élèves.
On sait que, dès son arrivée en avril 1912 comme premier Commissaire Résident Général de la France au Maroc, le Général Lyautey a voulu faire de Casablanca une grande cité moderne. Parmi les grands travaux d'urbanisme envisagés et qui seront réalisés dans les années suivantes, la construction d'un établissement scolaire spacieux est prévue sur la colline de Mers-Sultan.
|
|
|
LE LYCÉE EN PLANCHES (1913)
En attendant, pour faire face à l'augmentation rapide des effectifs, le Général Lyautey décide en 1913 le transfert des 446 élèves de l'École Officielle Française dans les baraquements de bois du Camp Vilgrain situés avenue du Général d'Amade, à l'emplacement actuel de la Banque d'Etat du Maroc, juste en face de l'Hôtel des Postes. L'établissement s'appellera désormais, officiellement, "Lycée de Casablanca" mais il restera dans les mémoires sous le nom de "Lycée en planches"
En janvier 1914, M. de Aldecoa devient le premier proviseur de ce lycée, dans un contexte défavorable : la première guerre mondiale vient d'éclater, tous les professeurs sont mobilisés et le Lycée de Casablanca, à peine ouvert, aurait sans doute fermé ses portes sans l'affectation, par Lyautey, au service de l'enseignement, des diplômés de ses régiments territoriaux venus du Midi de la France, et sans l'aide de professeurs retraités.
PETIT LYCÉE (1929) ET GRAND LYCÉE (1921)
Le Grand Lycée, magnifique établissement composé de 10 pavillons, doté d'un internat et d'un stade, que Lyautey a fait construire avenue Mers-Sultan, près du parc Murdoch reçoit en 1921 sa première promotion: 153 élèves des classes secondaires.
Les baraques Vilgrain, dénommées désormais "Petit Lycée", continueront d'accueillir les classes primaires jusqu'en 1929.A cette date, le Petit Lycée sera transféré dans de nouveaux et splendides locaux rue d'Alger. Il regroupera le jardin d'enfants, les classes primaires puis, en 1933, un collège.
Ces deux établissements sont placés sous l'autorité d'une direction unique. Pendant plus de vingt ans (1919-1940 et 1943-1945), le Proviseur Roby en aura la charge, sachant tout à la fois donner à son lycée une âme et une image d'excellence. Au départ du Maréchal Lyautey pour la France en 1925, le Lycée de Casablanca prendra le nom de "Lycée Lyautey", nom qu'il porte toujours aujourd'hui.
Nos deux établissements verront leurs effectifs croître régulièrement passant, entre 1919 et 1932, de 248 à 700 élèves au Petit Lycée et de 198 à 600 élèves au Grand Lycée. En 1933, est créée la première classe préparatoire aux grandes écoles. Il s'agit d'une classe de Mathématiques Supérieures qui sera suivie, en 1934, d'une classe de Mathématiques Spéciales: cette dernière ouvrira avec seulement 6 élèves.
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE À l’INDÉPENDANCE
Mais la Seconde Guerre Mondiale va interrompre cet harmonieux développement, la mobilisation de nombreux enseignants nécessitant, à nouveau, le recours à des professeurs retraités. Le tribut versé par nos anciens ftit lourd 95 élèves et 8 professeurs firent en effet don de leur vie entre 1939 et 1945. Leurs noms sont gravés dans le marbre du monument aux morts situé à l'entrée du lycée actuel et que domine le médaillon en bronze à l'effigie de Pierre Simonet, professeur agrégé de lettres, mort à Dachau.
Après cinq années de guerre, le lycée se trouvait dans une situation critique: un corps enseignant dispersé, des élèves orphelins ou anciens combattants, des compressions de locaux dues à l'accueil de services hospitaliers, des classes surchargées (50 élèves).
Le nouveau proviseur, M. Caillaud (1945-1954) redressa la barre. Sous sa direction, de nombreux travaux furent exécutés, le lycée prenant son aspect définitif. Les classes préparatoires connurent un développement spectaculaire: en 1953, le Lycée Lyautey comptait, en effet, six sections post-bac et les résultats obtenus aux différents concours plaçaient par ailleurs celles-ci au niveau des bons établissements de la Métropole. De nouveau, les effectifs élèves croissent. Ils atteindront 2.600 en 1955, nécessitant une augmentation sensible du corps professoral qui passera de 100 enseignants en 1945 à 200 en 1955. Le proviseur du lycée est alors M. Pouget (1954-1957). Il deviendra, après l'Indépendance, Conseiller Culturel à Rabat et Directeur de ce qu on appelait déjà la Mission Universitaire Culturelle Française. Son successeur, M.Wattiez (1957-1966) aura la lourde charge d'effectuer le déménagement d'un Petit Lycéelycée de 2 800 élèves avec internat et classes "prépa", dans de nouveaux locaux puisque, conformément aux accords passés avec les autorités du Maroc, les bâtiments devaient être rétrocédés au gouvernement marocain. C'est ainsi que le Petit Lycée de la rue d'Alger deviendra le Lycée Ibn Toumert, le Grand Lycée, le Lycée Mohammed V et le Lycée de jeunes Filles du boulevard Zerktouni, le Lycée Chawki.
LE LYCÉE ACTUEL (par P.J. Bravo - Proviseur du Lycée Lyautey)
Dès juillet 1959, débutent les travaux de construction du nouveau lycée qui sera situé boulevard Ziraoui, dans le quartier Bourgogne, sur un vaste domaine de plus de cinq hectares, à l'emplacement de l'ancien camp militaire Turpin. Le nouveau Lycée Lyautey est inauguré en novembre 1963.
Et si 1905, le lycée s'agrandit en annexant le domaine voisin (l'ancien camp militaire Beaulieu doté de magnifiques installations sportives avec stade et piste d'athlétisme. Un hangar utilisé auparavant en atelier de réparation de chars est aménagé en collège technique. Arrivé en 1939, M. Bellier, professeur de Mathématiques en classe préparatoire, prend en 1966, la direction de l'établissement. Il recevra en 1970, M. Maurice Shumann, Ministre des Affaires Étrangères, qui, après la visite de notre établissement, écrira sur le livre d'or du lycée
"Hommage aux enseignants français et au proviseur du plus grand lycée d'un empire spirituel : l'empire de la francophonie".
C'est l'époque des premiers délégués-élèves aux conseils de classe, de la création de la coopérative scolaire, de l'ouverture du foyer Claire Granier et des dernières distributions de prix... Un accroissement des demandes des familles entraîne la multiplication des Lycées Lyautey à Casablanca. Aussi, devient-il utile de les numéroter : notre établissement, boulevard Ziraoui devient Lyautey I, mais on parle aussi de Lyautey Il pour dénommer le collège Alain Fournier, place de Reims, de Lyautey III pour désigner le collège Anatole France, et de Lyautey IV à Aïn-Sebaâ qui accueillera l'École Française des Affaires en 1988.
Ancien professeur agrégé d'arabe, M. Chanut est nommé à la tête de l'établissement en 1981 et devra faire face à une situation difficile avec les fermetures, d'abord en 1986 des classes préparatoires qui sont transférées au lycée Mohammed V, puis en 1987 des sections techniques préparant aux baccalauréats industriels et technologiques.
Le Lycée Lyautey affiche, dès lors, le visage que nous lui connaissons aujourd'hui mais il n'a cessé d'être amélioré afin de répondre aux exigences de cette fin de siècle (création d'un centre d'information et d'orientation en 1987, aménagement de salles vidéo et informatiques).
Comme on peut ainsi le constater, notre présent a de profondes racines et les actions que nous conduisons aujourd'hui s'inscrivent dans le prolongement de celles dirigées hier par nos prédécesseurs car un meme esprit nous anime : l'amour de la France et un attachement affectueux et respectueux au Maroc, au service de la formation et de l'éducation des jeunes qui nous sont confiés.
Nous sommes fiers, à juste titre, de notre réputation d'excellence. Mais n'oublions pas que cette image a été forgée par des générations successives qui ont su faire reconnaître notre lycée comme étant l'équivalent des meilleurs en France. Cette tradition de qualité est une grande chance, c'est aussi une exigence dont il faut savoir être digne.