-
* *
- *
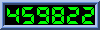

Le caractère christique du 18° degré (c'est-à-dire, au sens exact du terme, relatif à la vie
de Jésus-Christ) est, pour qui le découvre, à la fois évident et surprenant. Car pour un franc-maçon laïque et républicain du Grand Orient de France, l'atmosphère de la cérémonie, en raison de ses apparences religieuses, a de quoi surprendre.
Le fascicule consacré à ce grade, qui est remis lors de l'initiation, est rassurant en ce qu'il précise qu'effectivement on peut «
avoir quelque difficulté à assimiler les enseignements du grade ».
Mais le problème n'est pas pour autant résolu lorsque la même plaquette précise à propos de notre rituel que «
certains, ne s'en tenant qu'aux apparences, lui attribuent à tort une origine et un sens généraI spécifiquement chrétiens ».
Pour résoudre une difficulté, la brochure en fait surgir une autre plus grande, car elle s'emploie à démontrer, contre toute évidence, que les éléments chrétiens sont négligeables et que l'enseignement du grade relèverait à la fois (page
5) « de l'arithmomancie pythagoricienne, de l'hermétisme avec son
dérivé
l'alchimie, du Zodiaque et de son application dans l'astrologie, de la Cabale, du Gnosticisme, et enfin du Rosi-Crucisme
». Autrement dit, un bric-à-brac dans lequel on trouverait tout et son contraire (quoi de plus contradictoire qu'alchimie et gnosticisme
?) c'est-à-dire rien.
A l'appui de cette thèse, la tradition juive est présentée comme «
un mince vernis recouvrant une réalité
égyptienne»
(p. 5) : ainsi le tétragramme hébraïque, tout comme le logos johannique, ne serait qu'un déguisement du dieu égyptien Thot. La formule INRI, au sens chrétien du terme, n'aurait
"aucun sens
initiatique"
; par contre, elle serait riche d'enseignement si on l'entendait en son sens hermétique : je passe sur le contenu moral plutôt banal qui nous est proposé pour illustrer cet enseignement. Le mot
agapè, concept-clé du Nouveau Testament, devrait son origine
à
"un dieu grec"
; la croix ne signifierait rien par elle-même, sinon, outre un outil préhistorique, la stabilité dans sa dimension verticale: bref, la croix,
d'après ces considérations de morale rudimentaire, serait un symbole radical-socialiste.
Certes, il y a continuité dans l'histoire des religions comme dans l'histoire tout court, et l'Église chrétienne Gomme le Temple juif sont dans
la continuité de la Maison de Vie égyptienne. Mais dans leur contexte propre, le Temple juif comme l'Église chrétienne prennent une signification spécifique. Dirait-on que la République n'est qu'un vernis recouvrant la monarchie, elle-même vernis r~couvrant la féodalité
? Ce serait refuser de comprendre la signification d'une forme
historique donnée.
Tout cela n'est donc pas satisfaisant. Il convient d'étudier en tant que structure autonome, le texte du rituel que nous pratiquons, en se demandant s'il constitue un tout cohérent, et dans l'affirmative en quoi consiste sa cohérence. Voici ce qui en ressort :
1) Le caractère christique du rituel est évident. On y trouve, outre l'ordre du Bon Pasteur, les grandes étapes de la vie du Christ telles qu'elles sont relatées dans les
Évangiles (l'historicité de ces événements est un autre problème).
- 2) Ce qui donne sens à
ces éléments christiques, c'est leur environnement chrétien qui est récurrent dans le rituel. Même si l'on peut trouver une origine exotique aussi bien aux éléments juifs qu'aux éléments chrétiens présents dans le rituel, il reste que c'est leur formulation chrétienne qui leur donne cohérence, et elle seule.
- 3) Ce n'est pas pour autant que la pratique du rituel du 18" degré consiste à célébrer la messe. Il faut bien distinguer d'une part, la philosophie du grade: sa formulation est chrétienne, et elle n'a pas de quoi choquer un agnostique ou un athée; et d'autre part, la métaphysique chrétienne, c'est-à-dire une conception du sens de la vie reposant sur la foi en une réalité divine supérieure. C'est cette métaphysique qu'exprimait Saint Paul lorsqu'il déclarait «
Si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication est vaine
». Cette métaphysique n'est absolument pas affirmée dans notre rituel.
LE
CARACTÈRE CHRIST/QUE DU
GRADE
La vie du Christ est résumée dans la cérémonie d'extinction des Lumières, explicitement dans la version A, implicitement dans la version B. L'épisode des marchands chassés du Temple y est évoqué. Les différentes phases de la Passion
y
figurent: la couronne d'épines, la solitude qui évoque le « pourquoi m'as-tu abandonné ?» du Nouveau Testament, la crucifixion et la mort.
La Pâque est la toile de tond de cette partie du rituel. La Cène, avec le partage du pain et du vin, comme dans le Nouveau Testament, reprend, sur le mode social, ce qui fut le fondement de l'eucharistie. L'agape se célèbre le Jeudi saint et célèbre à la foi§ l'agneau pascal et l'agneau céleste - agneau céleste que la référence à la constellation du Bélier n'empêche pas d'être aussi
l'Agnus Dei. Dans un tel contexte, la disparition et la réapparition de l'étoile flamboyante évoquent l'espérance liée à l'étoile de Bethléem. Comment, dans ces conditions
INRI,
associé à la
croix, pourrait-il signifier autre chose que « Jésus de Nazareth Roi des Juifs
»... formule dont. nous aurons à examiner la valeur initiatique bien réelle? Il n'est pas jusqu'à la résurrection qui ne' puisse être lue dans la déclaration du Grand Expert qui déclare, au début de la deuxième partie de l'initiation, que la Parole a été retrouvée «
sous l'aile du Phénix à /'instant où il renaissait de ses cendres».
Ce qui nous conduit à examiner la philosophie du grade.
LA PHILOSOPHIE DU GRADE
Ancienne loi, nouvelle
loi
L'Ancien Testament est envisagé, dans le rituel, du point de vue du Nouveau Testament. Lors du rallumage des Lumières, le
Maître des Cérémonies, allumant la deuxième étoile, demande que « nous
ordonnions
nos pensées en conformité avec la Loi »,
sans autre
précision. Mais la cérémonie de l'Agneau est plus explicite, puis- qu'elle différencie les «
sacrifices matériels de l'ancienne Loi » et « les sacrifices moraux de la nouvelle ».
Les Évangiles insistent sur la continuité entre les deux lois, la nouvelle étant l'accomplissement de l'ancienne qui n'est pas abolie pour autant: seul Jean va plus loin en déclarant dans son Prologue: «
la Loi a été donnée par Moïse; La grâce et la vérité sont advenues par Jésus-Christ
», ce qui est nettement la marque d'une rupture. C'est dans cet esprit que la cérémonie de réception du 15° au 17° degré précise par la
voix du Très
Sage
que « le second Temple avait, comme le premier, été élevé sur le fondement de l'ancienne Loi qu'animait une volonté de puissance. Lui aussi s'effondrera. Sa chute et la disparition d'Israël précèderont l'avènement du troisième, Temple, Temple mys- tique celui-là. Il sera fondé sur la nouvelle Loi
.: l'Autorité et la justice y seront tempérées et sanctifiées par l'Amour »
.
-
- Cela
n'est pas différent des paroles adressées par le Christ à la samaritaine et qui annoncent l'heure d'une adoration du Père « en esprit et en vérité », c'est-à-dire l'heure où temples et prêtres seront devenus inutiles.
-
La lettre de l'opposition entre l'ancienne Loi et la nouvelle Loi ne nous intéresse pas, et il n'est évidemment pas question de classer par ordre de mérite christianisme et judaïsme. Seule importe la signification symbolique de la nouvelle Loi, qui est claire: il s'agit de sortir de l'application
routinière de préceptes devenus formels pour retrouver le souffle qui les animait et qui est retombé. Un passage de l'Évangile de Jean illustre bien ce fait: à des juifs qui lui demandent comment faire pour réaliser les œuvres de Dieu, Jésus répond: « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Celui qu'il a envoyé ». C'est donc l'esprit qui compte, plus que des actes qui peuvent en être dénués. Bien sûr, on pourrait ajouter qu'en matière de formalisme, le christianisme en général, et l'Église catholique en particulier, n'ont pas été en reste par la suite: mais cela n'ôte rien à la valeur du symbole.
Le souffle qui fait qu'un acte est animé par la vie, est inspiré, c'est à l'évidence le
Da var, la Parole de l'Ancien Testament, devenue le Logos johannique - cette même Parole qui, dans notre rituel est tantôt perdue et tantôt retrouvée, dans une contradiction qui n'est qu'apparente. Là encore, le passage de l'univers de l'Ancien Testament à celui du Nouveau Testament est hautement symbolique.
Le concept
de Dieu
Le Dieu de l'Ancien Testament, l'Éternel qui extermine tous les premiers nés d'Égypte auquel se réfère le Très Sage célébrant la cérémonie de l'Agneau, est la transcendance, même s'il intervient dans les affaires des hommes: il est le Tout Autre de Rudolf Otto, celui que, selon l'Exode, on ne peut voir sans perdre la vie, celui
dont il est même impossible de prononcer le nom et dont le souffle a renversé le Chevalier de Royal Arch qui a eu l'audace d'ouvrir la onzième Porte.
-
- Dans le Nouveau Testament, ce Dieu est accessible par la méditation. du Christ: chacun peut être un avec le Christ, et par là-même s'unir à Dieu: c'est le mystère qui, dans la théologie chrétienne orthodoxe, s'opère par la «
théosis », c'est-à-dire l'accès à la nature divine du Christ, le croyant devenant Christ. lui-même,
et par là retrouvant son image originelle puisque Dieu a créé l'homme à
son image. Si nous nous maçons non pas sur un plan métaphysique, mais sur un plan philosophique comme nous y invite le rituel, l'enseignement initiatique est clair: chacun peut parvenir au plus haut degré de l'initiation; la perfectibilité humaine n'a pas de limite, et c'est pourquoi le Très Sage conclut le rallumage des Lumières par ces mots: «
tous les espoirs vous sont permis », au moment où il annonce que la Parole est retrouvée. En dehors de ce sens symbolique, nous n'aurions guère qu'un conseil de la morale la plus banale.
C'est le sens de la traduction dans notre rituel d'Emmanuel par
Dieu est en nous, et non pas la traduction Dieu est avec nous
que proposent les Évangiles. Cette approche correspond au concept d' «
enfants de Dieu» de l'Évangile de Jean, concept qui est à la fois au présent et au futur. Car chez Jean comme chez Luc, le Royaume est pour la fin des temps, mais il est déjà là avec la venue du Christ.
Luc l'exprime par une formule qui signifie aussi bien
«
le Royaume
est parmi vous»
que « le
Royaume est en vous ».
Ce qui signifie
que s'il y a un au-delà de la mort dont la réalité est métaphysique au sens étymologique, il y a aussi un au-delà de la vie qui est la dimension spirituelle de l'homme, la Personne qui transcende les aspects biologique et matériel de l'individu. L'homme ne se réduit pas à ses misères ou à ce qu'il possède; c'est la signification de propos comme
«
Heureux les pauvres!
» (Luc) - même s'ils ont servi plus tard de justificatif politique à l'oppression.
Cette dualité philosophie/métaphysique, le rituel la maintient, mais uniquement comme dualité philosophique interne.
- La Parole
- Cette dualité, c'est la Parole retrouvée, puis à nouveau perdue et
qui n'est d'ailleurs retrouvée que comme Parole substituée: celui qui croyant avoir définitivement retrouvé la Parole se serait arrêté
en chemin pour s'y installer comme dans un quartier résidentiel, celui-là en serait définitivement retranché. C'est pourquoi il n'est pas contradictoire que la Parole soit à la fois retrouvée et perdue, Heidegger exprimait ce paradoxe .en disant que l'Être se voile aussitôt qu'il se dévoile, reprenant la conception héraclitéenne de l'union des contraires, C'est là une vérité profonde dont le caractère éminemment initiatique ne peut échapper à un Maçon qui sait que le propre de sa démarche est de n'être jamais achevée. C'est aussi Socrate dont la Pythie déclara qu'il était le plus savant des hommes alors qu'il disait ne savoir qu'une seule chose, qu'il ne savait rien. l'itinéraire que propose le grade pourrait s'e formuler en ayant recours à d'autres sphères culturelles: dans notre rituel, c'est en termes de philosophie chrétienne qu'il s'exprime.
-
- Mais qu'il y ait Dieu au bout
ou plus simplement l'homme, il n'y a de sens que par l'effort de l'homme à la recherche du sens. C'est ce qu'affirmait Albert Camus dans ses
Lettres à un ami allemand; c'est ce que formulait très poétiquement André Malraux dans
Les Voix du Silence: « Il est beau que l'animal qui sait qu'il doit mourir arrache à
l'ironie des nébuleuses, le Chant des constellations ».
- Foi, espérance, charité
Il n'en reste pas moins que les vertus qui sous-tendent cet itinéraire - les trois vertus théologales définies par Saint Paul
-
perdraient à être systématiquement arrachées à leur contexte. Car celle des trois vertus qui couronne les autres,
l'agapè (que l'on traduit aujourd'hui par « amour» et non par «
charité »), prend tout son relief dans ce très beau passage de l'Épître aux Corinthiens qui mérite d'être cité (1,12) :
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis que bronze qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
- L'amour est patient; serviable est l'amour, il n'est pas envieux; l'amour ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas; il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal; il ne se réjouit pas de J'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, endure tout...
Maintenant donc demeurent
la foi, l'espérance, l'amour, ces trois-là; mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour.
Pour
ce
«
sentiment nouveau
», les premiers chrétiens ne sont pas allés chercher le nom d'un
dieu grec d'ailleurs inexistant: ils ont forgé un substantif nouveau à
partir d'un verbe grec de la langue d'Homère, et n'ont utilisé aucun des
deux mots usuels à leur disposition, dont l'un désignait l'amour charnel, l'autre: l'amitié. Cet amour est celui qui fait sortir
de soi, qui rend capable de donner, de se donner. L'autre vertu qu'est l'espérance signifie que cet amour a à se réaliser dans l'histoire,: c'est la leçon commune à l'Ancien et au Nouveau Testament; c'est aussi la leçon de l'existentialisme qui nous dit que le temps est l'être de l'homme: c'est parce qu'il y a le temps qu'il y a du sens. Hors du temps, point de projet, ou de
"pro-jet", et l'expérience humaine n'a pas de signification.
Quant à la foi, elle est un pari sur la perfectibilité de l'être humain sans laquelle tout engagement serait vain. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que lorsque notre rituel parle
de « foi dans l'Homme
», c'est avec
un H majuscule: il ne s'agit pas de se bercer d'illusions sur ce qu'est la réalité toujours ambiguë de l'homme tel qu'il est, mais de parier sur ce que l'homme pourrait être un jour, de parier sur l'inachèvement de la création et l'avènement d'un homme un peu plus humain,
de
«
l'homme du 8°
jour»
de la théologie orthodoxe, qui ressemble au troisième Temple mystique du rituel et de la théologie médiévale et qui, en termes marxistes, est l'homme rendu à son pouvoir créateur.
L'archétype de ces trois vertus, c'est évidemment le Christ qui vient donner un commandement nouveau, l'amour: qui vient apporter non la paix, mais l'épée; et qui malgré cela promet à l'homme qu'il ne fera qu'un avec Dieu.
Métaphysique et histoire
Tout cela a un sens philosophique profond, cohérent, que l'on croit ou non en Dieu. Le seul point qui puisse gêner dans ce grade, c'est l'acclamation «
Hoschée ! », que l'on peut difficilement faire glisser du plan métaphysique au plan philosophique: car si l'on transposait la notion de sauveur dans l'histoire, force serait de
constater
que les sauveurs n'ont jamais manqué, mais que bien souvent ils n'ont guère sauvé qu'eux-mêmes, et encore !
Pourtant le rituel opère par ailleurs des glissements historiques dont le sens est profond, et
cela à deux reprises dans la cérémonie de l'extinction des Lumières.
-
- Lorsque le premier Grand Gardien dit, dans la version B : «
ceux qui avaient l'amour de la Patrie, mais qui prêchaient la Paix entre tous les peuples ont subi le sort des traÎtres»,
il est permis de s'interroger. Il serait intéressant de savoir si la date de l'apparition de la version B l'autorise, mais on croirait voir entre les lignes se dessiner la figure de Jaurès. Un telle assimilation est conforme à l'esprit du rituel (étant entendu que chacun est libre d'y procéder ou non) et à la philosophie selon laquelle les valeurs de l'Esprit doivent être incarnées, et non pas demeurer dans un ciel définitivement inaccessible.
-
- Le deuxième glissement, dans les versions A et B de la même cérémonie, c'est Ie Très Sage qui l'opère lorsqu'il conclut en disant:
«
Nous sommes
réunis pour commémorer, en
ce jour de printemps, le drame de la libération humaine. Souvenons-nous de
ce précepte: aimons-nous les uns les autres ». L'expression «
libération humaine» revêt à la fois un sens spirituel, sans qu'il y ait connotation relative à l'au-delà, et un sens historique. Elle constitue une manière d'interpréter l'histoire de l'humanité depuis les temps préhistoriques. Elle est aussi le fondement des valeurs républicaines qu'honore le Grand Orient de France dans le droit fil de la philosophie des Lumières qui n'a rien perdu de son actualité, malgré les attaques haineuses qu'elle subit, en parti- culier, à l'occasion, de la part de prélats catholiques. Car l'actuelle
hiérarchie de l'Église craint plus qu'elle ne souhaite la
libération :
chacun connaît les propos du cardinal Lustiger imputant à la philosophie des Lumières la responsabilité d'Auschwitz. Moins connus sont ceux du cardinal Ratzinger qui, partant en guerre contre la Théologie de la Libération, parle d' «
un amalgame ruineux entre le pauvre de l'Écriture et le prolétaire de Marx »
dans son « Instruction sur quelques aspects de la théologie de la libération »
de 1984. La philosophie chrétienne est une chose, son application vaticane en est une autre !
C'est d'ailleurs pourquoi, à côté de la version A de la cérémonie d'extinction et de rallumage des Lumières qui se réfère explicite- ment à la vie du Christ, est un jour apparue la version B, dont le langage s'est dépouillé de ces références explicites, par crainte
que la
dimension symbolique du langage d'origine chrétienne ne donne à penser que ce grade pourrait devoir quelque chose à un enseigne- ment dogmatique.
Lumières et lumière: le feu pascal
Que dans l'expression
" philosophie des Lumières"
le mot
Lumières ait une connotation johannique, c'est évident. C'est également la lumière johannique qui rend compte d'un passage obscur de notre rituel, dans lequel la lumière est symbolisée par le feu. En effet, au moment du rallumage des Lumières le Très Sage
déclare: "Assurons donc mes Frères Chevaliers, la transmission de la flamme symbolisant la foi dans notre œuvre, et n'oublions pas que c'est
par le feu que la Nature entière est régénérée".
La fin de la phrase est énigmatique et semble renvoyer à l'interprétation alchimique d'
INRI : si c'était le cas, quelle pauvreté ! Il est vrai que nous pourrions y voir des cosmogonies antiques, la cosmogonie stoïcienne notamment, qui enseignait que périodiquement le monde s'embrasait et se régénérait: qu'avons-nous à faire de tout cela aujourd'hui ? Une fois de plus, c'est du côté chrétien que l'on trouve un véritable sens initiatique: car notre rituel porte la marque de la liturgie du feu pascal.
La Vigile pascale commence en effet par la bénédiction du feu à partir duquel sera allumé le cierge pascal. Cette liturgie ancienne s'appuie sur deux déclarations de Jésus, l'une dans Luc
"je
suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà
allumé !
" et l'autre dans Matthieu selon laquelle seul Jésus, d'après le Baptiste, peut
"baptiser
dans
l'Esprit Saint et dans
le
feu".
Le feu ici, comme dans toute la liturgie pascale, ce n'est pas
le feu qui consume mais la lumière qui brille dans les ténèbres. En effet, l'oraison de bénédiction du feu pascal commence ainsi:
"Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la Lumière du monde, tu
as donné aux hommes la clarté de ta Lumière; daigne bénir cette
flamme qui brille dans la nuit".
Lorsque le prêtre a béni le feu nouveau,
il pénètre dans l'église obscure en marquant trois arrêts pour proclamer
"Lumière du
Christ !
"
C'est
là d'ailleurs la signification symbolique des cierges qu'on allume dans les églises; c'est là, dépouillée de sa dimension
métaphysique, la signification symbolique des bougies sur les plateaux des officiers dans nos loges.
La racine de ce symbolisme est ancienne: elle dérive du rite juif qui consiste à allumer les lampes au moment où tombe la nuit inaugurant
le sabbat; il est bien probable que ce rite remonte jusqu'au temps le
plus archaïque de la découverte du feu (mode de cuisson bien sûr, mais
aussi Lumière qui brille dans les Ténèbres). Mais quelle qu'en soit
l'ancienneté, le symbolisme du. feu, dans notre rituel, prend sa source
dans la liturgie pascale (d'ailleurs c'est bien la Semaine Sainte qui
est le cadre de notre rituel). Cette signification est évidente su l'on veut bien se reporter à ces propos du Très Sage au moment de l'initiation au 18" grade lorsqu'il définit la couleur rouge comme c~l!e «
du Feu et de l'Amour ». Rien de commun avec un feu de rôtissoire ! «
Nous sommes déroutés et sans rêve», disait René Char, « mais i/ y a toujours une bougie 'qui danse dans notre main ».
INRI
Et cela nous conduit à la signification d'
INR/. On se donne parfois bien du mal pour exorciser la signification chrétienne de la formule, et cela probablement en raison des rapports entre l'Église et la République, et plus particulièrement entre l'Église et la franc-maçonnerie. Cela va même jusqu'à l'absurde, lorsque par exemple un auteur maçonnique nous explique qu'on pourrait lire dans la for- mule: «
Chassons /'ignorance par un effort constant » : ainsi une maxime voltairienne d'esprit se glisserait dans une coquille bien peu voltairienne !
Or l'ensemble du rituel impose l'interprétation chrétienne. Mais ce qui est donné comme modèle au Chevalier Rose+Croix, ce n'est pas le petit Jésus des images sulpiciennes pour lequel il faudrait faire brûler des cierges et devenir catholique pratiquant; c'est la symbolisation parfaite, en termes chrétiens, de l'irruption du sens dans la vie de ce mammifère supérieur qu'est l'homme. Point n'est besoin, pour le comprendre, de recourir à une Tradition primordiale historiquement hypothétique et archéologiquement improbable, ou de faire dans le temps et dans l'espace, le tour complet des significations du symbole de la croix. Le sens, c'est la branche verticale
de la croix qui indique le monde céleste, c'est-à-dire celui des valeurs qui fondent l'humanité de l'homme; le sens, c'est aussi la branche horizontale de la croix, ligne du temps que l'homme parcourt s'il sait rester fidèle jusqu'au bout à sa vocation, dans un itinéraire pareil à un pèlerinage selon la conception romane: c'est ainsi qu'il faut comprendre l'analogie que le rituel établit entre le Christ et Hiram, Hiram se substituant au Christ dans la version B. Cela nous établit au cœur de l'harmonie universelle sans qu'il y ait besoin de passer par les méandres de l'alchimie.
En effet, le bestiaire roman présent dans le rituel en est la manifestation. Marie-Madeleine Davy montre bien dans son
Initiation à la Symbolique Romane que pour le chrétien de l'époque romane, la présence du Christ est d'une telle évidence que c'est le Christ lui-même qui est perçu à travers l'agneau. Elle ajoute que pour le chrétien de l'époque romane, la nature entière est associée à la Rédemption. Il est vrai que l'agneau est un symbole commun à toutes les sociétés agraires, mais c'est bien l'agneau chrétien qui figure dans nos rituels. Le Phénix et le Pélican ont la même fonction dans l'iconographie romane, ainsi que l'Aigle, symbole de transcendance.
Nous abordons là un point de méthode capital. S'il est tout à fait légitime lorsqu'on étudie un symbole séparément, hors de tout contexte, de faire intervenir les significations de ce symbole dans d'autres traditions culturelles (y compris la liste que j'ai mentionnée en introduction: alchimie, cabale, etc.), il en va différemment lors- qu'on s'attache à un ensemble qui constitue une «
constellation
symbolique»
(Gilbert Durand) qui précise la signification de chaque
symbole en fonction du lien qu'il entretient avec les autres. Car nous savons bien depuis Pascal que les propriétés d'un tout ne se réduisent pas à la somme des propriétés des parties.
D'ailleurs dans la symbolique chrétienne, le Pélican peut aussi bien désigner le Christ que l'homme souffrant. Mais dans notre rituel, il me paraît plus probable de considérer que tout à la fois l'Aigle, le Phénix et le Pélican désignent le Christ, mais le Christ envisagé sous un angle différent: transcendance, résurrection, sacrifice.
CONCLUSION
- Ainsi la lecture du rituel à la lumière de l'ensemble
mythique
chrétien en révèle à la fois, la profondeur et la cohérence. Sans prétendre qu'on puisse faire une lecture scientifique d'un rituel maçonnique, on peut cependant appliquer un principe scientifique connu: l'hypothèse la plus probable est celle qui rend le mieux compte de l'ensemble des phénomènes observés, et c'est le cas de l'hypothèse de lecture se référant au contexte chrétien; toute autre lecture à prétention globale serait loin derrière, partielle, voire impossible. Car s'il est vrai que la liberté est totale en matière de symbolisme, cette liberté n'est pas l'arbitraire parce que, nous l'avons vu, dans un ensemble, dans une
constellation symbolique
les. symboles se déterminent l'un l'autre: ils sont à la fois redondants et porteurs d'une signification singulière.
-
- Si on l'oublie, on risque de voir un ensemble symbolique cohérent ressembler davantage aux souks de Marrakech qu'à une pensée construite. D'ailleurs toutes les contorsions pour dénier l'influence chrétienne dans le rituel aboutissent, par les détours que j'ai signalés, à retrouver laborieusement des significations qui sont aussi et surtout chrétiennes. Je conclurai en trois points :
1) Le rituel du 18e grade n'est pas religieux parce qu'il n'impose pas une croyance en l'au-delà: quelle que soit l'étymologie que l'on retienne pour le mot religion (la plus probable, «
religere »,qui signifie recueillir, c'est-à-dire n'omettre aucun geste ou rite à même d'établir le contact avec les dieux; ou «
religare », qui signifie relier- non pas les hommes entre eux,
mais relier le monde visible au monde invisible). il ne convient pas à
notre rituel. Le rituel du 18e grade est authentiquement initiatique,
c'est-à-dire centré sur la progression personnelle, et non sur les techniques de communication avec l'au-delà.
- 2) Le rituel du 18e grade est tout à fait compatible avec la liberté absolue de conscience d'un franc-maçon du Grand Orient de France.
- 3) Tout en assumant le caractère chrétien du symbolisme du grade, il ne faut pas accepter que l'on dise qu'il serait nécessaire d'être croyant pour appartenir à des ateliers de haut grade du Rite
Écossais Ancien Accepté.
- René ANDRAU, 30e

